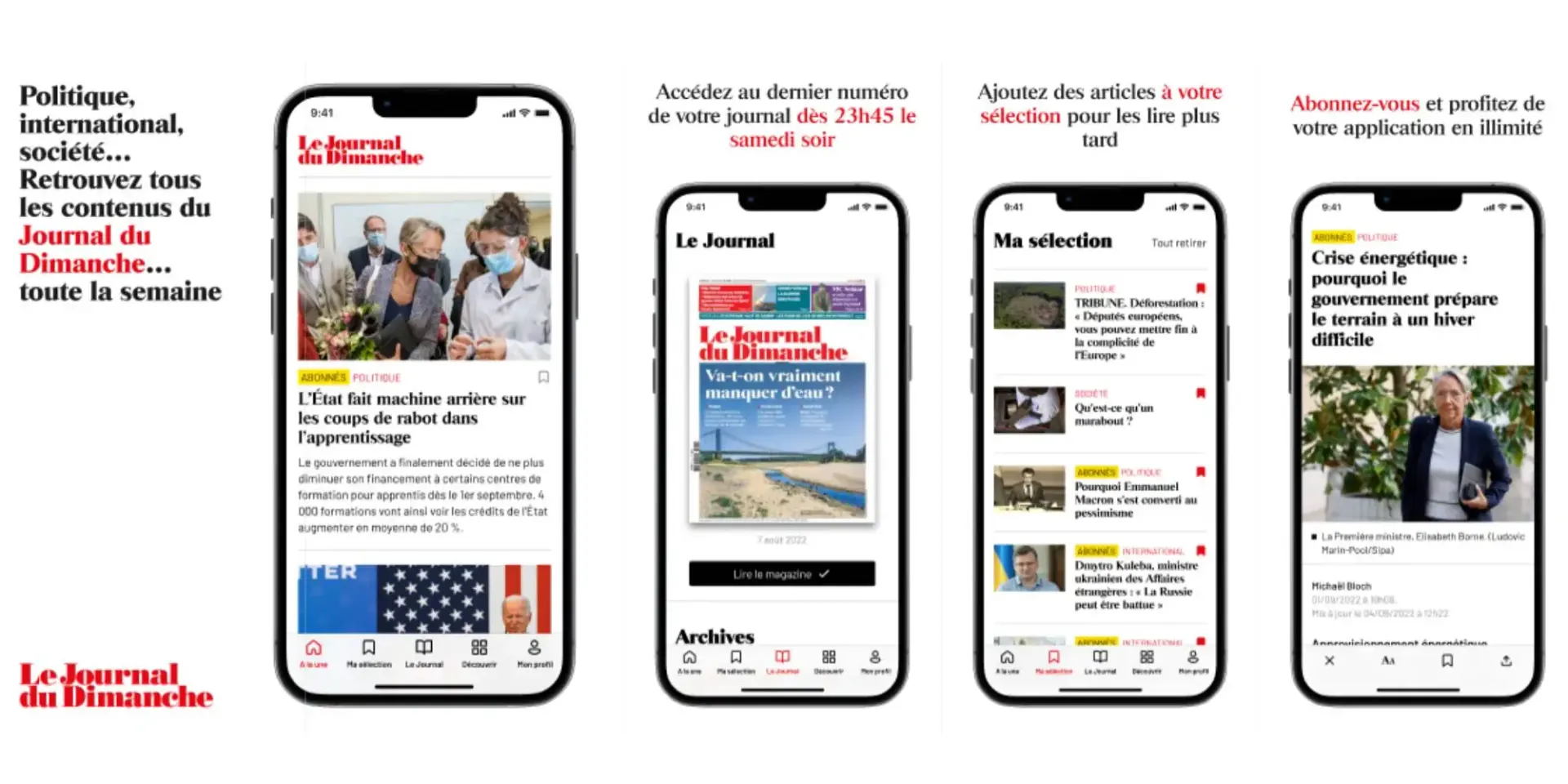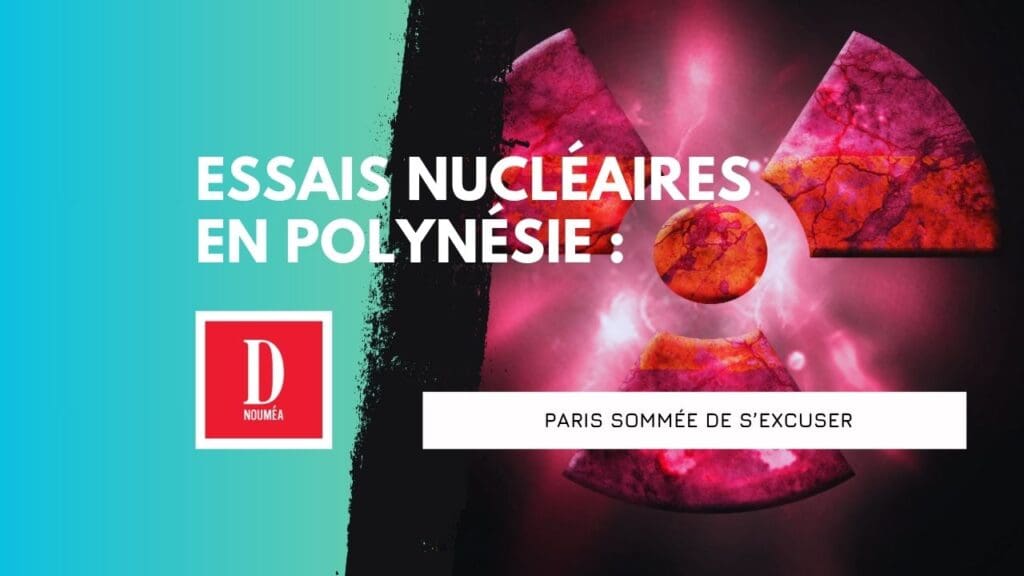TRIBUNE. Le traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan marque-t-il la fin de tout espoir pour les Arméniens du Haut-Karabakh ? Sous la pression de Bakou et face à l’inaction occidentale, Erevan semble céder. Une honte pour l’Europe, dénonce Thibault van den Bossche, chargé de plaidoyer au Centre européen pour le droit et la justice.
Jeudi 13 mars, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont annoncé avoir finalisé un accord de paix censé clore près de 40 ans de conflit. Mais derrière cette façade historique se cache une autre réalité : l’abandon des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, victimes d’un nettoyage ethnique après l’offensive éclair de Bakou en septembre 2023.
Le texte, encore confidentiel, prévoit l’ouverture des frontières, la fin des revendications territoriales, notamment celles de l’Arménie sur le Haut-Karabakh, et la dissolution du Groupe de Minsk. Il impose aussi à Erevan de renoncer à toute présence militaire étrangère sur son sol, un point qui pourrait compromettre la mission d’observation de l’Union européenne (EUMA). Une normalisation des relations bilatérales ? Plutôt un diktat imposé à l’Arménie.
Le Haut-Karabakh arménien est rayé de la carte. À Bakou, 23 otages arméniens, parmi lesquels des anciens dirigeants comme Ruben Vardanian, subissent actuellement une parodie de procès. Sur le terrain, les églises et monuments chrétiens sont détruits sans la moindre opposition. Quant au droit au retour des réfugiés, pourtant exigé par la Cour internationale de justice le 17 novembre 2023, il est purement ignoré. L’Azerbaïdjan ne se contente pas d’effacer une présence arménienne plurimillénaire, il la remplace, repeuplant l’enclave avec ses propres ressortissants.
La survie au prix de la capitulation ?
Nikol Pachinian joue la survie d’une Arménie affaiblie et isolée. Mais en cédant tout à Bakou, il prend le risque politique de l’humiliation de trop. Bakou exige la suppression d’un passage clé de la déclaration d’indépendance de l’Arménie, adoptée en 1990 et faisant partie de la Constitution, qui évoque la « réunification de la République socialiste soviétique d’Arménie et de la région montagneuse du Karabakh ». Cette région, historiquement arménienne, avait été attribuée à l’Azerbaïdjan par Staline en 1921. Une partie de l’opinion publique, et plus encore la diaspora arménienne, trois fois plus nombreuse que la population vivant au pays, y voient une reddition inacceptable.
« La raison du plus fort est-elle donc toujours la meilleure ? »
Le Premier ministre arménien a même fait du zèle, en allant jusqu’à abandonner la question du génocide arménien dans l’espoir de débloquer les relations avec Ankara. Officiellement, tout est fait pour favoriser la coopération régionale. Mais en réalité, l’enjeu central reste le corridor panturc de Zanguezour, un projet stratégique qui permettrait à l’Azerbaïdjan une continuité territoriale avec son exclave du Nakhitchevan mais aussi avec la Turquie, en traversant la province arménienne de Syunik.
Reste une dernière concession : l’engagement de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à abandonner leurs poursuites judiciaires internationales l’un contre l’autre. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les deux États s’accusent mutuellement d’exactions pendant la guerre de 2020, notamment d’exécutions extrajudiciaires et d’actes de torture. À la Cour internationale de justice, ils se reprochent des violations de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En renonçant à ces procédures, l’Arménie permettrait à Bakou d’imposer son récit du conflit. Une victoire diplomatique pour l’Azerbaïdjan, et un enterrement définitif de la justice.
La raison du plus fort est-elle donc toujours la meilleure ? Tandis que l’Arménie renonce à exiger justice, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se contente de suspendre la délégation de l’Azerbaïdjan, depuis janvier 2024. Quant au Parlement européen, il a voté le 13 mars 2025 une résolution qui « exige la libération immédiate et inconditionnelle » des otages arméniens qui sont « injustement maintenus en détention », ainsi que la suspension du partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie passé avec Bakou en juillet 2022. Mais ces mots suffisent-ils face à l’effacement d’un peuple ? Erevan, qui vise l’adhésion à l’Union européenne, attend de nous des actes, pas des discours.