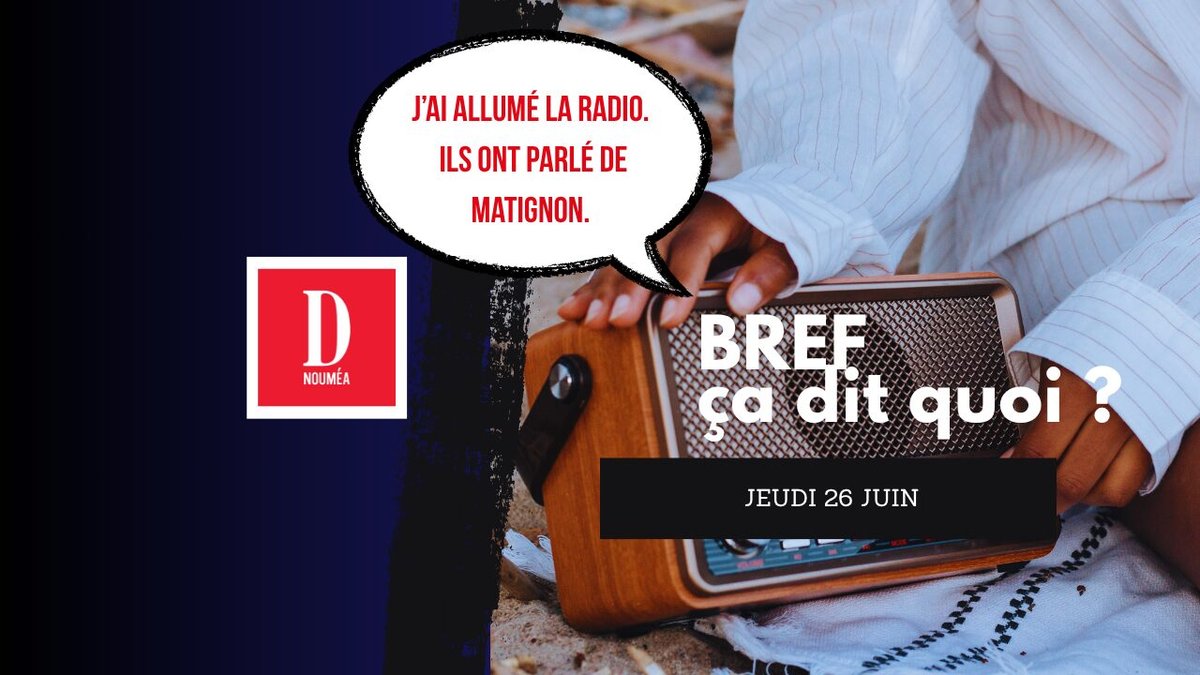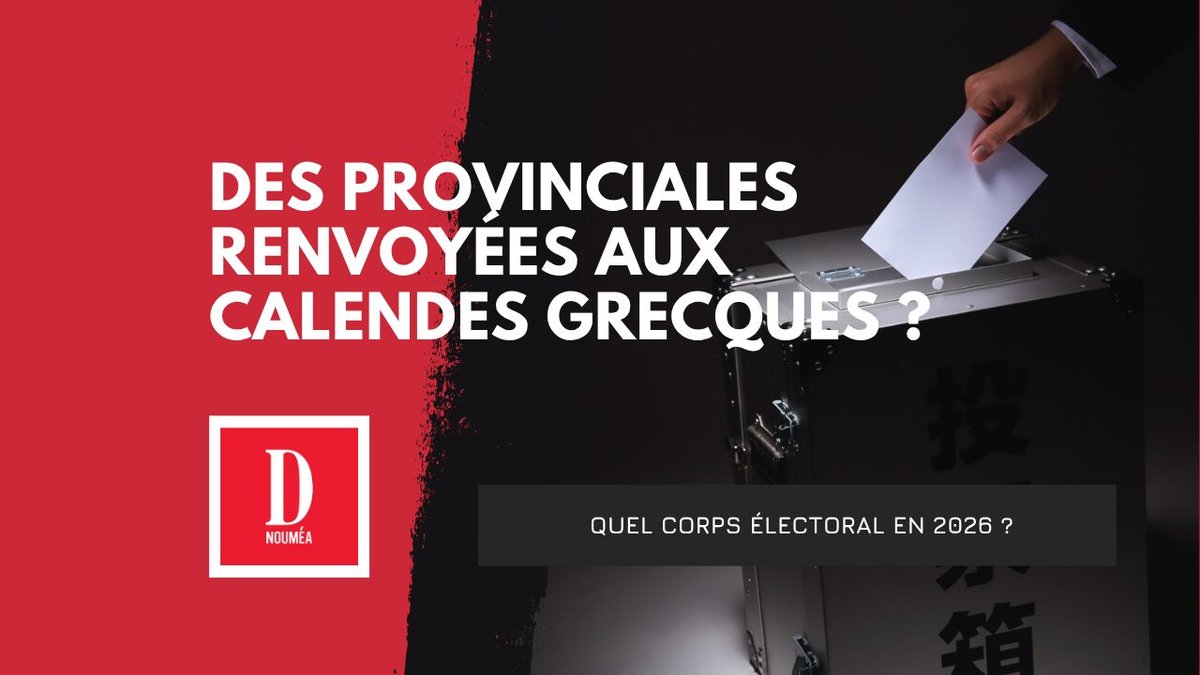Rififi autour de l’or bleu

Le Congrès adopte une loi inédite qui érige l’eau en patrimoine calédonien et en encadre strictement l’usage.
Une avancée législative majeure pour un bien commun menacé
Le 26 juin 2025, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a voté une loi du pays de rupture : désormais, l’eau devient un patrimoine commun des Calédoniens, bénéficiant d’un cadre juridique clair, contraignant et ambitieux. Ce texte s’inscrit dans un contexte d’urgence climatique et de pression croissante sur la ressource, et pose les bases d’un nouveau modèle de gestion durable.
C’est une bascule historique. Jusqu’alors, les cours d’eau, nappes souterraines et zones humides n’étaient que partiellement encadrés. Avec cette loi, l’usage de l’eau reste libre, mais il est désormais strictement régulé. Toute activité économique ou captage sur une portion du domaine public de l’eau nécessite une autorisation formelle. Des sanctions, y compris des amendes allant jusqu’à 20 millions CFP, sont prévues en cas de non-respect.
Une définition élargie et protectrice du domaine public de l’eau
Le texte instaure un « domaine public de l’eau » propre à la Nouvelle-Calédonie. Il comprend les rivières, nappes phréatiques, lacs et sources, à l’exclusion des zones entièrement situées sur terres coutumières, sauf accord spécifique. Cette précision a été au cœur des débats.
L’approche se veut écosystémique, intégrée « de la crête à l’embouchure ». Les eaux en terres coutumières pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de zones de gestion partagée entre autorités locales et représentants coutumiers. Un point qui a suscité de vives oppositions chez les élus Loyalistes, dénonçant un traitement jugé inégalitaire entre terres privées et coutumières.
Un socle de gouvernance renforcée : schémas, autorisations, contrôles
Pour piloter cette réforme, plusieurs outils opérationnels sont introduits :
- Un schéma d’orientation pays, qui fixe les grandes priorités (qualité de l’eau, partage équitable, sobriété).
- Des plans de gestion par bassin versant, pouvant limiter certains usages économiques comme l’exploitation minière ou agricole.
- Des périmètres de protection autour des captages d’eau potable, avec possibilité d’expropriation.
- Des servitudes obligatoires pour le passage, l’entretien et la surveillance des cours d’eau.
Chaque prélèvement ou installation doit être déclaré et peut être suspendu en cas d’atteinte à la ressource ou de manquement aux obligations de suivi. L’objectif : garantir un usage équitable, maîtrisé et contrôlé.
Une loi adoptée malgré les tensions politiques
Ce texte, préparé dès juin 2023 et déjà validé une première fois en avril 2025, a dû repasser devant le Congrès suite à une demande de réexamen des Loyalistes. En seconde lecture, il a été adopté à la majorité : 32 voix pour, 12 contre et 7 abstentions.
Certains élus ont souligné les imprécisions du texte, notamment sur la coordination entre coutumiers et institutions, ou sur les moyens de contrôle du gouvernement. Mais la plupart ont reconnu l’urgence à légiférer sur cette ressource vitale.
Une reconnaissance symbolique et culturelle forte
Au-delà de l’aspect technique, cette loi acte un tournant symbolique : l’eau est désormais consacrée comme un élément culturel, écologique et social majeur. Le texte reconnaît explicitement son rôle central dans les traditions kanak et océaniennes, ce qui confère à sa gestion une dimension collective et identitaire.
Les élus du boulevard Vauban, malgré les divergences, ont ainsi envoyé un signal clair : l’eau ne peut plus être traitée comme une ressource parmi d’autres. Elle devient un enjeu politique de premier ordre.
La Nouvelle-Calédonie fait face à une répartition inégale de la ressource en eau, due à un climat subtropical instable, aux cycles El Niño/La Niña et à la topographie de la Grande Terre. Cette situation est aggravée par des menaces croissantes : feux de brousse, espèces envahissantes, pollutions domestiques et industrielles (eaux rouges, rejets agricoles) et prélèvements excessifs.
Pour répondre à ces pressions multiples, la DAVAR (Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales) a lancé une vaste concertation avec les usagers. Objectif : construire une Politique de l’Eau Partagée (PEP) à l’échelle du territoire, pour une gestion durable et équitable de l’eau.
Une étape fondatrice, mais pas la dernière
Cette nouvelle législation représente l’un des jalons les plus structurants de la transition environnementale calédonienne. Elle répond à la nécessité de sécuriser juridiquement une ressource vitale, dans un territoire insulaire soumis à des tensions hydriques croissantes. Son application concrète, à partir du 1er janvier 2026, sera le véritable test de son efficacité.
Mais la bataille de l’eau ne fait que commencer : surveillance, concertation, sanctions, équilibre entre développement et préservation... Il faudra maintenir la pression pour que ce texte ne reste pas lettre morte.