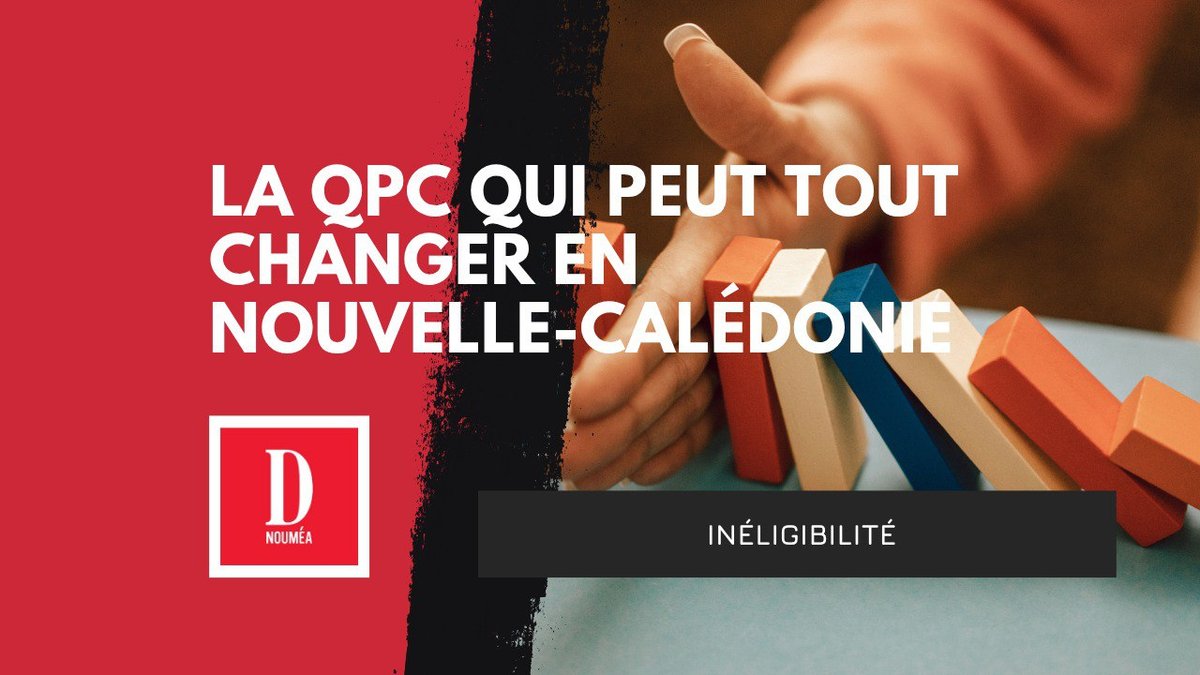Quand l’Angleterre tirait sur la France

Le 3 juillet 1940, la Royal Navy bombarde la flotte française à Mers el-Kébir. Une tragédie historique, entre stratégie et fracture.
Mers el-Kébir : le jour où les canons britanniques ont visé la France
Le 3 juillet 1940, à Mers el-Kébir, au large d’Oran, la Méditerranée est déchirée par un fracas d’acier et de feu. Des obus britanniques pulvérisent des cuirassés français, tuant 1 295 marins. Ce n’est pas l’ennemi allemand qui tire, mais l’ancien allié, l’Angleterre. L'opération, baptisée Catapult, visait à neutraliser la flotte française, que Londres craignait de voir tomber aux mains du IIIe Reich. C’est une fracture historique et diplomatique, restée longtemps tue dans les mémoires.
Une frappe stratégique, brutale et immédiate
L’ordre vient de Winston Churchill. La France a signé l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940. Pour Londres, le danger est immédiat : les puissants navires français mouillés à Mers el-Kébir risquent d’être récupérés par Hitler. Le Premier ministre britannique exige une reddition immédiate : rallier les ports britanniques, saborder les navires ou les livrer.
L’amiral Gensoul, commandant de la flotte française sur place, refuse d’obtempérer. À 17h54, les tourelles de la Royal Navy font feu. Le cuirassé Bretagne explose, le Dunkerque est gravement touché. En quelques minutes, près de 1 300 marins périssent, piégés à bord de navires français coulés... par une puissance alliée. L’objectif britannique est atteint : empêcher toute récupération par l’Axe, au prix d’un coup porté à la nation française elle-même.
L’onde de choc à Vichy : trahison, douleur et basculement
À Paris, Bordeaux puis Vichy, la stupeur est totale. La France, humiliée par la défaite et traversée par l’exode, encaisse cette attaque de plein fouet. La propagande allemande s’en empare : Mers el-Kébir devient un symbole de trahison britannique. À Vichy, l’épisode nourrit les discours favorables à la collaboration, présentée comme une protection face à une Angleterre devenue agressive.
Le choc psychologique est tel qu’il pèse dans le basculement institutionnel. Le 10 juillet 1940, cinq jours après le drame, l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, actant la fin de la Troisième République. L’attaque britannique, même si elle n’en est pas la cause unique, accélère le tournant autoritaire de Vichy.
Churchill et la realpolitik : une nécessité assumée
Pour Churchill, l’enjeu est existentiel. L’Angleterre est seule face à l’Axe, l’armée allemande domine l’Europe continentale, et les États-Unis sont encore loin d’entrer en guerre. Dans ses Mémoires, le Premier ministre britannique qualifie Catapult de « douloureuse, mais vitale ». Son calcul est simple : sans flotte, Hitler est affaibli, et les alliés éventuels savent à quoi s’en tenir. Une frappe claire, même contre un ancien compagnon d’armes, vaut mieux qu’un risque stratégique.
Mais le prix humain et politique est immense. Londres sacrifie sa relation avec Vichy et provoque une rupture qui prendra des décennies à cicatriser. Si les Forces françaises libres de Gaulle renouent un lien militaire avec l’Angleterre, la confiance est ébranlée.
Une blessure enfouie, une mémoire silencieuse
Mers el-Kébir reste un angle mort de la mémoire française. L’événement est peu enseigné, rarement commémoré. Trop douloureux, trop ambivalent. Une attaque interalliée, un drame fratricide, une décision de guerre qui contredit les récits simplifiés des années 40.
Il faut attendre 2005 pour qu’un hommage britannique officiel soit rendu aux marins français tombés à Mers el-Kébir. Une cérémonie discrète mais essentielle, dans une volonté de mémoire partagée. Mais le traumatisme reste profond. Côté britannique, on parle d’efficacité militaire. Côté français, d’une trahison en pleine débâcle.
Le 3 juillet 1940, la France pleurait ses marins, et la Grande-Bretagne affirmait sa détermination. Dans les eaux de Mers el-Kébir, la guerre a balayé l’alliance, et scellé un épisode sombre de notre histoire commune.