Nouméa empoisonnée : l’autre bilan des émeutes
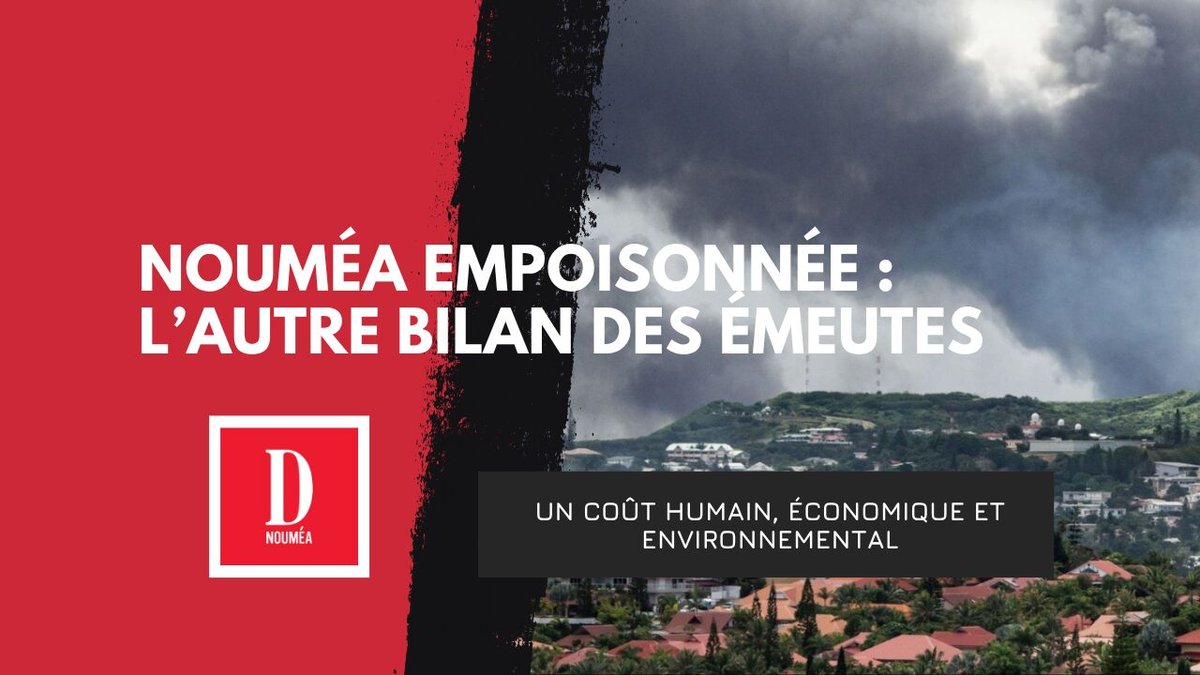
Les émeutes de mai 2024 à Nouméa ont provoqué une pollution de l’air inédite, liée aux nombreux incendies, avec des risques sanitaires durables.
Un traumatisme invisible : l’impact sanitaire des émeutes sur la qualité de l’air
Derrière les carcasses calcinées et les ruines des bâtiments incendiés, un danger plus sournois s’est installé dans les quartiers du Grand Nouméa : la pollution atmosphérique. De mai à juillet 2024, les émeutes qui ont embrasé la capitale calédonienne ont laissé dans leur sillage des concentrations anormales de particules fines, de métaux lourds et de substances chimiques toxiques, potentiellement dangereuses pour la santé des populations et l’environnement.
Sollicité par le gouvernement, l’organisme Scal’air vient de publier un rapport inédit sur la qualité de l’air durant cette période critique. Si aucun seuil réglementaire n’a été formellement franchi pour certains polluants, les experts tirent néanmoins la sonnette d’alarme : 21 épisodes de pollution atmosphérique ont été enregistrés, dont un dépassement du seuil d’alerte — une première depuis 2019.
Nouville, Montravel, Logicoop : les quartiers les plus touchés
L’analyse de Scal’air repose sur les données relevées entre mai et juillet 2024 par sept stations de mesure réparties dans Nouméa, avec une concentration particulière sur les zones sinistrées. Cinq quartiers ont été fortement impactés : Montravel, la Vallée-du-Tir, N’Du, Nouville et Logicoop, avec plusieurs dépassements du seuil d’information et de recommandation — indicateur d’un risque pour les personnes sensibles.
Un seul dépassement du seuil d’alerte a été enregistré à l’Anse N’Du le 15 mai, quelques jours après les premières grandes flambées. Ce niveau, rarement atteint, traduit un danger sanitaire pour l’ensemble de la population, sans distinction.
Des polluants invisibles mais persistants
Les données de terrain sont sans équivoque : les incendies ont libéré des substances rarement observées à Nouméa en temps normal. Outre les particules fines, le plomb, l’arsenic, le cadmium, l’antimoine ou encore l’étain ont été détectés à des niveaux deux à dix fois supérieurs aux mesures habituelles, même si les seuils réglementaires n’ont pas été officiellement dépassés.
Mais ce n’est pas tout. Le rapport évoque également la présence probable de dioxines et de furanes, deux familles de composés organiques extrêmement toxiques, suspectées de persister dans l’environnement pendant des décennies. En l’absence de capteurs spécifiques et de moyens d’intervention en temps réel pendant les trois premières semaines d’émeutes, ces polluants n’ont pas pu être mesurés dans l’air ambiant. « Ces substances pourraient avoir contaminé les sols, les eaux et une partie de la chaîne alimentaire », prévient le rapport.
Pollution post-émeutes : des zones entières hors radar et un port sous surveillance
Malgré l’ampleur des incendies, le réseau de surveillance de la qualité de l’air reste insuffisant. Plusieurs quartiers durement touchés, comme Rivière-Salée ou Ducos, ne sont pas équipés de capteurs, empêchant toute évaluation précise de la pollution. Les fumées, poussées par les vents, ont pourtant pu atteindre des zones sensibles comme le lagon. Une modélisation a bien été réalisée, mais elle reste incomplète et imprécise. En parallèle, une première campagne de mesure a été lancée autour du port, révélant des taux de plomb élevés. Scal’air recommande d’adapter les infrastructures maritimes pour limiter les émissions, notamment via des navires à propulsion hybride.
Santé publique : les recommandations de Scal’air
Le dépassement du seuil d’alerte impose des gestes de précaution immédiats. En cas de pic de pollution, Scal’air recommande d’éviter toute activité sportive en extérieur, surtout pour les enfants, et de surveiller l’apparition de symptômes respiratoires. Tabac, solvants ou produits irritants sont à proscrire. Même pour les seuils d’information, les personnes fragiles sont appelées à rester vigilantes.
Mais au-delà de ces recommandations ponctuelles, le rapport pointe l’absence criante de moyens structurels. Scal’air ne dispose ni des équipements, ni des ressources humaines nécessaires pour suivre l’impact environnemental à long terme, pourtant essentiel pour évaluer les conséquences des émeutes sur la santé des Calédoniens.

