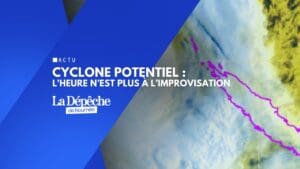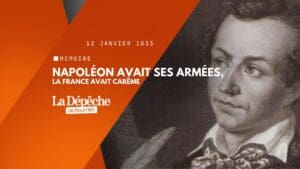Avant 1965, une femme mariée ne valait guère mieux qu’un mineur. Elle ne pouvait ni travailler, ni ouvrir un compte sans l’accord de son mari. Le 13 juillet 1965, l’État recule enfin : les femmes arrachent leur autonomie, après plus d’un siècle de soumission légale.
Un siècle de tutelle : quand la loi décidait pour les femmes
Pendant plus de 160 ans, une femme mariée était considérée comme une mineure juridique. Le Code Napoléon de 1804 instaurait un régime patriarcal strict : la femme devait obéissance à son mari et ne pouvait ni signer un chèque, ni ouvrir un compte bancaire sans son autorisation. Une véritable tutelle, qui s’est perpétuée jusque dans les années 1960. Si quelques avancées ont été obtenues — comme l’ouverture d’un livret d’épargne en 1881, le droit de disposer de son salaire en 1907, ou la levée de l’incapacité juridique en 1938 — toutes restaient fragiles face à l’arbitraire conjugal.
L’administration, les banques et la société maintenaient les femmes dans un statut d’infériorité. En clair : elles pouvaient gagner leur vie, mais ne pouvaient pas en disposer librement. Même au sortir de la guerre, malgré la création des « comptes ménagers » et un timide accès au chéquier, la femme restait subordonnée à son époux, notamment pour exercer une activité professionnelle.
Pompidou, de Gaulle et les urnes : une loi électorale et historique
En 1965, la France entre dans une nouvelle ère : pour la première fois, le président est élu au suffrage universel direct. Le général de Gaulle, soucieux de séduire l’électorat féminin, fait voter une réforme capitale du régime matrimonial. Portée par le garde des Sceaux Jean Foyer et adoptée dans un contexte politique dominé par la droite, cette loi du 13 juillet 1965 bouleverse l’ordre établi : les femmes peuvent désormais travailler, ouvrir un compte bancaire, signer un bail ou acheter un bien sans l’autorisation de leur mari.
Cette décision résonne comme un séisme dans les foyers français. Elle entérine l’autonomie juridique des femmes mariées et les place, enfin, sur un pied d’égalité avec les hommes. Le choix du régime de la communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial par défaut ancre aussi dans la loi une vision plus égalitaire du couple. En d’autres termes, ce que chacun gagne ou acquiert durant le mariage est géré à parts égales.
Une étape cruciale vers l’émancipation totale des femmes
La loi du 13 juillet 1965 est bien plus qu’une simple réforme technique : elle constitue le pilier fondateur de l’indépendance économique des femmes en France. Elle marque le début d’une accélération législative qui mènera à la fin de la notion de chef de famille en 1970, puis à la légalisation du divorce par consentement mutuel en 1975.
Portée par un mouvement féministe naissant, cette dynamique va transformer radicalement les rapports entre hommes et femmes dans la société française. Le travail féminin, devenu plus massif, s’impose comme une évidence. L’idée qu’une femme puisse dépendre financièrement de son mari devient, peu à peu, socialement obsolète. En brisant la tutelle maritale, cette loi rend possible la conquête de tous les autres droits : contraception, avortement, égalité salariale…
Mais si l’émancipation bancaire commence en 1965, le combat pour l’égalité réelle se poursuit encore aujourd’hui. Les écarts de salaire, les inégalités dans la charge mentale ou encore les violences économiques au sein des couples rappellent que le patriarcat ne s’est pas effondré du jour au lendemain. La date du 13 juillet reste pourtant un jalon fondamental dans l’histoire de la libération féminine en France.