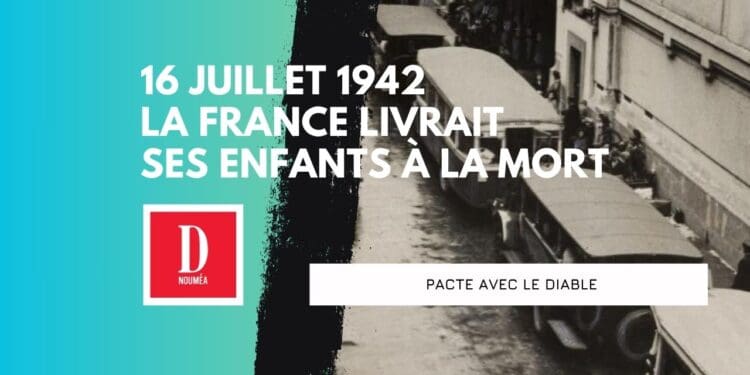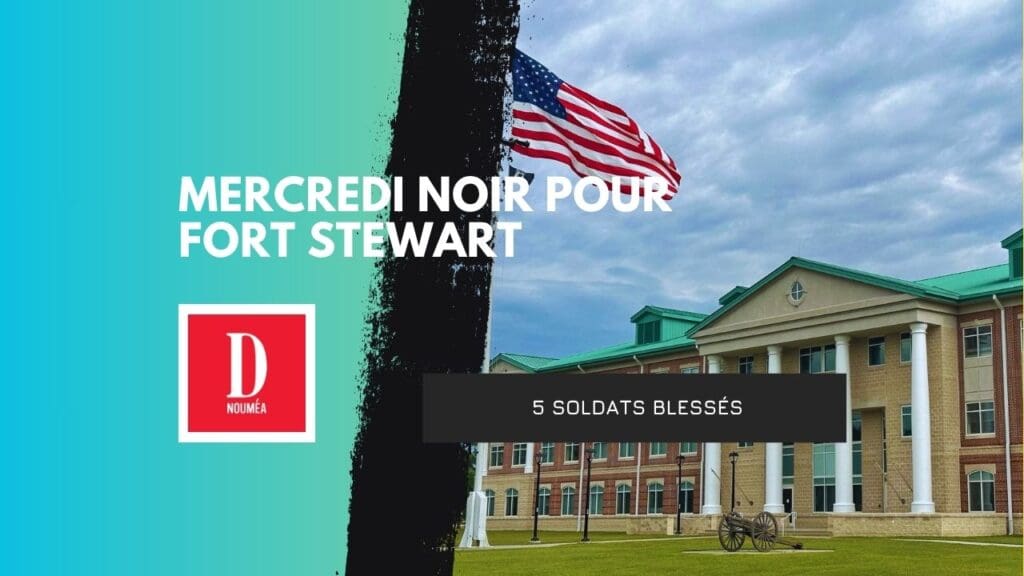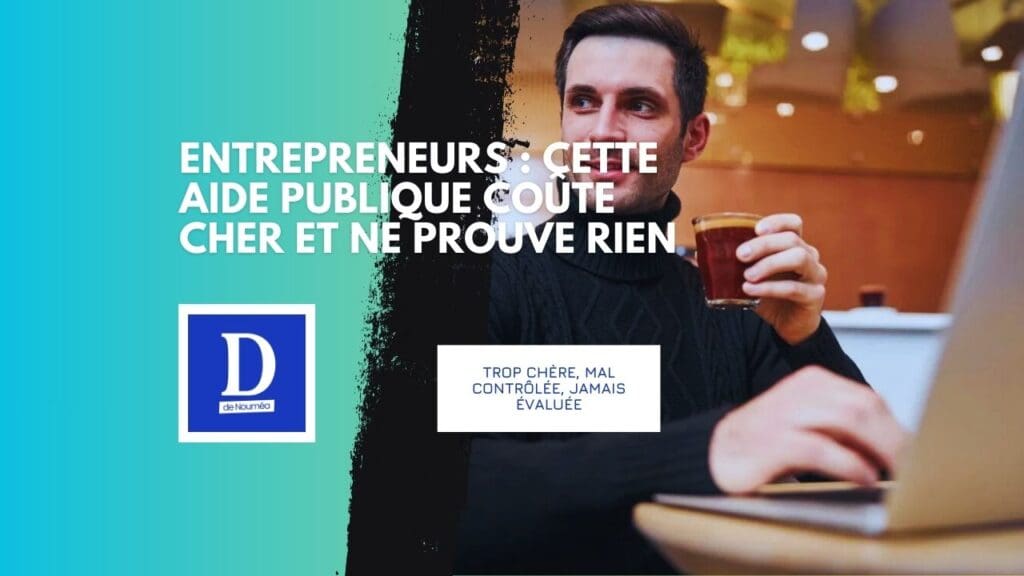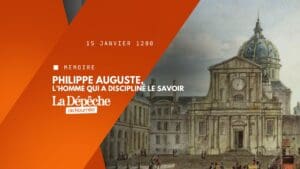Il y a 83 ans, la police parisienne arrêtait 13 152 Juifs, dont 4 000 enfants, pour les livrer aux nazis. L’État français, complice, a scellé le sort de milliers d’innocents.
L’opération « Vent printanier » : Vichy au service de la Solution finale
Le 16 juillet 1942, à l’aube, des milliers de policiers français encerclent les immeubles de Paris. Munis de listes précises, ils arrêtent plus de 13 000 Juifs, dont des femmes, des vieillards, et surtout 4 115 enfants, souvent nés en France. Cette opération massive, cyniquement baptisée « Vent printanier », est orchestrée par les nazis, mais exécutée presque exclusivement par les forces de l’ordre françaises.
L’accord entre René Bousquet, chef de la police de Vichy, et l’occupant allemand a été conclu début juillet. Il prévoit l’arrestation de 40 000 Juifs, dont une première vague de 25 000 en région parisienne. Les cibles sont des apatrides, des réfugiés d’Europe centrale et orientale, mais aussi, de facto, leurs enfants français. Le Vélodrome d’Hiver, dans le XVe arrondissement, devient alors un camp de triage improvisé où l’inhumanité culmine.
L’objectif nazi est clair : appliquer la Solution finale à l’Ouest. À Paris, cela signifie entasser des familles dans des bus, les parquer au Vél’ d’Hiv, puis les déporter à Auschwitz-Birkenau. Les conditions de détention dans le vélodrome sont inhumaines : sans eau, sans nourriture, sans sanitaires. Les cris des enfants répondent aux pleurs des mères. Plusieurs détenus se suicident.
13 152 arrestations, 3 000 enfants déportés : l’horreur en chiffres
La rafle du Vél’ d’Hiv constitue l’une des plus grandes arrestations de Juifs en Europe de l’Ouest. En cinq jours, 13 152 personnes sont arrêtées. Du 19 au 22 juillet, elles sont transférées dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Les adultes partent d’abord à Auschwitz. Les enfants, abandonnés, enfermés, pleurant leurs parents, suivront quelques semaines plus tard.
Le régime de Vichy s’est pourtant défendu, à l’époque, d’avoir agi de son propre chef. Il prétexta le souci de ne pas séparer les familles pour justifier l’arrestation des enfants – un mensonge d’État. À cette date, les fours crématoires d’Auschwitz ne sont pas encore tous opérationnels, mais la logique génocidaire est déjà à l’œuvre. Vichy livre, Berlin extermine.
Ce n’est pas seulement la zone occupée qui est touchée : 10 000 Juifs sont arrêtés en zone libre à partir d’août 1942, preuve que la France n’avait nul besoin des Allemands pour déporter.
Une mémoire nationale longtemps occultée
Il faut attendre 1995 pour que la République française reconnaisse sa responsabilité, par la voix de Jacques Chirac. Dans un discours désormais historique, il déclare que « la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable ». Mais pour des juristes comme Robert Badinter, le mot “France” ne suffit pas : il fallait dire la France de Vichy. En effet, une autre France – celle de Londres, des villages résistants, des Justes – tentait de sauver les persécutés.
Pendant des décennies, la mémoire de la rafle fut surtout portée par les associations juives, puis par des historiens comme Serge Klarsfeld et Robert Paxton. Les procès Barbie, Touvier ou Papon ont ravivé cette mémoire douloureuse.
En 2000, une loi institue le 16 juillet comme Journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l’État français. Depuis, des lieux de mémoire ont vu le jour à Drancy, à Orléans, à Pithiviers. À Paris, un jardin dédié aux 4 115 enfants raflés a été inauguré en 2017, près du boulevard de Grenelle, où se dressait autrefois le Vélodrome d’Hiver.
La mémoire s’est inscrite dans la pierre, mais surtout dans les consciences. Aujourd’hui, alors que les derniers témoins disparaissent, c’est à l’école, aux musées, aux films, aux livres, qu’il revient de transmettre.
Car le souvenir de cette rafle n’est pas une simple page d’histoire. C’est un avertissement vivant, une alarme contre le retour des haines identitaires, contre l’effacement du passé. La Shoah fut planifiée, industrialisée, organisée – mais en France, elle fut aussi facilitée.