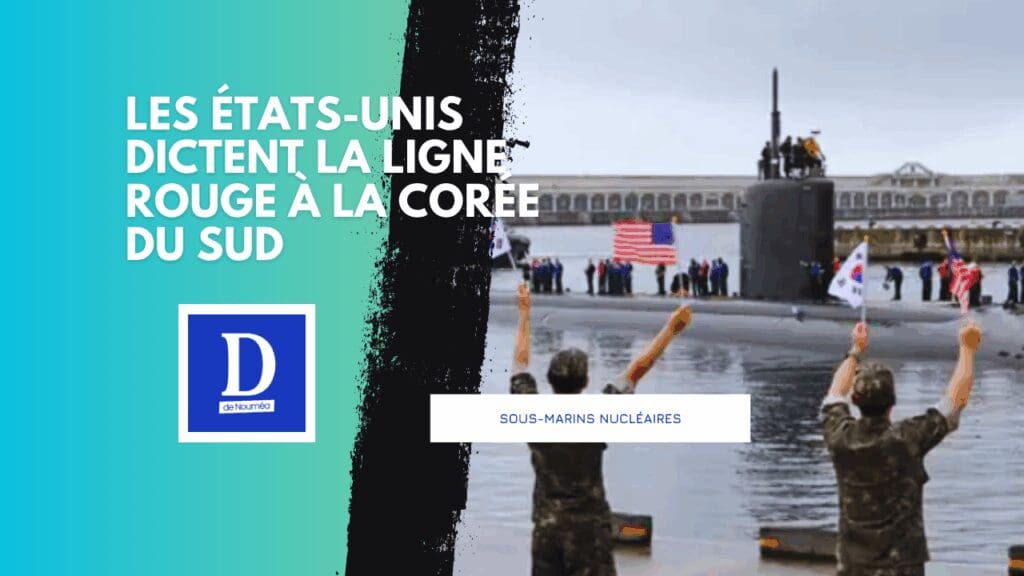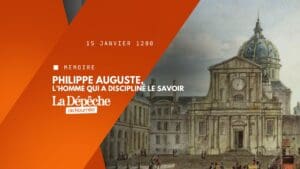À l’aube de la Grande Guerre, un bouleversement fiscal historique voit le jour : l’impôt progressif sur le revenu. Mais derrière cette réforme majeure se cache un compromis explosif, mêlant scandales, manœuvres politiques et pressions militaires.
Un impôt de rupture dans une France figée
En juillet 1914, la France est à un tournant historique. Son système fiscal repose toujours sur les « quatre vieilles » contributions issues de la Révolution : contribution foncière, mobilière, patente et impôt sur les portes et fenêtres. Un système à la fois archaïque, injuste et inefficace, alors que les grandes puissances, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, ont déjà instauré des impôts modernes sur les revenus.
Joseph Caillaux, ministre des Finances à plusieurs reprises, tente depuis 1907 de faire passer une réforme ambitieuse, inspirée de l’income tax britannique. Son projet repose sur trois piliers :
-
des impôts cédulaires sur les différentes sources de revenu,
-
un impôt progressif sur le revenu global,
-
et une déclaration fiscale contrôlable, jugée alors intrusive par les élites conservatrices.
Mais l’idée d’un impôt personnalisé et progressif déclenche une levée de boucliers. Les conservateurs crient à l’« inquisition fiscale », tandis que les ligues de contribuables, soutenues par Le Figaro, dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. Le Sénat, dominé par la droite, bloque systématiquement les projets adoptés par la Chambre des députés.
Scandale, crime d’honneur et compromis tragique
À l’approche des élections de 1914, le climat politique est électrique. Caillaux, donné favori, prône la fin de la loi des trois ans et l’instauration de sa réforme fiscale majeure. La droite lance alors une campagne médiatique féroce. Le 13 mars, Le Figaro publie une lettre compromettante, dans laquelle Caillaux se vante d’avoir bloqué l’impôt tout en prétendant le soutenir.
Quelques jours plus tard, c’est le drame : Henriette Caillaux, son épouse, assassine Gaston Calmette, directeur du Figaro. Le scandale est national. Caillaux est contraint à la démission. Son remplaçant, René Renoult, reporte l’examen du projet fiscal.
Mais la situation budgétaire se dégrade. Le service militaire porté à trois ans, ajouté au réarmement massif, face à la montée des tensions européennes font exploser les dépenses publiques. Un compromis inattendu s’esquisse : le Sénat accepte enfin de discuter l’impôt sur le revenu, en échange du maintien du service militaire à trois ans.
Le texte est débattu au Sénat à partir du 3 juillet, douze jours après l’attentat de Sarajevo, sans que personne ne mesure l’ampleur de ce qui s’annonce. Le 15 juillet 1914, après plus de 60 ans de débats parlementaires, la loi instaurant un impôt progressif sur l’ensemble des revenus est adoptée.
Une victoire incomplète balayée par la guerre
La loi du 15 juillet 1914 est votée, mais elle est profondément édulcorée :
-
taux d’imposition plafonné à 2 %,
-
déclaration de revenus facultative,
-
exonérations pour charges de famille,
-
suppression des impôts cédulaires prévue, mais pas immédiate.
Le compromis est fragile, imparfait, mais symbolique. Il consacre enfin un principe d’égalité devant l’impôt. Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, la guerre éclate. Les chambres, réunies en Union sacrée, suspendent leurs travaux.
L’application de l’impôt est reportée. Mais les besoins de financement de la guerre rendent son instauration inévitable. En 1916, un décret permet une première application de l’impôt sur les revenus de 1915. En 1917, une loi introduit un système mixte, combinant impôts cédulaires et impôt global progressif.
Ce long combat pour une fiscalité plus juste, mené contre vents et marées par Caillaux, Jaurès et les radicaux, n’a pas été vain. Il a redéfini le lien entre citoyen et État, jetant les bases d’une fiscalité moderne fondée sur la solidarité nationale, même si la guerre en a profondément modifié les contours.
L’impôt sur le revenu, voté dans l’urgence et dans la douleur à la veille de 1914, n’était pas seulement un outil fiscal. Il incarnait un idéal républicain, celui d’un État juste, où chacun contribue selon ses moyens.
Mais son histoire démontre à quel point les réformes fiscales sont aussi des batailles politiques, idéologiques et humaines.