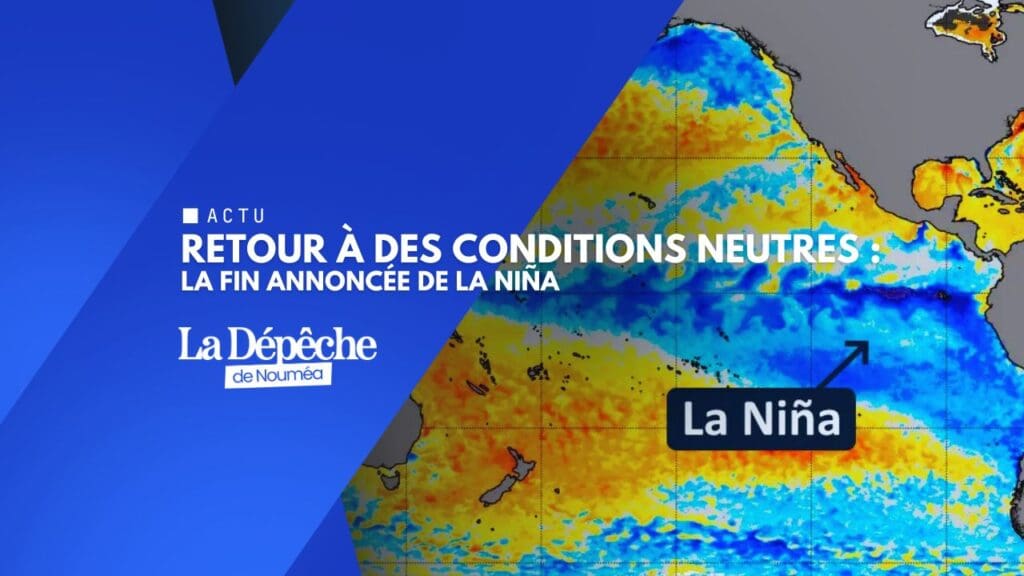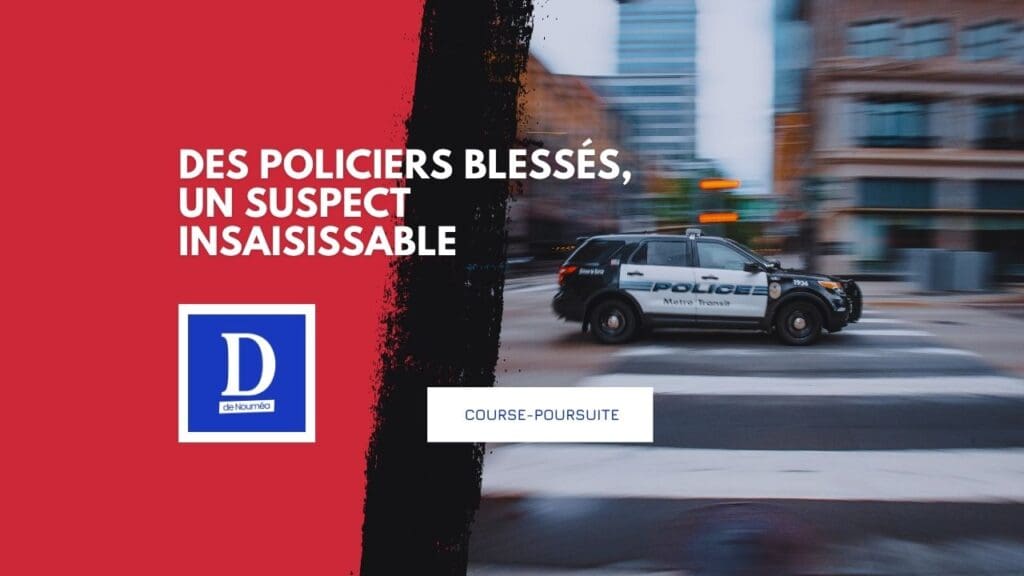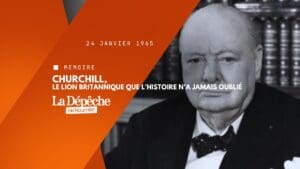Tandis que de premières mesures d’attractivité sont enfin votées, les aides-soignants du Médipôle se sentent ignorés. En débrayant ces derniers mois, ils rappellent leur place dans la chaîne de soins.
Une première victoire syndicale pour les métiers en tension
Le 18 juillet, un texte a été adopté par le Comité Supérieur de la Fonction Publique (CSFP) pour répondre à la crise aiguë qui secoue les hôpitaux calédoniens depuis mai. Il prévoit :
-
une bonification de deux ans pour les agents fonctionnaires en poste avant 2024 ;
-
une prime de stabilité pour les soignants des catégories A et B ;
-
et l’ouverture d’un chantier sur le temps de travail et les grilles salariales, dès le 30 juillet.
Ces mesures ont été obtenues sous la pression des mobilisations massives du 6 mai, où plus de 300 professionnels s’étaient réunis devant le Médipôle pour dénoncer la surcharge de travail, l’exode du personnel et des conditions indignes.
Le gouvernement, après des mois de surdité, a dû réagir. Il s’est engagé à poursuivre le dialogue avec les syndicats, en promettant des évolutions ciblées sur les secteurs les plus en tension.
Les aides-soignants en grève éclair pour dénoncer leur invisibilité
Mais ces avancées laissent une partie du personnel sur le bord du chemin. Le 11 juin, à l’appel de la section USTKE du Médipôle, une partie des 384 aides-soignants a organisé un débrayage symbolique de 55 minutes, en blouse ou en civil, pour exprimer un sentiment profond d’exclusion.
Alors que les infirmiers, sages-femmes et médecins négocient avec la direction, les aides-soignants ne sont pas invités à la table. Pourtant, ils représentent un maillon essentiel du système hospitalier, en première ligne au chevet des patients, notamment dans les services les plus sensibles comme les urgences ou la gériatrie. Sylvie, aide-soignante qui a commencé au CHT Gaston-Bourret et qui a vu le Médipole de Koutio sortir de terre :
Ça fait vingt-trois ans que je travaille ici. J’ai vu le Médipôle sortir de terre. J’ai accompagné des milliers de patients. J’ai veillé des nuits entières à calmer des douleurs, des angoisses, des fins de vie. Et aujourd’hui, j’ai l’impression d’être devenue invisible. Je suis fatiguée, physiquement et moralement. À 50 ans, j’arrive au bout de ce que je peux encaisser.
En Nouvelle-Calédonie, ils seraient entre 500 et 600, mais leur statut reste figé, sans reconnaissance officielle en catégorie B, contrairement à leurs homologues de l’Hexagone depuis 2021. Ni revalorisation de leur point d’indice, ni accès facilité à la formation infirmière, ni reconnaissance de leur compétence de terrain, pourtant parfois sollicitée pour pallier le manque d’infirmières.
La colère s’accumule, portée par des slogans aussi directs que révélateurs :
2020 héros, 2025 zéros
Ils demandent à évoluer, à être formés, à être considérés.
Le silence institutionnel à leur égard est perçu comme une injure.
Un système toujours au bord de l’asphyxie
Malgré les gestes du gouvernement, la situation sanitaire reste tendue. Le Médipôle manque toujours de plus de 200 soignants paramédicaux, les heures de récupération s’empilent, les services tournent en flux tendu. Les personnels restants encaissent, compensent, et s’épuisent.
La Fédération des professionnels libéraux de santé (FPLS) soutient la mobilisation, appelant à la généralisation du télésoin pour contrer la désertification médicale et soulager les hôpitaux. Mais sans action structurelle, l’exode continue. Les jeunes diplômés refusent de rester, les anciens quittent le navire.
Et si la priorité est aujourd’hui donnée aux métiers en tension, ignorer les aides-soignants revient à fragiliser toute la chaîne de soin. Ces agents, en contact permanent avec les patients, assurent souvent un rôle de soutien psychologique, de lien humain, voire de référent affectif. Les faire taire, c’est faire taire ceux qui incarnent au quotidien la dignité des soins.
La reconnaissance partielle votée le 18 juillet est une avancée. Elle prouve que la pression sociale et syndicale paie. Mais le cas des aides-soignants souligne une dérive inquiétante : celle d’un système à deux vitesses, où seuls les métiers en tension obtiennent des droits, pendant que les autres attendent dans l’ombre.
Si l’exécutif veut éviter une rupture globale du pacte sanitaire calédonien, il devra étendre le dialogue à tous les acteurs de l’hôpital, sans hiérarchie ni oubli. Car l’avenir de la santé en Nouvelle-Calédonie ne se négocie pas en comité restreint.