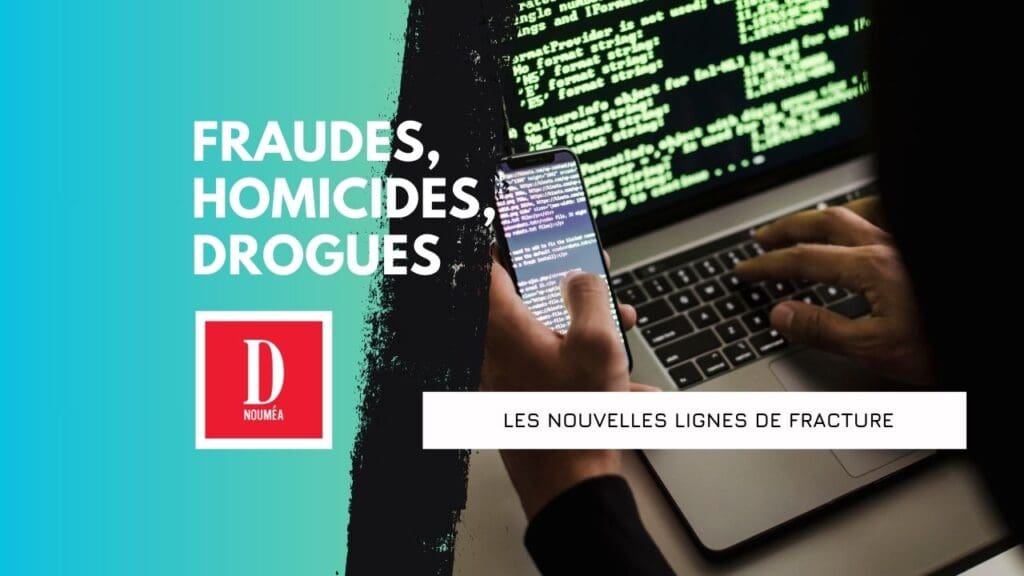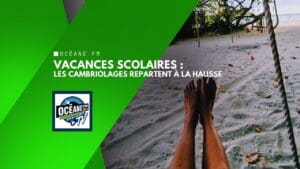C’est un tournant majeur dans la gouvernance du numérique en France. Le Conseil national du numérique change de nom et de cap.
Un organe repensé pour répondre à l’urgence de l’intelligence artificielle
Le Conseil national du numérique n’est plus. Il devient le Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique, reflet d’une volonté politique claire : reprendre la main face à la révolution IA. Car les technologies évoluent vite, très vite. Trop vite pour rester sur les structures de 2011.
Désormais, les usages de l’IA, la souveraineté technologique, la soutenabilité numérique, ou encore la protection des mineurs en ligne sont au cœur de la feuille de route. Un plan d’action piloté par un collège de 17 experts issus de la recherche, du Parlement et du monde économique, avec à sa tête Anne Bouverot (ex-Orange, ENS) et Guillaume Poupard (ex-ANSSI, Docaposte).
Dans un contexte géopolitique instable, où la bataille de l’IA se joue aussi à l’échelle mondiale, ce virage institutionnel n’est pas qu’un changement de nom : c’est une tentative de réponse à la déferlante technologique et à ses conséquences sociales, éthiques et stratégiques. Le Conseil devra, selon les mots mêmes de la ministre Clara Chappaz, alerter, nourrir le débat public, proposer une vision ambitieuse… et oser la confrontation d’idées.
Une ambition affichée, mais des angles morts persistants
Derrière les grands discours, certaines inquiétudes émergent déjà. L’environnement numérique, mentionné une seule fois dans les annonces, semble relégué au second plan. Pourtant, la soutenabilité de nos systèmes numériques est cruciale, dans un monde où les data centers explosent, où les équipements se multiplient, et où l’empreinte carbone du numérique dépasse celle de l’aviation civile.
Autre angle mort pointé par plusieurs acteurs : l’inclusion numérique. Certes, une représentante d’Emmaüs Connect siège dans le Conseil. Mais aura-t-elle le poids politique nécessaire pour porter ces enjeux ? Les Maisons France Services ont failli perdre leur budget, malgré leur rôle central dans l’accompagnement des publics fragiles. Former les citoyens aux nouveaux usages induits par l’IA est un impératif démocratique. Mais il semble encore relégué à la périphérie des priorités, dans une approche très top-down de la transformation numérique.
Enfin, l’absence d’une vision européenne structurée laisse perplexe. L’IA ne connaît pas de frontière, et les enjeux d’autonomie stratégique, de standardisation, de régulation se jouent d’abord à Bruxelles, pas à Paris. Le Conseil saura-t-il impulser une réflexion intégrée, audacieuse, au-delà du prisme franco-français ? Rien n’est moins sûr à ce stade.
Pour que les intentions deviennent actes : le défi de l’indépendance
Ce nouveau Conseil, s’il veut exister autrement que sur le papier, devra éviter l’écueil de l’ethic washing. Trop souvent, les belles intentions affichées – « remettre l’humain au centre », « ouvrir le débat », « penser l’éthique » – masquent une volonté d’éviter la régulation, voire de laisser le champ libre aux industriels. L’histoire du numérique en France regorge de comités consultatifs édulcorés, sans réelle capacité à infléchir les politiques publiques.
La légitimité du Conseil dépendra donc de sa capacité à proposer une pensée complexe, transversale, ancrée dans les sciences humaines autant que dans la tech. Il ne s’agit pas seulement de mieux coder, mais de comprendre les effets sociaux, politiques, culturels des technologies déployées. Et pour cela, il faudra aussi écouter les chercheurs, les sociologues, les anthropologues, ceux qui scrutent nos usages réels, nos résistances, nos transformations silencieuses.
La bataille de l’intelligence artificielle ne se gagnera pas seulement avec des ingénieurs. Elle exige un contre-pouvoir démocratique fort, lucide, intransigeant. Et si ce nouveau Conseil veut s’imposer comme tel, il lui faudra faire preuve d’une indépendance sans faille, quitte à déranger.
C’est à ce prix que l’État regagnera sa place face aux géants du numérique.