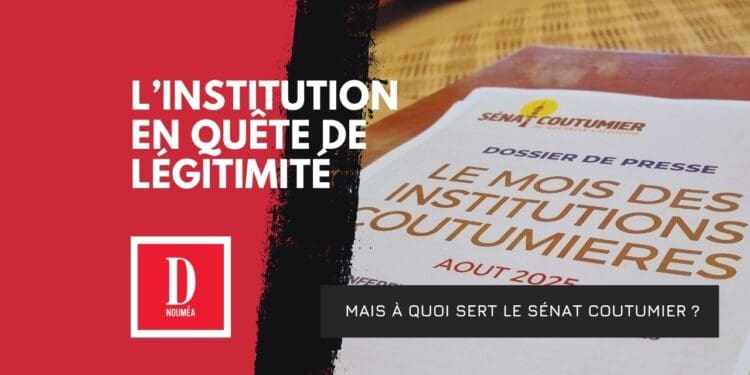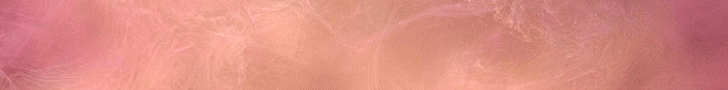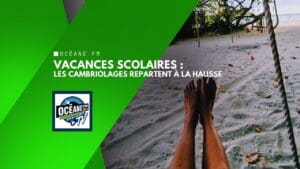Le Sénat coutumier lance en fanfare son Mois des institutions coutumières. Mais une autre voix s’élève, plus radicale et tout aussi ancestrale : celle d’Inaat Ne Kanaky, qui accuse l’institution officielle de confisquer la parole des chefferies.
Un mois coutumier pour repositionner le Sénat
À un mois de la fin de sa mandature, le Sénat coutumier veut frapper fort. L’événement-phare du mois d’août — le Mois des institutions coutumières — vise à réaffirmer le rôle politique et culturel des représentants coutumiers, dans un contexte incertain marqué par l’Accord de Bougival. Six événements, des débats et des annonces politiques ponctueront cette séquence stratégique.
Les sénateurs souhaitent clarifier leur lecture du texte de Bougival, jugé opaque, voire dangereux, pour l’avenir du peuple kanak. Le 8 août, l’Assemblée générale des huit pays kanak synthétisera les 27 ans de mandatures coutumières, depuis 1998, avant de déboucher sur une prise de position commune au Congrès du Pays Kanak des 29 et 30 août. L’objectif est clair : peser sur la future organisation institutionnelle du territoire et défendre une identité kanak inclusive, ancrée dans ses valeurs et capable d’interpeller la République.
Une contestation frontale portée par Inaat Ne Kanaky
Mais cette démonstration d’unité est minée par une contestation venue de l’intérieur même du monde coutumier. Le collectif Inaat Ne Kanaky, regroupant plusieurs autorités coutumières dissidentes, remet frontalement en cause la légitimité même du Sénat coutumier, créé dans le cadre de l’Accord de Nouméa.
Les institutions coutumières ont été mises en place pour confisquer le pouvoir des autorités coutumières. Elles ne nous représentent pas , a lancé récemment Hippolyte Sinewami, grand chef de La Roche et porte-parole du mouvement.
Pour Inaat Ne Kanaky, la vraie légitimité vient des chefferies traditionnelles, et non d’un Sénat coutumier trop aligné sur les logiques institutionnelles calédoniennes.
Ce discours porte une charge politique lourde. Il jette une ombre sur les prises de position du Sénat, notamment sur Bougival, et fragilise sa capacité à parler au nom de l’ensemble du monde coutumier kanak. Il souligne également les fractures profondes entre une coutume reconnue par les accords politiques, et une coutume revendiquée dans sa souveraineté ancestrale directe, hors du cadre républicain.
Identité, transmission, souveraineté : la coutume en tension
Malgré les remous, le Sénat coutumier veut recentrer le débat sur l’essentiel : les valeurs, la transmission et la terre. Deux projets de loi du pays sont en gestation : l’un sur la reconnaissance juridique des chefferies, l’autre sur la redéfinition du corps électoral coutumier pour désigner les sénateurs. Une manière de répondre, en creux, aux critiques sur son mode de désignation.
La valorisation de l’igname, socle symbolique de la société kanak, incarne cette volonté de retour aux fondements. La semaine du 11 août, au Conservatoire de l’igname, cent cinquante-trois variétés seront mises à l’honneur, et une vente de semences sera organisée.
Plus qu’une animation culturelle, c’est un acte politique : la souveraineté commence par la terre et la transmission.
Mais ce retour aux sources ne suffit pas à éteindre la contestation. La fracture est là, entre une institution reconnue par l’État et un courant coutumier qui réclame une indépendance complète, dans la parole comme dans l’organisation. Le Mois des institutions coutumières, conçu comme un temps d’unité, met donc aussi en lumière les tensions et les lignes de rupture au sein du monde coutumier.
Le Mois des institutions coutumières devait réaffirmer la légitimité du Sénat dans un moment charnière. Il devient, malgré lui, un révélateur des failles internes et des enjeux de représentativité. Entre volonté de dialogue avec la République et réaffirmation d’une parole kanak authentique et radicale, la coutume se cherche, se déchire et tente de se reconstruire.
Face à Bougival, à la réforme des institutions et aux aspirations du peuple kanak, une question persiste : qui parle au nom de la coutume ? Et qui l’écoute encore ?