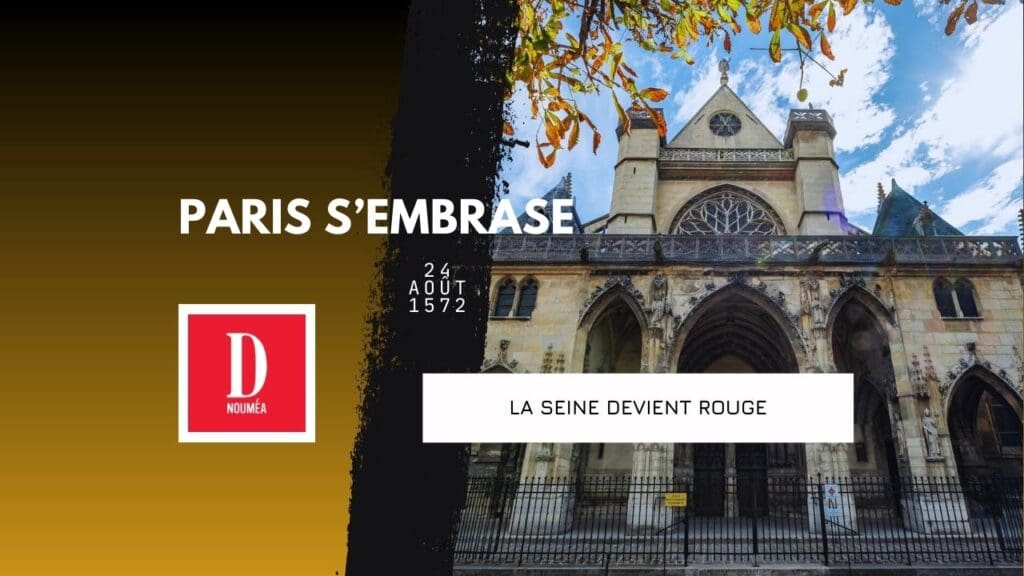On parle souvent du 14 juillet, rarement du 4 août. Pourtant, cette nuit-là, l’Assemblée nationale a officiellement aboli les privilèges. Une rupture spectaculaire… mais pas si simple.
La nuit du 4 août : un basculement inattendu dans l’euphorie révolutionnaire
C’est dans un climat de panique paysanne que les députés se réunissent à Versailles, ce mardi 4 août 1789. Les campagnes sont en feu, au sens propre comme au figuré. Une « Grande Peur » s’est répandue à travers tout le pays depuis la mi-juillet : des rumeurs de complots aristocratiques provoquent des scènes de violence contre les châteaux et les symboles de l’Ancien Régime. Les paysans brûlent les terriers, détruisent les archives féodales et s’arment, dans un désordre généralisé.
Face à cette tension insurrectionnelle, l’Assemblée constituante réagit. À l’initiative du duc d’Aiguillon, riche aristocrate libéral, et du vicomte de Noailles, jeune noble désargenté, une série de propositions choc sont lancées à la tribune : suppression des corvées, abolition des droits seigneuriaux, fin des privilèges fiscaux, égalité d’accès aux charges. Dans une ambiance électrique, les interventions s’enchaînent, les orateurs se surpassent en sacrifices. Jusqu’à deux heures du matin, c’est un feu d’artifice de renoncements symboliques, salués par des acclamations. Ce « grand soir » parlementaire restera comme l’un des plus spectaculaires renversements juridiques de l’histoire de France.
Mais derrière le lyrisme des discours, une autre réalité s’installe rapidement.
Des privilèges abolis… mais souvent rachetables ou conservés
Le texte voté dans la foulée, le 11 août 1789, ne proclame pas une abolition intégrale et immédiate. Seuls les droits féodaux personnels (corvées, servitudes, mainmortes) sont supprimés sans compensation. En revanche, les droits seigneuriaux liés aux terres, les dîmes, les redevances doivent être rachetés par ceux qui en sont redevables.
Cette mesure déçoit. Les paysans espéraient la gratuité ; ils reçoivent un compromis bancal. D’autant que l’indemnisation des anciens seigneurs reste possible, ce qui vide parfois de sa portée la « révolution juridique » annoncée. Le roi Louis XVI approuve pourtant le texte, cherchant à calmer les tensions, mais les campagnes continuent de s’agiter. Beaucoup de seigneurs n’acceptent pas de renoncer aux revenus de leur patrimoine féodal, ce qui complique considérablement l’application du décret.
Les privilèges abolis ? Sur le papier, oui. Dans les faits, la transition est plus lente, plus tortueuse. Il faudra attendre le décret du 25 août 1792, trois ans plus tard, pour que l’abolition des droits féodaux soit totale, irrévocable et sans contrepartie. Et même après cette date, des résistances locales et des incertitudes juridiques freinent encore l’égalisation des droits. Ce n’est qu’avec le Code civil de 1804 que l’égalité devant la loi deviendra un principe stabilisé.
Une révolution juridique inédite, mais un mythe à nuancer
Le 4 août n’est pas une improvisation totale : depuis des décennies, les idées physiocratiques, libérales, républicaines même chez certains penseurs, prônent la fin des privilèges. Turgot, dès 1774, avait tenté une réforme analogue. Mais l’hostilité des corps privilégiés avait conduit à l’échec. Ce que la nuit du 4 août consacre, c’est l’accélération brutale d’un processus intellectuel ancien, transformé en acte politique par la peur et l’urgence.
Le mythe révolutionnaire en a fait un moment d’unanimité. Un sacrifice héroïque des classes dominantes, un renoncement spontané au profit du peuple. Mais l’histoire est plus nuancée. D’abord, l’impulsion est venue de nobles libéraux, certes sincères, mais aussi soucieux de préserver l’ordre social sans recourir à la force militaire. Ensuite, de nombreux privilèges — notamment les offices vénaux, les privilèges urbains et provinciaux — ont mis des années à disparaître. Et dans certains cas, ils ont simplement été monnayés, comme le souligne l’historien François Furet :
Le vieux monde a été aboli, mais converti en argent bourgeois.
Reste que le principe d’égalité devant la loi, proclamé cette nuit-là, sera inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la fin du même mois. Et c’est ce principe, plus que l’abolition technique de chaque privilège, qui constitue le socle de la France moderne.
Le 4 août 1789 n’a pas détruit les privilèges en une nuit, mais il a brisé le cadre mental qui les rendait légitimes. C’est une rupture symbolique majeure, un basculement irréversible. En cela, cette nuit mérite sa place dans le panthéon des grandes dates françaises. Elle rappelle que l’égalité ne naît pas toujours dans l’enthousiasme, mais dans le tumulte et le compromis.