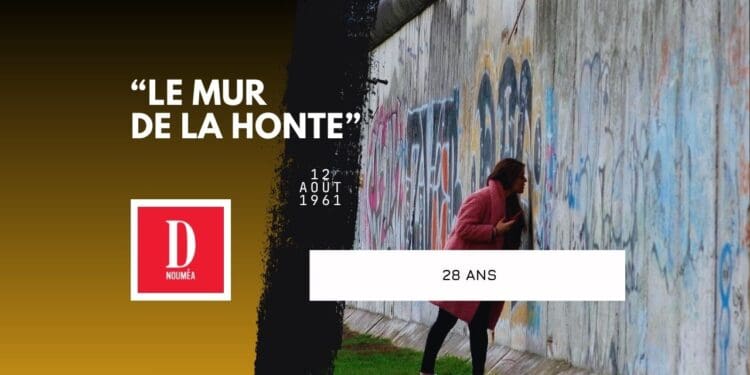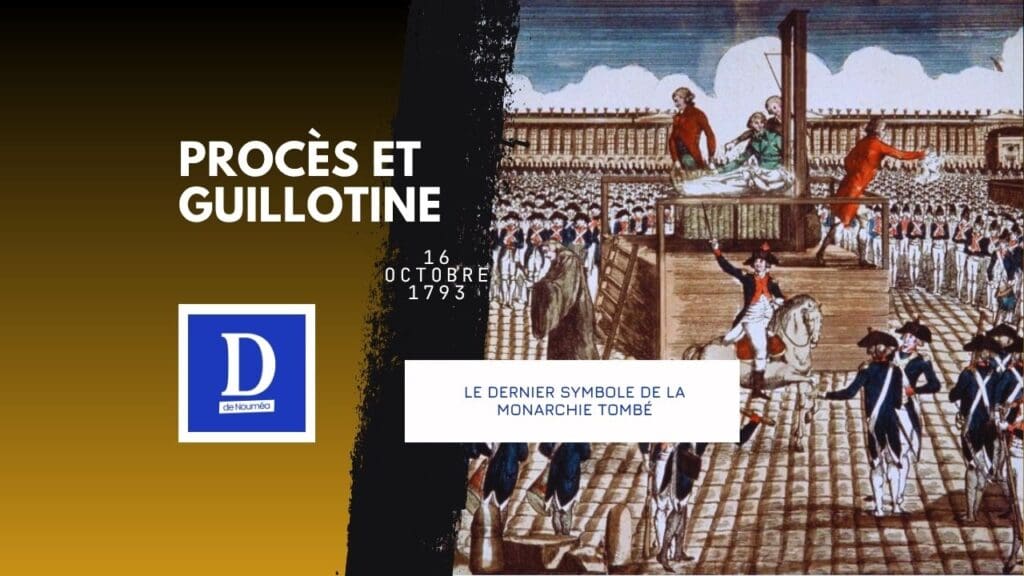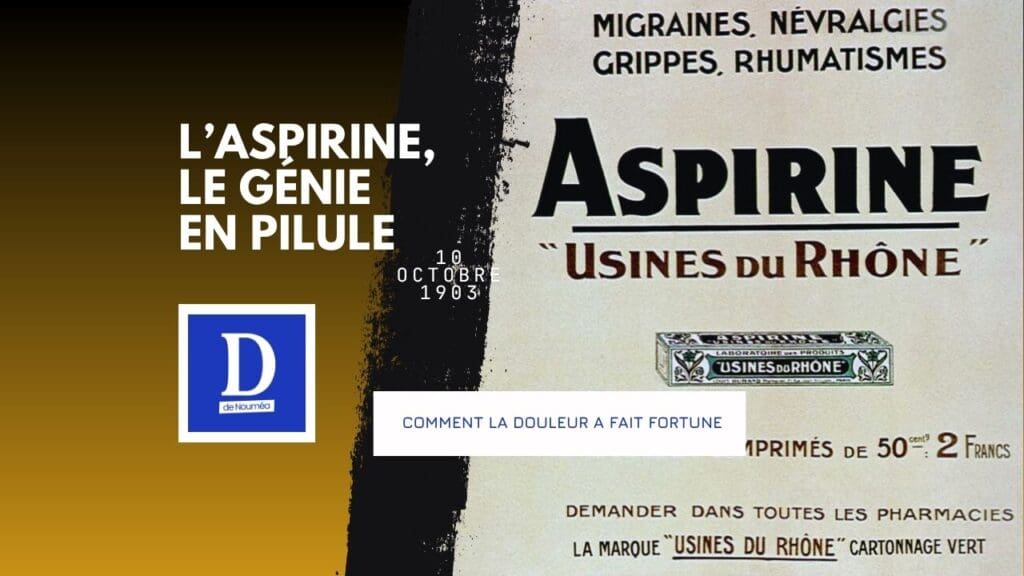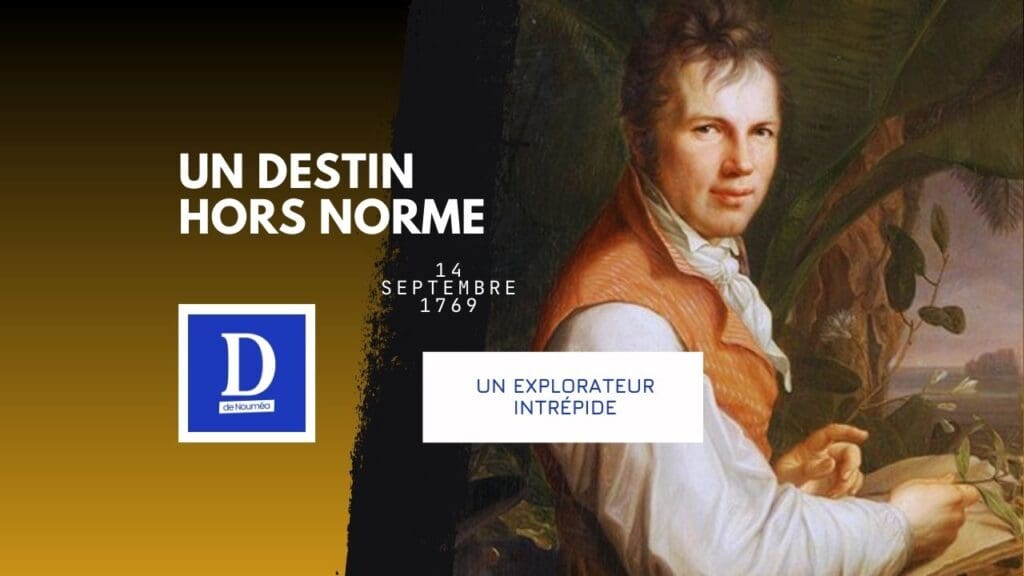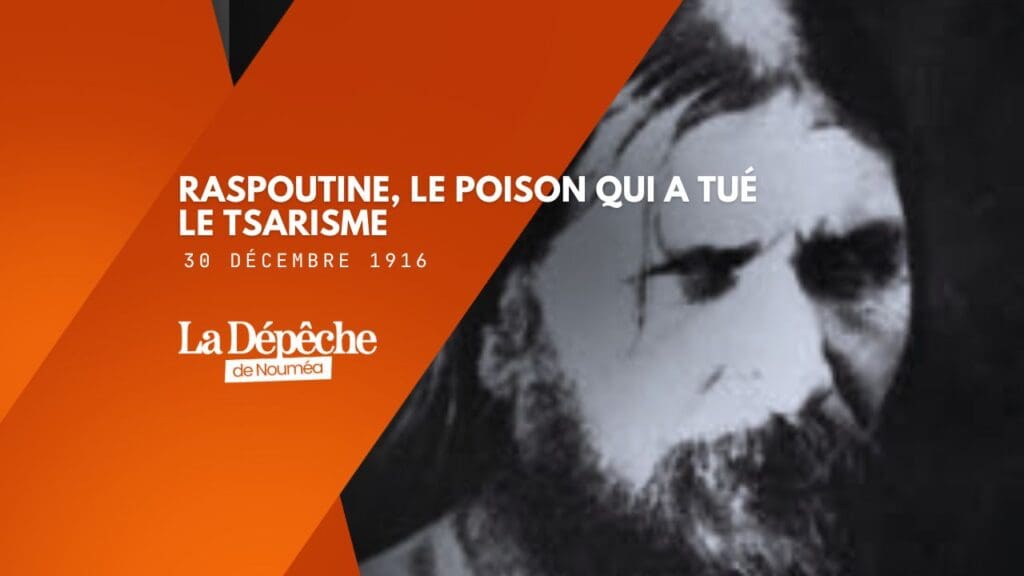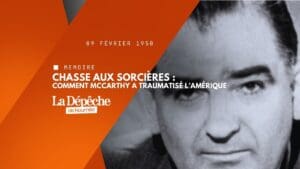Sous les projecteurs du monde entier, une ville s’est vue brutalement déchirée. En quelques heures, la frontière la plus symbolique de la guerre froide s’est dressée, coupant des familles, des amis et des destins.
Berlin ne sera plus jamais la même.
L’opération secrète qui a piégé une ville entière
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le régime communiste de la République démocratique allemande (RDA) met à exécution un plan longuement préparé : ériger une frontière infranchissable au cœur même de Berlin. L’objectif est clair : stopper l’exode massif de ses citoyens vers l’Ouest. Depuis 1949, près de 3 millions d’Allemands de l’Est ont déjà fui, attirés par la liberté et la prospérité de la République fédérale.
Les autorités mobilisent plus de 15 000 soldats, policiers et ouvriers. Les rues sont coupées, les voies ferrées interrompues, les contacts familiaux brisés. D’abord faite de simples barbelés et de grillages, la barrière est rapidement renforcée par un mur de béton. Les habitants découvrent au matin une ville coupée en deux, sous le regard implacable des miradors.
Derrière l’opération, le dirigeant est-allemand Walter Ulbricht, qui, deux mois plus tôt, affirmait encore que « personne n’a l’intention de construire un mur ». Avec le feu vert de Moscou, la RDA entame l’« opération Muraille de Chine » : barbelés, fossés, bunkers et zones interdites. En tout, 155 km de frontière isolent désormais Berlin-Ouest du reste de la RDA.
Un rempart de béton, symbole d’une Europe coupée en deux
Dès les premiers jours, le « mur de protection antifasciste » pour la propagande de l’Est est rebaptisé par l’Ouest : « Mur de la honte ». Il devient rapidement une forteresse perfectionnée : 3,6 mètres de hauteur, doubles parois séparées par un no man’s land large de 50 à 500 mètres, barbelés, alarmes, miradors, chiens de garde et systèmes de tir.
La construction transforme des rues entières en zones mortes. Dans la Bernauer Strasse, les fenêtres donnant sur l’Ouest sont murées. Certains habitants sautent encore dans des filets tendus par les pompiers de Berlin-Ouest avant que les immeubles ne soient rasés.
Les drames se multiplient. Entre 1961 et 1989, au moins 140 personnes trouvent la mort à Berlin en tentant de franchir la frontière. Les plus téméraires creusent des tunnels, se dissimulent dans des voitures aménagées ou tentent la traversée du fleuve ( la Sprée) par les canaux. Quelques-uns réussissent : environ 5 000 évadés en 28 ans. Mais beaucoup finissent en prison… ou sous les balles des gardes-frontières.
De la fermeture brutale à la chute historique
À l’Ouest, la réaction est mesurée. Les Alliés américains, britanniques et français dénoncent, mais évitent toute confrontation militaire. John F. Kennedy y voit paradoxalement un signe que Moscou veut éviter la guerre, scellant de fait la division de la ville.
À l’Est, la propagande justifie la construction par la nécessité de protéger la RDA des « provocations occidentales ». Mais pour des millions d’habitants, c’est une prison à ciel ouvert. Les permissions de visite, accordées au compte-gouttes, n’adoucissent pas la douleur des familles séparées.
Le 9 novembre 1989, sous la pression populaire et l’effondrement du bloc soviétique, le régime est-allemand ouvre enfin les postes-frontières. Le mur tombe, emportant avec lui l’un des symboles les plus puissants de la guerre froide. Sa disparition annonce la réunification allemande et la fin du communisme en Europe de l’Est.