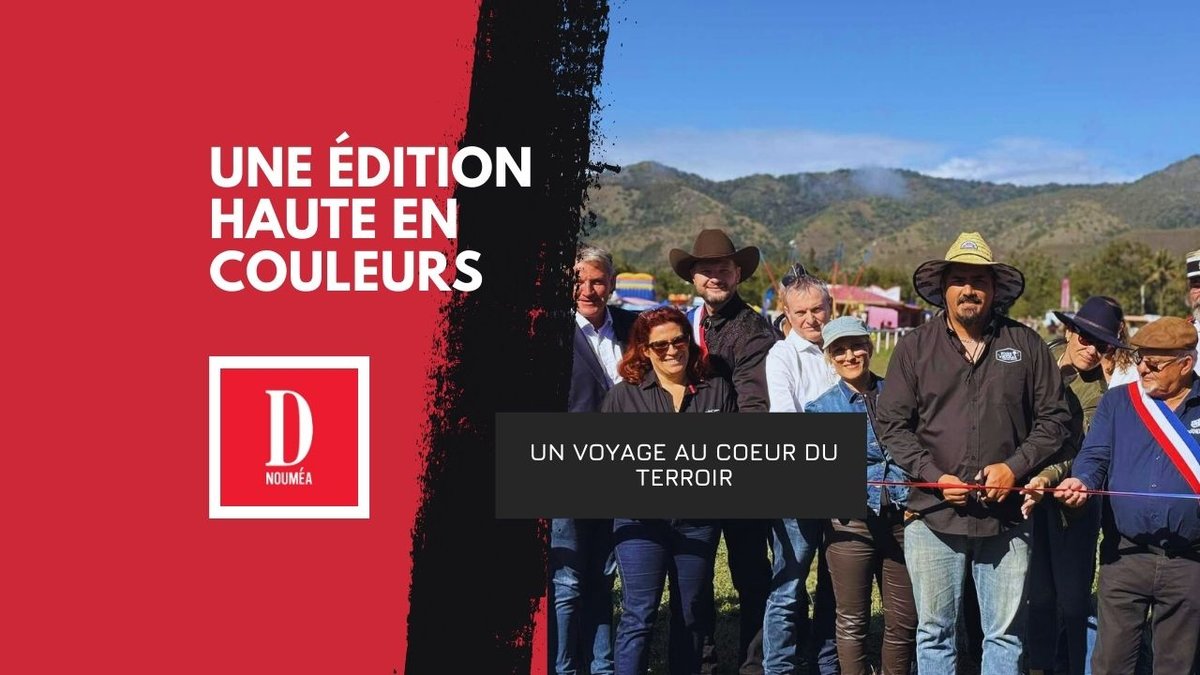16 août 1972 : le jour où Hassan II a trompé la mort
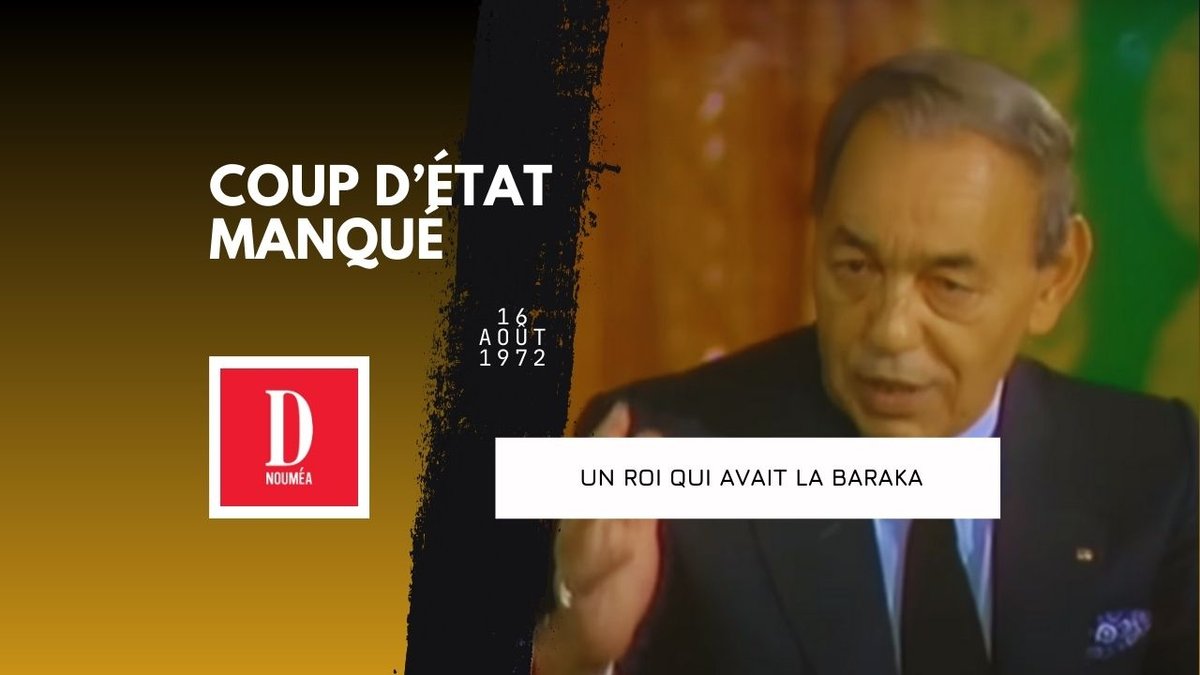
Sous le feu des balles, il garde son trône. Le 16 août 1972, Hassan II échappe à un attentat aérien d’une audace inouïe.
Une tentative d’assassinat en plein ciel
Le Maroc vit alors une période de fortes tensions. À peine un an après le coup de force de Skhirat, Hassan II est de nouveau visé par une faction de l’armée. Ce 16 août 1972, l’avion royal, un Boeing 727 revenant de France, est rejoint par quatre chasseurs F5. L’escorte vira au piège : rafales de mitrailleuses, réacteurs touchés, la cabine est transpercée. Le sang coule, plusieurs personnes sont blessés, mais le roi reste indemne.
Aux commandes, le commandant Mohammed Kabbaj fait preuve d’un sang-froid exceptionnel. Il annonce à la radio que le roi est grièvement blessé, une ruse pour interrompre les tirs. Les putschistes exigent un atterrissage à Kénitra, mais l’appareil se pose finalement à Rabat, de justesse, après avoir effectué une sortie de piste.
Sur le tarmac, Hassan II garde une maîtrise glaciale. Il salue les troupes, rit avec ses enfants, puis s’éclipse discrètement dans une voiture banalisée pour rejoindre Skhirat. La monarchie vient d’échapper à l’effondrement… mais pas à la vengeance royale.
Oufkir, l’homme de l’ombre qui voulait la République
Derrière ce complot, un homme : le général Mohamed Oufkir, ministre de la Défense et proche du roi. Ancien artisan de la répression contre l’opposition, il rêve pourtant d’un Maroc républicain, sur le modèle de l’Égypte de Nasser et de la Libye de Kadhafi.
Déjà impliqué dans l’affaire Ben Barka en 1965, Oufkir orchestre minutieusement cette attaque aérienne. Une brigade blindée est en alerte, prête à intervenir si l’avion tombe. Mais l’échec est cuisant. Les pilotes putschistes sont exécutés, Oufkir est retrouvé mort dans des conditions troubles. Le roi, lui, renforce son contrôle sur l’armée et verrouille davantage le pouvoir.
Cette seconde tentative de coup d’État en quatorze mois révèle l’isolement du souverain, entouré d’ennemis jusque dans ses plus hauts gradés.
La monarchie marocaine face aux vents de la République
Pour comprendre cette période, il faut rappeler que le Maroc est alors la dernière monarchie d’Afrique du Nord. La Libye a perdu son roi en 1969, l’Égypte en 1952, la Tunisie et l’Algérie sont nées républiques. Hassan II, monté sur le trône en 1961, incarne l’unité d’un pays profondément divisé par son histoire coloniale : protectorat français, protectorat espagnol, administration internationale de Tanger.
Cette diversité nourrit les tensions. Certaines régions, comme le Rif, sont marginalisées, tandis qu’une partie de l’élite aspire à un système républicain. Malgré les critiques – trop jeune, trop occidentalisé, trop autoritaire – Hassan II poursuit la réunification du royaume et mise sur des causes mobilisatrices, comme le projet du Grand Maroc.
L’attentat d’août 1972, soutenu moralement par la Libye de Kadhafi, n’empêche pas le souverain de consolider son trône. Trois ans plus tard, il lance la Marche verte, récupérant le Sahara occidental au nez et à la barbe de l’Espagne. La monarchie sort renforcée, et l’image d’un roi calme sous le feu devient une légende.