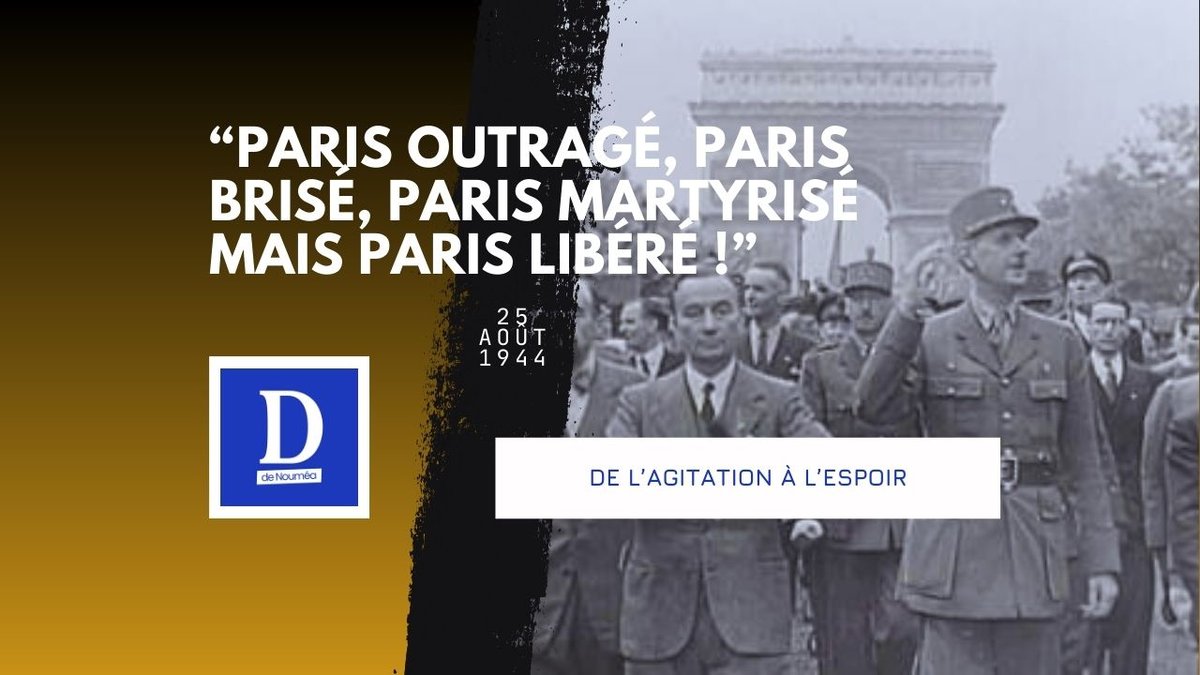Opioïdes ou cannabis médical, un tournant décisif
Interview de Frédéric GERARD - Président du syndicat du chanvre de Nouvelle-Calédonie
Quand le tramadol devient un réflexe
Tout est parti d’une fracture à la cheville. Un adolescent calédonien repart de l’hôpital avec une ordonnance pour du tramadol. Sa famille tombe des nues.
Ça m’avait choqué à l’époque parce que le tramadol est un produit quand même assez connoté dans la crise des opioïdes
confie son père. Car ce médicament, opioïde de synthèse, est associé depuis des années à la crise sanitaire qui a ravagé les États-Unis.
Le risque d’accroche est réel
insiste-t-il. La dépendance, les overdoses, les morts prématurées : autant de dangers qui planent, alors même que les statistiques officielles de la Nouvelle-Calédonie montrent une consommation d’opioïdes en pleine explosion.
CBD contre opioïdes : deux visions de la douleur
Face à ces dérives, le cannabis médical apparaît comme une alternative crédible. Là où l’opioïde éteint brutalement le système nerveux, le CBD rend la douleur « vivable ».
Quand on utilise le CBD par exemple dans un cas de douleur chronique, la douleur reste mais elle devient vivable, on vit avec
explique-t-il. Une différence fondamentale : l’opioïde nous plonge dans une extinction du système nerveux, là où le cannabis offre une gestion sur du long terme, sans dépendance lourde. Les expériences internationales le confirment : au Portugal, au Canada, en Espagne, la dépénalisation encadrée a permis de casser les réseaux criminels et de protéger les plus jeunes. En Hollande, l’accès est strictement contrôlé : pièce d’identité obligatoire, traçabilité complète, pas de publicité. Le consommateur est encadré, le marché noir marginalisé.
Un marché noir à 6 milliards, un marché légal en embuscade
En Nouvelle-Calédonie, le marché noir du cannabis pèserait environ 6 milliards de francs CFP par an. À Nouméa, le gramme s’échange autour de 2 000 francs. Un monopole d’État, avec des produits certifiés, pourrait casser les prix et tarir les filières clandestines.
Aujourd’hui, on peut estimer que le gramme de cannabis à Nouméa s’échange à à peu près 2 000 francs. On peut faire beaucoup moins cher dans le cadre d’un monopole d’État
affirme le représentant. L’enjeu dépasse la santé publique : il est aussi économique. Le chanvre industriel permettrait de réduire les importations coûteuses et polluantes. Le cannabis médical, lui, ouvre une porte vers l’exportation. L’Australie importe encore 60 % de sa consommation. L’Allemagne, premier marché européen, dépend à 80 % de l’étranger. En clair : la Calédonie aurait une carte à jouer, avec un label et un terroir reconnus à l’international.
Entre blocages politiques et opportunités stratégiques
Reste un obstacle : une législation d’un autre temps. La délibération de 1969 verrouille toujours le sujet. Les producteurs locaux réclament des licences, une traçabilité complète de la semence au produit fini, et un cadre clair. Mais la politique s’enlise, les oppositions se crispent, et l’immobilisme domine.
Ce qu’on demande clairement aujourd’hui au gouvernement, c’est de libérer les énergies qu’il y a là derrière
plaide le syndicat. Deux filières capables de générer des emplois, de l’innovation et des devises.
Une chance historique
La Nouvelle-Calédonie pourrait rater le train ou s’y accrocher. Dans un contexte où les opioïdes explosent et où les familles s’inquiètent pour leurs enfants, le choix est limpide : soit laisser prospérer le marché noir, soit encadrer, certifier et exporter.Il faut plus en faire un problème de sécurité mais un problème de santé publique
conclut-il. Le pays, reconnu pour son terroir et la qualité de ses productions, a une opportunité historique. Reste à savoir si les décideurs auront le courage de l’attraper.