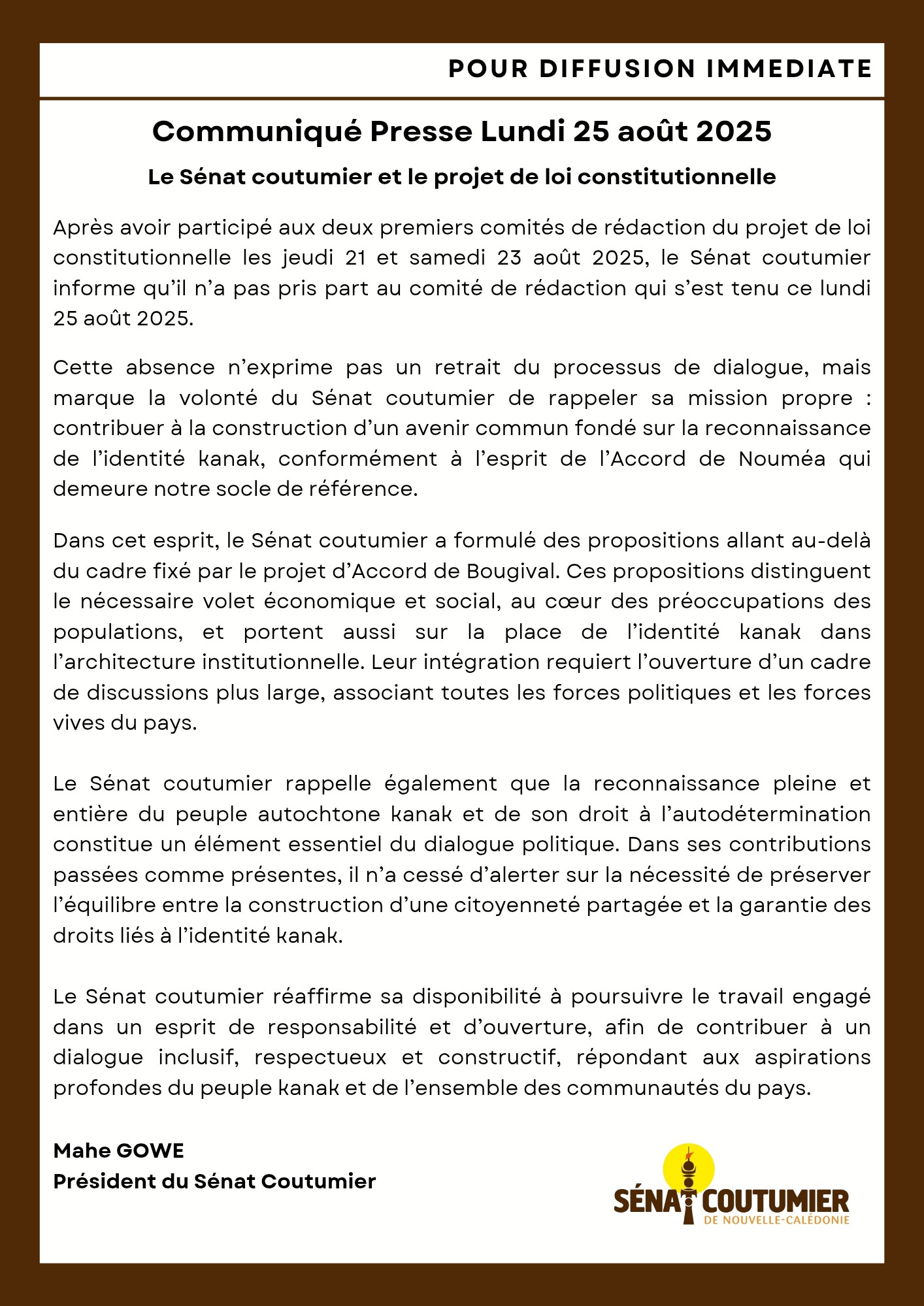Sénat coutumier : présent au dialogue, contesté dans sa légitimité

lls ont dit non à Bougival mais oui au dialogue. Le Sénat coutumier s’affiche comme un acteur central, mais sa légitimité est aujourd’hui contestée de toutes parts.
Un Sénat coutumier qui dit non à Bougival mais reste autour de la table
Le 12 juillet dernier, l’accord de Bougival avait déjà fracturé le camp indépendantiste. Le FLNKS radicalisé avait choisi l’isolement. Le Sénat coutumier, lui, a adopté une posture plus pragmatique : dire non à Bougival, mais ne pas s’exclure du processus.
Ainsi, l’instance coutumière a participé aux comités de rédaction des 21 et 23 août, avant de marquer une pause le 25 août. Dans son communiqué signé par Mahe Gowe, elle explique que cette absence ne signifie pas un retrait mais, une volonté de rappeler sa mission : défendre un avenir commun fondé sur la reconnaissance de l’identité kanak.
Cette stratégie illustre une ligne ambivalente : présente au dialogue, mais jamais sans conditions. Une manière de peser politiquement, tout en refusant de donner un blanc-seing aux accords de Paris.
Une légitimité contestée : patriarcat et entre-soi
Si le Sénat coutumier se présente comme le garant de la parole kanak, il est loin de faire l’unanimité. Des mouvements comme Inaat Ne Kanaky l’accusent de ne plus représenter qu’une vision occidentale du monde coutumier.
Le constat est implacable : aucune femme ne siège dans cette institution. Au XXIᵉ siècle, cette absence interroge la capacité réelle du Sénat à incarner une parole moderne et inclusive. Derrière ses discours sur l’« avenir commun » et la « citoyenneté partagée », il reste une structure verrouillée par des hommes, fonctionnant selon des règles qui perpétuent l’exclusion des voix féminines et des jeunes générations.
De plus en plus d’acteurs dénoncent cet entre-soi, où les décisions semblent concerner davantage à reproduire le pouvoir coutumier qu’à représenter réellement l’ensemble des communautés du pays. L’image d’un Sénat ouvert, inclusif et rassembleur s’effrite, au profit d’une institution jugée déconnectée de la société réelle.
Entre ambition politique et contradictions profondes
Cette double posture – refuser Bougival mais participer au processus – révèle toutes les ambiguïtés du Sénat coutumier. D’un côté, il affirme son rôle d’acteur incontournable de la réécriture constitutionnelle. De l’autre, il peine à convaincre qu’il représente véritablement les aspirations du peuple kanak.
Sa volonté affichée de défendre un dialogue inclusif et constructif se heurte à une réalité interne : une organisation figée, exclusivement masculine, accusée de parler davantage en son nom propre qu’au nom de la base.
Au moment où l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se joue, cette contradiction fragilise sa crédibilité. En se voulant la voix du peuple kanak, le Sénat coutumier s’expose à un paradoxe : comment incarner l’avenir si l’on reste enfermé dans les structures du passé ?
Les critiques se multiplient, et elles ne viennent plus seulement des adversaires politiques mais aussi de l’intérieur du monde indépendantiste. L’absence du 25 août, loin d’être neutre, devient ainsi un symbole : celui d’une institution qui veut peser, mais qui peine à démontrer qu’elle parle encore au nom de tous.
Le Sénat coutumier reste une pièce maîtresse du dialogue institutionnel en Nouvelle-Calédonie. Mais il n’échappe pas aux contradictions. Présent dans les comités, absent à un moment clef, porteur d’un discours inclusif mais prisonnier d’un patriarcat assumé, il illustre la complexité d’un pays en transition.
L’avenir dira si cette institution saura se réformer pour être à la hauteur des enjeux du XXIᵉ siècle, ou si elle restera un symbole d’entre-soi coutumier, coupé de la société qu’elle prétend représenter.