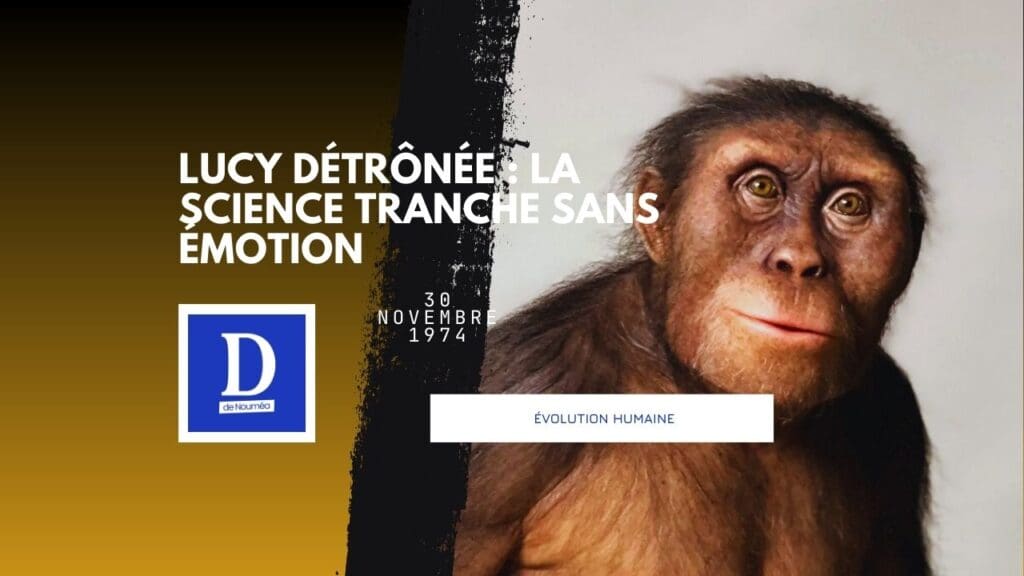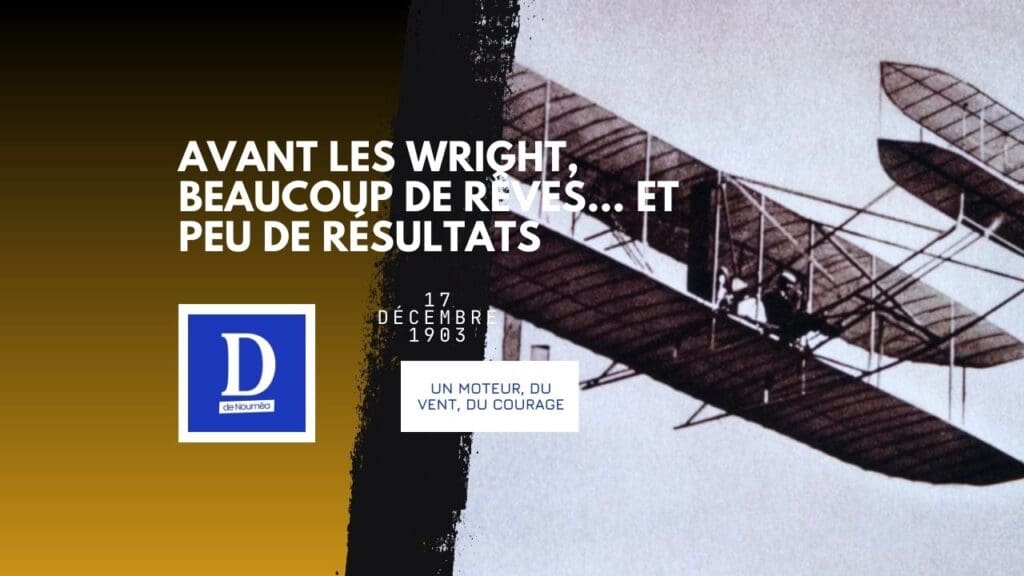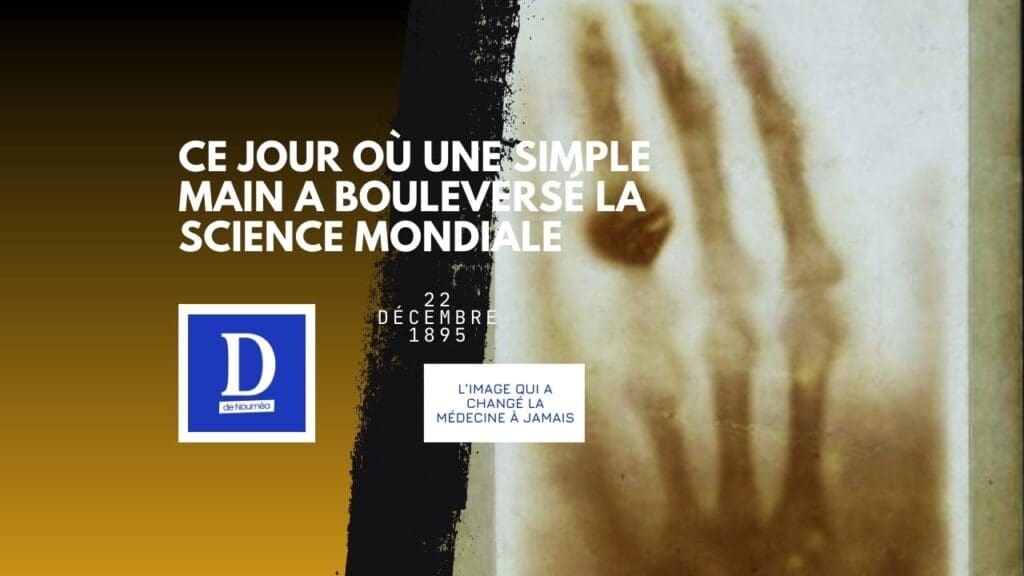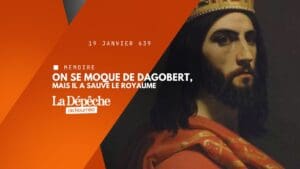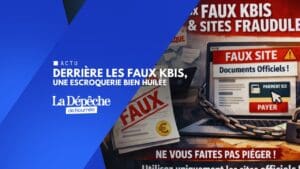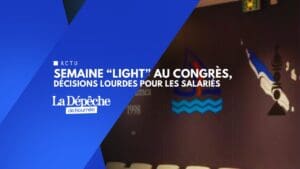Dans la nuit du 31 août 1997, Paris est plongé dans la stupeur. Un accident dans le tunnel de l’Alma vient briser le destin d’une princesse adulée dans le monde entier.
Au volant, un chauffeur lancé à vive allure. À ses côtés, un couple traqué. Dans la voiture, Lady Diana Spencer, 36 ans, la « princesse des cœurs ».
Lady Diana, une icône happée par la traque médiatique
Il est 00h27 lorsque la Mercedes transportant Diana et Dodi Al-Fayed percute un pilier du pont de l’Alma. Le chauffeur Henri Paul et le milliardaire anglo-égyptien meurent sur le coup. Diana, grièvement blessée, est conduite à la Salpêtrière. Elle s’éteindra à 4h25, après plusieurs heures de lutte.
Dès les premières minutes, les paparazzis sont accusés. Plusieurs sont interpellés, soupçonnés d’avoir provoqué la course effrénée. Ce drame frappe aussi deux enfants : William et Harry, âgés de 15 et 12 ans, qui perdent brutalement leur mère.
Cette nuit-là, la France découvre que la vie privée des puissants peut être broyée par le voyeurisme. Depuis, les excès de la presse people reviennent régulièrement dans le débat public.
Une émotion planétaire, une reine critiquée
Dès l’annonce, l’onde de choc est mondiale. Les chaînes d’information interrompent leurs programmes, les foules déposent des fleurs devant Kensington Palace.
Le contraste est brutal : alors que la planète pleure, la reine Elizabeth II reste silencieuse, recluse à Balmoral avec Charles et ses petits-fils. Ce silence suscite une colère populaire sans précédent au Royaume-Uni.
Le 6 septembre, trois milliards de téléspectateurs assistent aux funérailles à Westminster. Les images marquent l’Histoire : deux enfants derrière un cercueil, Elton John adaptant Candle in the Wind, des personnalités venues du monde entier. Ce jour-là, la monarchie tremble. Paradoxalement, c’est la mort de Diana qui contraindra la Couronne à se rapprocher du peuple.
Héritage d’une princesse engagée
Lady Diana ne fut pas seulement une icône glamour. Elle avait engagé son image dans des combats concrets, loin des postures victimaires. Son action contre les mines antipersonnel a marqué les esprits et débouché sur l’accord d’Ottawa en décembre 1997. Son nom reste associé à une victoire diplomatique, renforcée par le prix Nobel de la Paix attribué cette année-là à cette cause.
À travers ses engagements, Diana a montré qu’une figure publique pouvait user de sa notoriété non pas pour s’ériger en victime, mais pour agir au service des plus faibles. C’est sans doute la leçon que retient une partie de l’Occident : la compassion doit s’accompagner d’action.