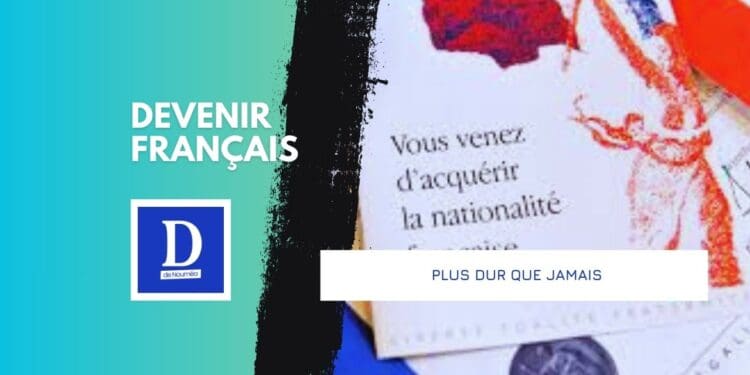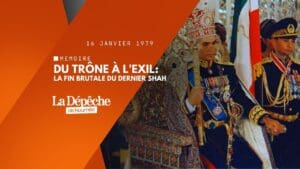La nationalité française est bien plus qu’un statut administratif. C’est un lien sacré entre un individu et la Nation, une appartenance qui engage et qui oblige.
Un droit longtemps consensuel, aujourd’hui disputé
De 1945 aux années 1980, le droit de la nationalité française reposait sur un socle clair : filiation, droit du sol et intégration. Le pays sortait de la guerre, et la nationalité était conçue comme une évidence, portée par un consensus républicain solide. La transmission par le sang ou le double droit du sol suffisait à fonder l’appartenance à la communauté nationale.
Mais à partir des années 1980, avec la montée de l’immigration de masse, le débat change de nature. Des voix s’élèvent pour dénoncer une dérive : des étrangers peuvent accéder à la nationalité française sans réelle adhésion. Dès lors, la nationalité n’est plus un simple statut, mais un enjeu identitaire et politique.
La loi du 22 juillet 1993, portée par la droite, a marqué un tournant. Elle impose aux enfants nés en France de parents étrangers de manifester leur volonté de devenir français entre 16 et 21 ans. L’automaticité disparaît : la France veut s’assurer d’un choix assumé, et non d’une attribution passive.
La nationalité, un choix qui engage et une exigence d’assimilation
À partir des années 2000, les réformes se succèdent. La loi de 2003 introduit une exigence d’assimilation linguistique et culturelle, renforcée en 2011 par le gouvernement de droite. Désormais, la naturalisation exige non seulement la maîtrise du français mais aussi une connaissance de l’histoire et des valeurs républicaines. Les candidats doivent signer une charte des droits et des devoirs et participer à une cérémonie solennelle d’accueil dans la citoyenneté.
Cette évolution traduit une conviction claire : devenir français n’est pas un droit automatique, mais une distinction. Le pays ne saurait brader son identité au profit d’individus refusant l’intégration. En 2025, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau franchit un nouveau cap en imposant un niveau linguistique B2, un examen civique et un entretien axé sur l’adhésion aux valeurs républicaines.
La nationalité par mariage a elle aussi été durcie : là encore, les conditions se sont durcies au fil des décennies. Le mariage avec un Français ne garantit plus rien, et l’État conserve un pouvoir d’opposition en cas de doute sur l’assimilation ou l’indignité du demandeur.
Déchéance, double nationalité et Mayotte : des débats brûlants
Au-delà de l’acquisition, la déchéance de nationalité demeure un sujet sensible. Depuis 1998, la loi permet de la retirer en cas de terrorisme ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, ont tenté d’aller plus loin, mais les résistances politiques et constitutionnelles ont freiné ces projets. La gauche, au nom d’un égalitarisme dogmatique, a souvent refusé d’admettre la légitimité d’une telle sanction, y compris face aux crimes les plus graves.
La question de la double nationalité nourrit également les controverses. Marine Le Pen avait alerté dès 2011 sur le risque de double allégeance. En réalité, la France, contrairement à d’autres pays, continue d’accepter la binationalité au nom d’un prétendu rayonnement. Mais pour beaucoup, cette souplesse fragilise la cohésion nationale. Car comment être loyal à une seule patrie lorsqu’on en possède deux ?
Enfin, Mayotte illustre une spécificité française. Face à une immigration clandestine massive en provenance des Comores, le droit du sol y a été restreint dès 2018, puis renforcé en 2025. Désormais, pour qu’un enfant né à Mayotte devienne français, ses parents doivent justifier d’un séjour régulier d’au moins un an avant sa naissance. Un signe fort : la République entend protéger son droit contre les détournements migratoires.
De 1945 à 2025, le droit de la nationalité s’est transformé en profondeur. D’un statut largement automatique, il est devenu un choix exigeant, soumis à des conditions de langue, de culture et de loyauté. Cette évolution est salutaire : dans un monde où l’immigration massive met à l’épreuve l’identité des nations, la France ne peut se permettre la naïveté.
Être Français n’est pas une formalité. C’est une fidélité à une histoire, une culture et des valeurs. Et cela, aucun texte, aucune idéologie ne saurait l’effacer.