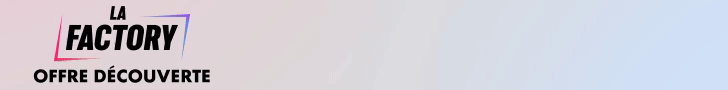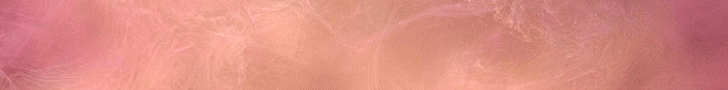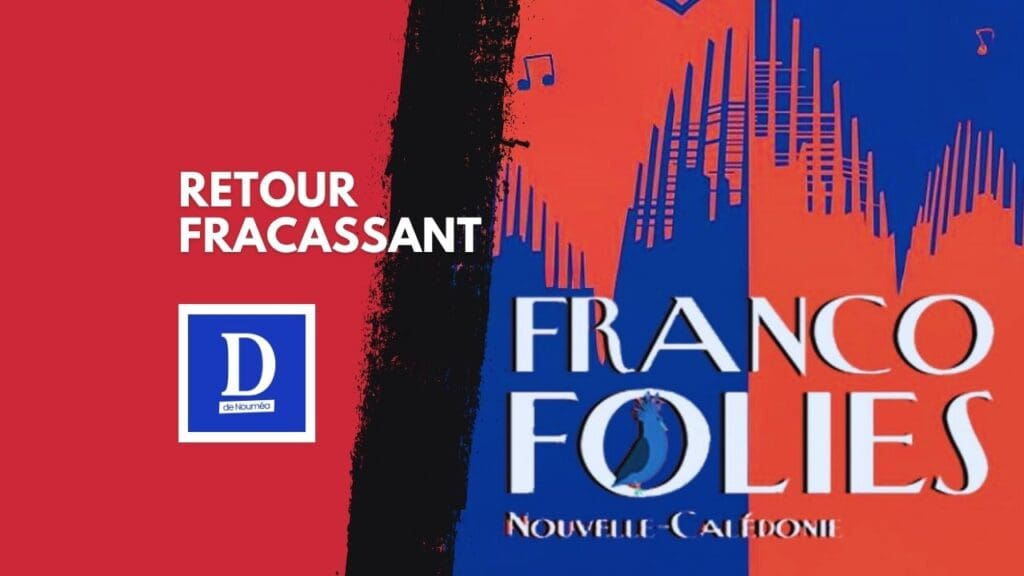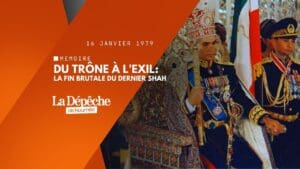Chaque année, le 31 août, le monde entier se mobilise pour la Journée internationale de prévention des overdoses. Mais au-delà du symbole, la question demeure : overdose de quoi ? Trop souvent, le débat se concentre sur les drogues dures importées d’Europe ou d’Amérique. Or, en Nouvelle-Calédonie, la réalité est bien différente : les overdoses et les drames liés aux addictions proviennent d’une palette beaucoup plus large de substances.
Des substances multiples qui frappent localement
Sur le territoire, l’addiction à l’alcool reste la première cause de drames familiaux, de violences et d’accidents mortels. À cela s’ajoute une consommation massive de cannabis, parfois banalisée chez les jeunes. Plus inquiétant encore, des produits comme le datura plante hallucinogène aux effets redoutables ou encore certains médicaments détournés font régulièrement la une des faits divers.
On parle d’overdose, mais ici, l’alcool tue plus que tout, confie un médecin urgentiste de Nouméa.
De nouvelles drogues s’installent
Aux côtés de ces addictions déjà bien connues, d’autres substances gagnent du terrain. Le kava, boisson traditionnelle importée de Vanuatu, est désormais largement consommé et, en excès, entraîne une forte dépendance. La MDMA circule dans certains cercles festifs, tandis que la cocaïne fait son apparition depuis peu, signe inquiétant d’une mondialisation des trafics
La cocaïne arrive par petites quantités, mais elle circule. Et elle change tout : les réseaux, les prix, la violence qui les accompagne, confie un policier sous couvert d’anonymat.
Une urgence de santé publique et de sécurité
Chaque overdose, qu’elle soit due à l’alcool, au cannabis, au datura ou à des drogues importées, cache une tragédie humaine. Familles détruites, quartiers marqués par la violence, hôpitaux saturés : les conséquences se multiplient. Face à cela, la prévention doit s’accompagner d’une réponse d’autorité claire. La société calédonienne doit défendre ses valeurs : protéger la jeunesse, rappeler la responsabilité individuelle, et refuser la banalisation de ces substances. Un responsable associatif résume :
Ici, ce n’est pas un problème de mode. C’est un problème de survie collective.