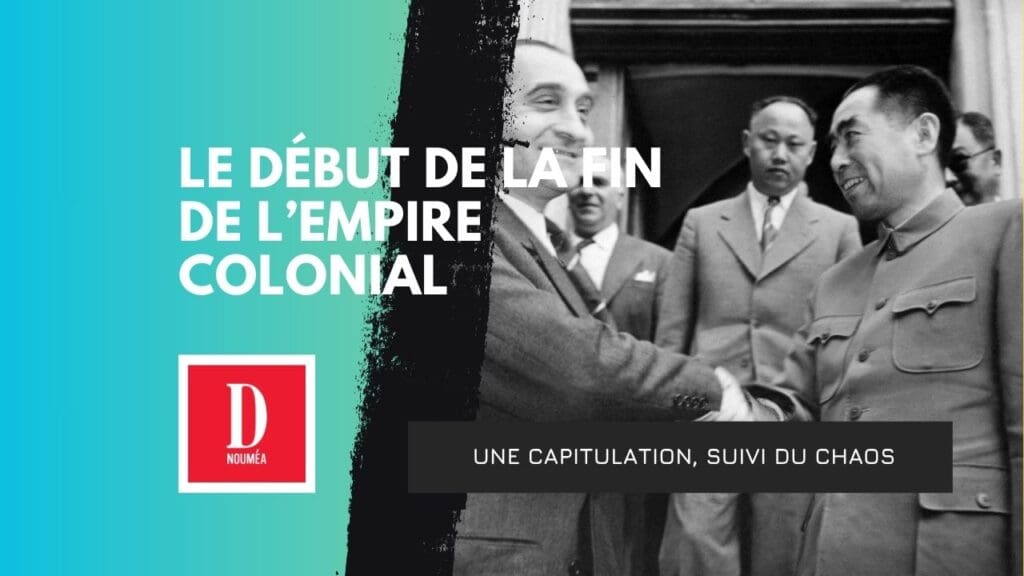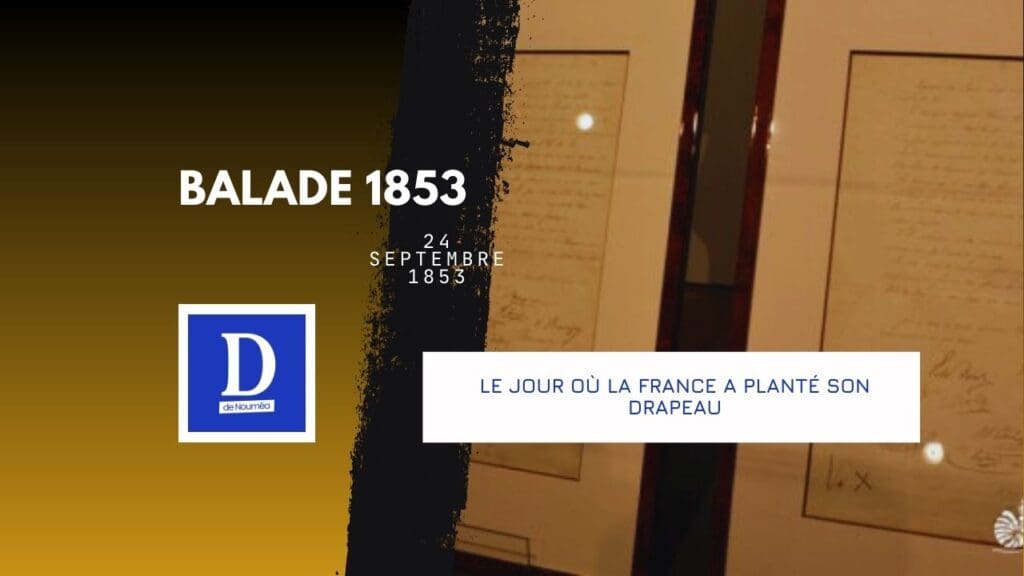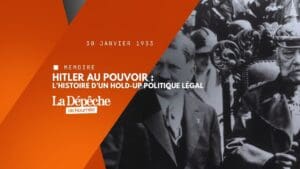Le contrôle des finances publiques n’est pas une lubie moderne. C’est un héritage direct de Napoléon Ier qui, en 1807, imposa rigueur et transparence.
Napoléon créa la Cour des comptes pour assainir l’État
Le 16 septembre 1807, l’Empereur Napoléon Ier fonde la Cour des comptes, institution qui incarne depuis plus de deux siècles la volonté française de maîtriser l’usage des deniers publics. En instituant cette juridiction, l’Empereur mettait fin au désordre hérité de la Révolution, qui avait supprimé les anciennes chambres des comptes de l’Ancien Régime.
Napoléon voulait une institution centralisée, efficace et non courtisane, chargée de juger les comptables publics et de dénoncer les abus. Dès son origine, la Cour exerce une mission juridictionnelle – rendre des arrêts – et une mission d’observation, réservée à l’Empereur lui-même. C’est l’acte fondateur d’un État moderne, où la responsabilité financière est un pilier de la souveraineté nationale.
De la Restauration à la République : une institution au service de l’État
Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, la Cour des comptes gagne en solidité. En 1822, elle commence à arrêter et contrôler les comptes de l’État, apportant une première garantie de transparence à l’égard du gouvernement comme du Parlement.
Son rapport annuel, transmis aux parlementaires dès 1832, devient public en 1938 et accessible à tous. Tout au long du XIXe siècle, la Cour devient un instrument essentiel de la monarchie constitutionnelle, puis de la République. Son rôle s’élargit progressivement : contrôle des associations subventionnées dès 1939, de la Sécurité sociale en 1950, des entreprises publiques en 1976, et même des organismes vivant de la générosité publique en 1991.
Ce cadre rigoureux fait de la Cour des comptes un rempart contre le gaspillage et les abus, une institution qui oblige les gouvernants à rendre des comptes, au nom de la Nation.
La Cour des comptes aujourd’hui : rigueur et indépendance
Installée depuis 1912 au prestigieux Palais Cambon, près de la Concorde, la Cour des comptes est composée de magistrats inamovibles et structurée en sept chambres. Depuis la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001 et la Loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale (LOLFSS) de 2005, ses missions se sont accrues : elle certifie désormais chaque année les comptes de l’État et de la Sécurité sociale, tout en évaluant les politiques publiques.
Elle assiste à la fois le Parlement et le gouvernement, mais toujours dans une logique d’indépendance. La Cour n’est pas seulement un observateur : elle est le gardien de la bonne gestion, la juridiction des comptables et l’arbitre de l’intérêt général. Dans un pays trop souvent en proie aux déficits, elle incarne une exigence de rigueur budgétaire que la France doit assumer pleinement pour préserver son avenir.
Napoléon avait vu juste : sans contrôle des finances, il n’y a pas de puissance nationale. La Cour des comptes demeure aujourd’hui l’un des symboles les plus solides de l’État, garantissant que l’argent public, fruit du travail des Français, ne soit jamais gaspillé.