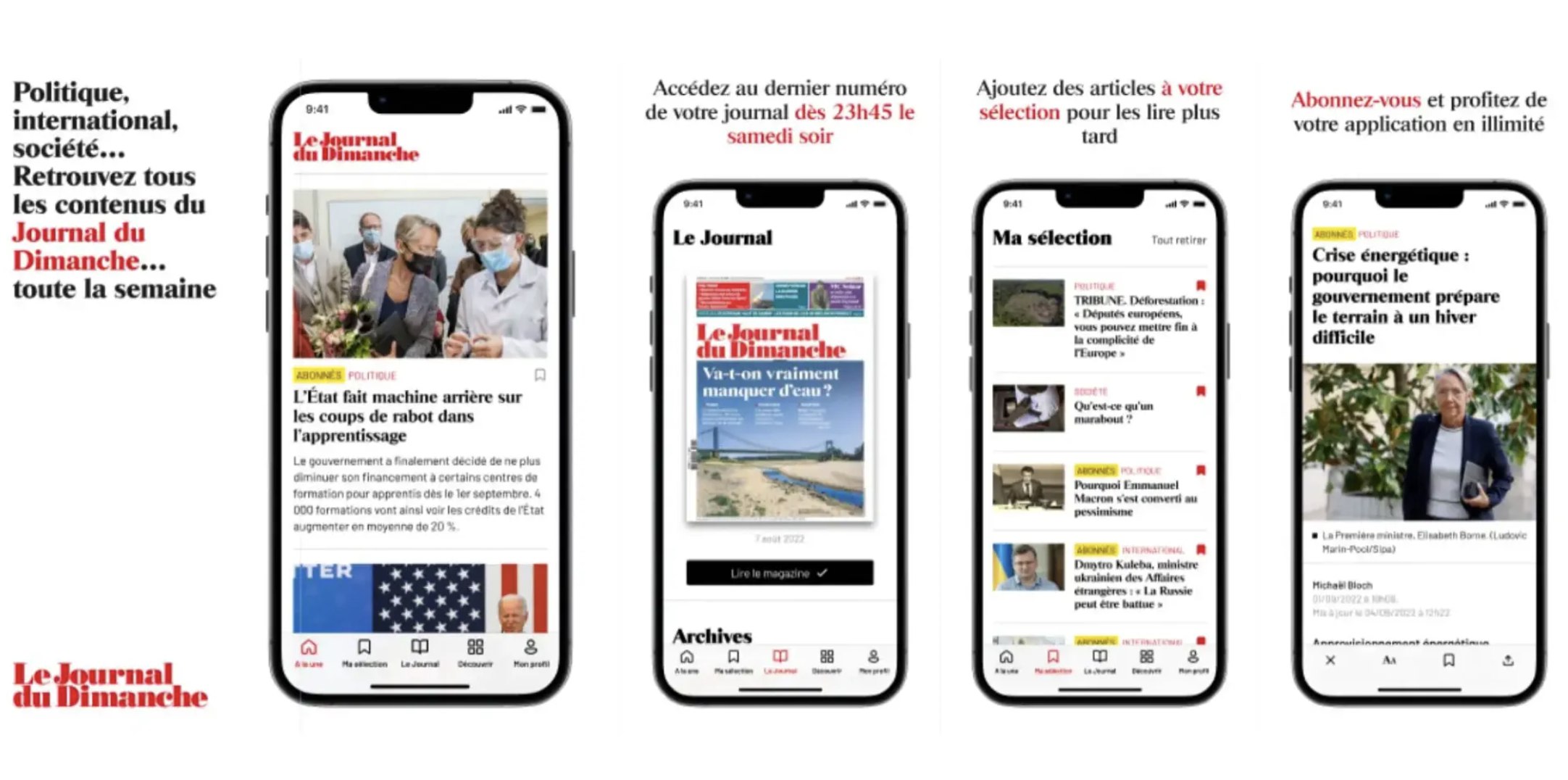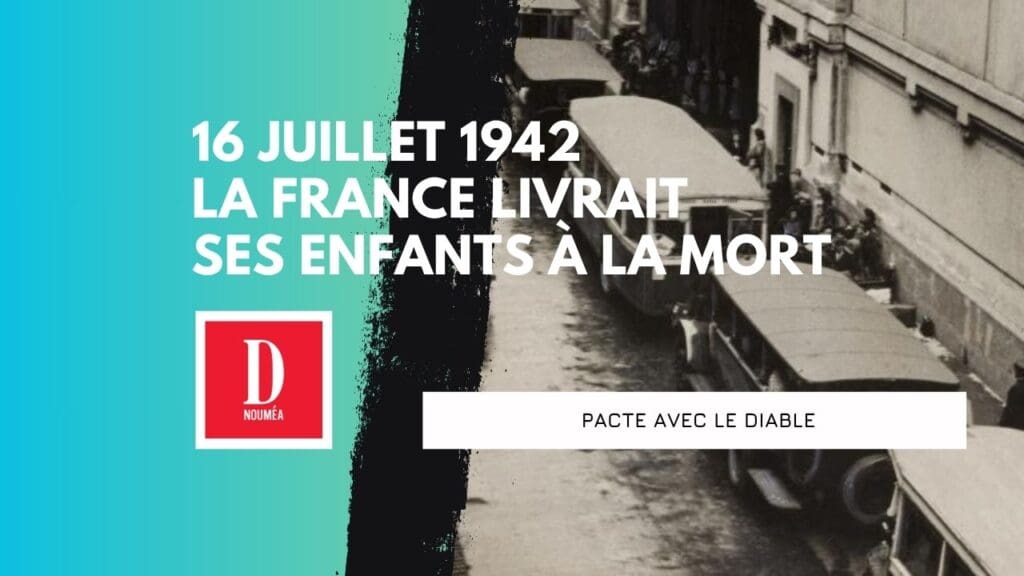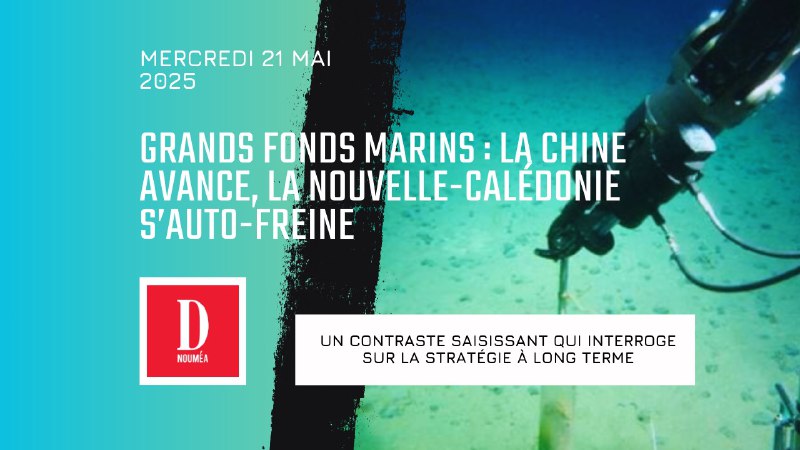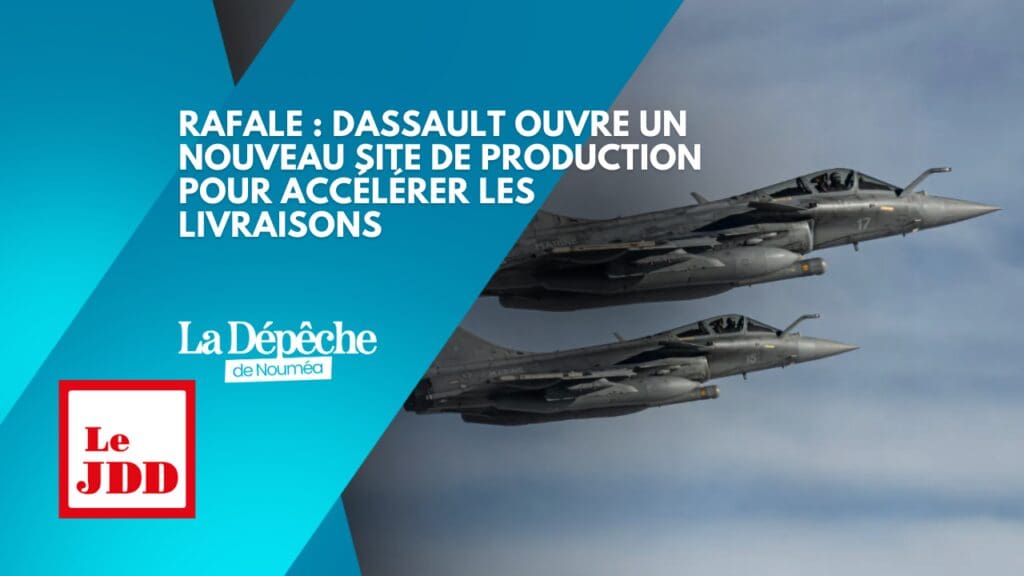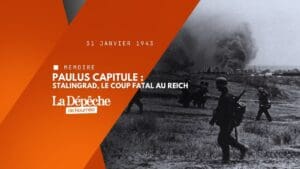De France 2 à France Inter, l’audiovisuel public enchaîne les dérapages. Entre militantisme assumé et partialité latente, la neutralité promise par la loi semble chaque jour plus fragile.

«D’où parles-tu, camarade ? », demandait-on en mai 1968 pour situer la classe sociale, et donc la légitimité, de celui qui prenait la parole. La formule n’a rien perdu de son actualité. Car si la liberté d’expression est un droit intangible en France, l’audiovisuel public n’est pas un média comme les autres : la loi du 30 septembre 1986 lui impose « honnêteté, indépendance et pluralisme ». Or cette exigence de neutralité apparaît de plus en plus fragile. Au point que l’Assemblée nationale a décidé d’ouvrir une commission d’enquête sur « les dérives de l’audiovisuel public ». Et pour cause : les exemples d’inflexions marquées à gauche, parfois ouvertement militantes, s’accumulent.
Les débuts de Léa Salamé au « 20 heures » de France 2 ressemblent moins à une installation tranquille qu’à un parcours semé d’embûches. Audiences tâtonnantes, attaques personnelles… et désormais fronde interne. Dernier épisode : un communiqué de la CGT de France Télévisions dénonçant la couverture du mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre. Les syndicalistes accusent le JT d’avoir privilégié « l’angle du maintien de l’ordre » et de « Nicolas qui paie », plutôt que de relayer les « vraies revendications de gauche ».
Le texte va plus loin en s’en prenant à l’invité de fin d’émission, le cardinal François Bustillo, venu présenter son livre Réparation (Fayard). « Félicitations pour ce journal d’Ancien Régime, pour ce journalisme de cour », raille le communiqué. Ironie de l’histoire : ce journal, vilipendé en interne, a réuni ce soir-là 4,15 millions de téléspectateurs, sa meilleure audience depuis mars 2025.
La manipulation de Crépol
Une nuit en France : tel est le titre de l’ouvrage de plusieurs journalistes sur l’assassinat de Thomas Perotto, tué à Crépol le 19 novembre 2023 par un groupe de jeunes issus d’un quartier populaire. Invités sur France Inter puis dans l’émission « C à Vous » (France 5) les 17 et 18 mars 2025, les auteurs ont dénoncé l’instrumentalisation du drame « par l’extrême droite ». Mais ils sont allés plus loin : mise en doute des insultes racistes pourtant consignées dans le procès-verbal, suspicion d’un « prisme idéologique » chez les gendarmes, accusation contre la maire de Romans-sur-Isère de « jeter de l’huile sur le feu ».
Autant d’affirmations accueillies sans contradiction par les journalistes du service public. Dès les premiers jours, l’éditorialiste Patrick Cohen avait donné le ton en parlant d’une « mécanique de la haine et du mensonge », visant explicitement la droite. Des propos qui lui ont valu un recadrage de l’Arcom. Mais l’essentiel est ailleurs : plutôt que d’éclairer un drame, l’audiovisuel public en a proposé une lecture biaisée, confortant un récit politique au détriment des faits.
L’affaire Meurice
Le 29 octobre 2023, Guillaume Meurice provoque un tollé en qualifiant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de « nazi sans prépuce » dans l’émission « Le Grand Dimanche soir ». Des propos tenus en plein conflit Israël-Hamas qui lui vaudront, quelques mois plus tard, un licenciement pour « déloyauté répétée » envers Radio France.
Meurice n’est pas un cas isolé. Les chroniques visant le catholicisme sont devenues monnaie courante. Le 20 mai 2024, l’humoriste suisse Rébecca Balestra, censée commenter l’élection du pape Léon XIV, improvise un sketch de trois minutes réduisant l’Église à une métaphore des abus sexuels sur mineurs. Déjà, en novembre 2022, au moment où l’institution était secouée par le rapport Sauvé, le journaliste Jean Lebrun signait une chronique au vitriol : « Manif pour tous, rapport Sauvé : les responsabilités des catholiques qui ne sont pas les leurs. » Il la concluait par cette pique sur la confession : « On enlève un vêtement après avoir avoué un péché, c’est difficile à croire. » Provocations gratuites pour certains, humour corrosif pour d’autres : reste que le service public s’autorise rarement la même virulence lorsqu’il s’agit d’autres religions ou d’autres idéologies. Un déséquilibre qui nourrit, là encore, le soupçon de partialité.
Une déconstruction manquée
« Déconstruire le roman national » : tel était l’objectif affiché par les promoteurs de Notre histoire de France, série documentaire diffusée en octobre 2024 par France Télévisions. Six épisodes de 52 minutes pour, selon son narrateur Tomer Sisley, « déconstruire les idées reçues » avec « un regard averti et peut-être un peu plus moderne ». Un manifeste digne des zélateurs de la déconstruction, censé s’opposer aux « chantres du roman national ».
Une fois à l’écran, la promesse tourne court. Loin d’offrir un récit neuf, la série recycle des épisodes déjà connus, enrobés de fioritures romancées. Seules quelques provocations ponctuent le récit : les « rapports homosexuels » supposés des guerriers gaulois, un évêque saint Remi réduit à un gourou manipulateur, ou encore des idylles improbables entre croisés et femmes syriennes. Des trouvailles plus gadgets que des révélations, qui n’apportent ni profondeur ni véritable modernité.
L’accueil critique a d’ailleurs viré à la douche froide. Même Libération, enthousiaste avant la diffusion, avouait sa déception devant une déconstruction inaboutie : « Peut-on écrire Notre histoire de France sans tomber dans le roman national ? » Autrement dit : l’ambition de déconstruire a accouché d’un récit convenu – ni roman, ni histoire, mais simplement raté.
Télécharger l’application Le Journal du Dimanche pour iPhone, iPad ou Android