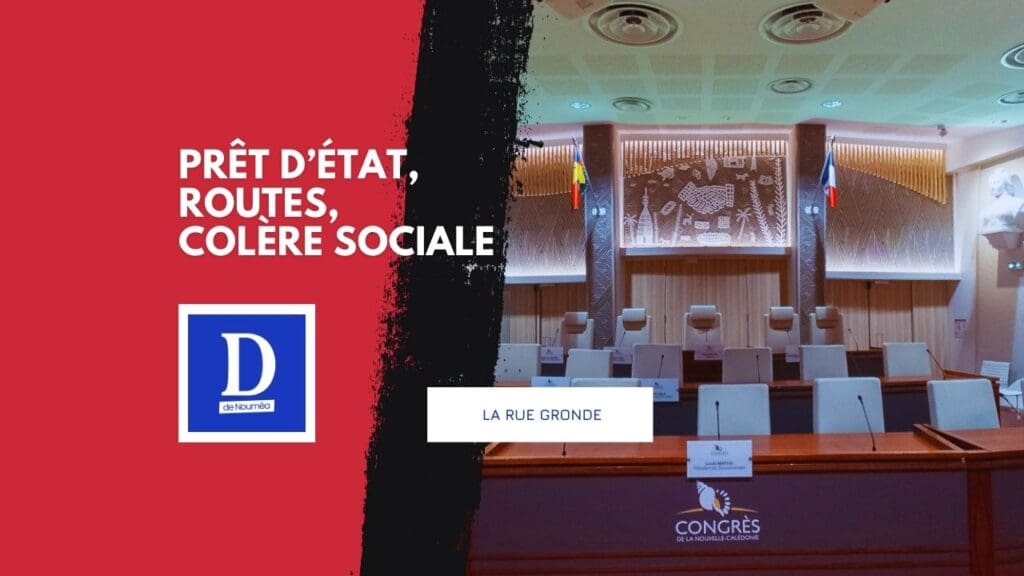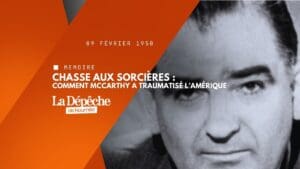Les municipales approchent à grands pas. Les 15 et 22 mars 2026, les Français éliront leurs conseils municipaux, socle de la vie démocratique locale. Mais derrière ce rendez-vous électoral, se cache une réalité trop souvent oubliée : qu’est-ce qu’une commune en France et quel est son rôle concret dans notre quotidien ?
La commune héritage révolutionnaire et pilier du modèle français
La commune est la plus petite collectivité territoriale de France, mais aussi la plus proche des citoyens. Son existence remonte au décret du 14 décembre 1789 qui érigea en municipalités les paroisses, villages et bourgs. En 1793, le terme de commune s’impose, et il perdure aujourd’hui. Depuis la loi municipale de 1884, chaque commune est administrée par un conseil municipal élu au suffrage universel direct et par un maire choisi par ce conseil. Cette architecture simple mais efficace assure un lien direct entre habitants et décideurs locaux.
Au 1er janvier 2025, selon La direction générale des Collectivités locales (DGCL), la France comptait 34 875 communes en métropole et outre-mer. Un chiffre colossal : la France détient près de 40 % des communes de l’Union européenne à elle seule. 97 % d’entre elles abritent moins de 10 000 habitants, tandis que seules 42 dépassent les 100 000 habitants. Un maillage unique au monde qui témoigne d’une volonté farouche de proximité.
C’est ce modèle qui fait de la commune un pilier de notre identité républicaine. Là où d’autres pays comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne ont drastiquement réduit le nombre de leurs communes, la France a choisi de préserver cette architecture locale, garante de la diversité et de la démocratie de proximité.
Des compétences multiples au service des citoyens
La commune n’est pas un simple symbole : c’est une institution de terrain. Elle détient une compétence générale pour toute affaire d’intérêt communal et gère directement des domaines clés :
-
L’urbanisme et l’aménagement : la délivrance des permis de construire, le plan local d’urbanisme.
-
Le logement social : l’autorisation et la mise en œuvre d’opérations d’aménagement.
-
L’éducation : la gestion des écoles maternelles et élémentaires, l’entretien des locaux et les financements.
-
L’action sociale : les centres communaux d’action sociale (CCAS).
-
La jeunesse et petite enfance : le recensement des besoins, la planification des modes d’accueil.
-
La culture, sport et tourisme : les bibliothèques, les stades, les offices du tourisme, les campings.
C’est ce pouvoir concret qui fait de la commune un acteur incontournable. Dans les villages comme dans les grandes villes, le maire est la figure républicaine la plus respectée des Français, car il incarne cette proximité que ni l’État ni les régions ne peuvent offrir.
Les communes nouvelles : la difficile rationalisation du mille-feuille territorial
Depuis 2010, l’État a cherché à réduire l’« émiettement communal » en créant le dispositif des communes nouvelles. La loi du 16 décembre 2010 a posé le cadre, complété en 2015 et 2019. Objectif : encourager les fusions pour rendre les collectivités plus fortes et plus efficaces.
Pourtant, les résultats restent mitigés. Entre 2010 et 2022, 787 communes nouvelles ont vu le jour, fusionnant 2 536 communes. Un recul de seulement 5 % du nombre total. En 2023, à peine 11 communes nouvelles ont été créées. Le bilan est jugé « décevant » par l’Inspection générale de l’administration.
Pourquoi ce blocage ? Parce que les communes ne sont pas de simples entités administratives : elles portent une identité historique et culturelle. Les Français restent attachés à leur clocher, à leur mairie, à ce lien ancestral qui fait de la commune bien plus qu’un découpage territorial.
La Cour des comptes elle-même, dans son rapport 2023 sur la décentralisation, déplore « la persistance d’un nombre excessif de petites communes ». Mais ce constat oublie l’essentiel : cette organisation est le ciment du modèle français, le fruit de la Révolution, garantissant une proximité démocratique unique en Europe.
Les municipales des 15 et 22 mars 2026 ne sont pas un scrutin secondaire. Elles conditionnent l’avenir de la France des territoires, celle qui entretient nos écoles, nos routes, notre patrimoine. Derrière chaque maire élu, c’est une conception de la France qui s’exprime : celle d’un pays attaché à ses racines, à ses villages, à sa démocratie de proximité.
À l’heure où certains rêvent d’une rationalisation bureaucratique, il faut rappeler que la commune n’est pas un poids, mais une force. Elle est l’incarnation de la France réelle, celle qui vit, qui décide, et qui construit au quotidien le destin national.