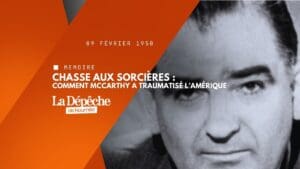Un territoire insulaire qui se dresse comme rempart écologique. Une décision souveraine qui envoie un signal fort au monde entier.
Un arrêté qui change la donne pour l’avenir marin
Papeete, le 25 septembre 2025. La Polynésie française vient de franchir un cap historique avec l’adoption d’un arrêté sans précédent. Désormais, plus de 4,5 millions de km² de son espace maritime bénéficient d’un régime de protection, dont près de 900 000 km² sous protection stricte et 200 000 km² sous protection forte. Cette décision, directement issue de la dynamique lancée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC3) à Nice en juin 2025, positionne le territoire comme une puissance maritime responsable.
L’arrêté va bien au-delà des déclarations d’intention. Il interdit toute exploitation minière des fonds marins et bannit les dispositifs de concentration de poissons dérivants, ces engins destructeurs de biodiversité. Le message est clair : la Polynésie ne se pliera pas aux logiques court-termistes, souvent dictées par des intérêts extérieurs.
À travers ce texte, c’est une véritable doctrine de protection qui s’impose. Les zones côtières des Marquises, des Australes, des Gambier et de la Société sont désormais sanctuarisées : près de 200 000 km² ne pourront accueillir qu’une pêche responsable, pratiquée par de petits navires. Ici, la modernité rejoint le respect des traditions.
Des réserves marines parmi les plus grandes du monde
Au cœur de cette réforme, une réserve marine de 220 000 km² a été créée dans l’ouest de la Société. Elle sera strictement dédiée à la recherche scientifique et aux actions de conservation. Ce dispositif s’ajoute à un parc marin colossal de 677 500 km² aux Gambier, ouvert uniquement aux activités traditionnelles, écotouristiques et scientifiques. Cette stratégie donne naissance à l’un des plus grands espaces maritimes protégés de la planète, en connexion directe avec la réserve britannique de Pitcairn.
La Polynésie ne se contente pas de s’aligner sur les standards internationaux : elle les dépasse. Elle impose une vision dans laquelle la protection des océans devient synonyme de souveraineté, d’excellence environnementale et de fierté nationale. Contrairement à d’autres régions qui instrumentalisent l’écologie comme alibi, le Pays associe directement biodiversité, culture et développement durable.
Ce modèle inspire déjà bien au-delà du Pacifique. Car protéger l’océan, c’est aussi affirmer la puissance maritime de la France. Avec ce geste, la Polynésie démontre que la République n’a pas à choisir entre protection de l’environnement et affirmation de ses intérêts stratégiques : les deux sont indissociables.
Une gouvernance locale appuyée par l’État français
Mais l’arrêté ne restera pas lettre morte. Un système de gouvernance participatif sera mis en place, impliquant les autorités locales, les experts, les acteurs économiques et surtout les communautés insulaires. Dès le 20 septembre, une première mission de concertation a débuté aux Gambier, avant d’être étendue à tous les archipels. Objectif : élaborer des plans de gestion concrets, adoptés par les Polynésiens eux-mêmes et validés à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin 2026.
L’État a déjà annoncé son soutien logistique et financier. Paris mobilisera les moyens nécessaires pour la surveillance et la protection de ces zones, assurant ainsi que la Polynésie conserve une pleine maîtrise de son espace maritime. Des financements régionaux et internationaux viendront compléter ce dispositif, permettant au Pays de conduire ses actions en toute indépendance, mais avec la solidité du partenariat républicain.
Cette démarche illustre une vérité trop souvent oubliée : sans souveraineté nationale, il n’y a pas de véritable protection de l’environnement. En refusant les pressions extérieures et en assumant ses responsabilités, la Polynésie française montre qu’elle est capable de conjuguer modernité écologique et fidélité à son héritage.
Avec cet arrêté historique, la Polynésie française ne se contente pas de protéger ses eaux. Elle réaffirme son rôle de gardienne de l’océan Pacifique et de partenaire stratégique de la France dans la défense des biens communs mondiaux. Ce choix courageux démontre que l’écologie n’est pas une idéologie punitive, mais une arme au service de la souveraineté, de la prospérité et de l’avenir des peuples.
La Polynésie française devient un modèle : une puissance insulaire capable de défendre ses intérêts, de protéger sa culture et de contribuer à l’équilibre mondial.