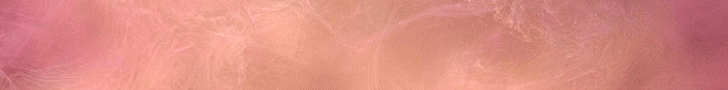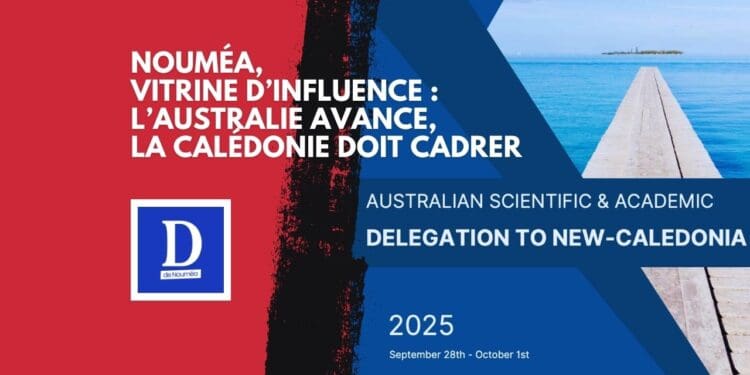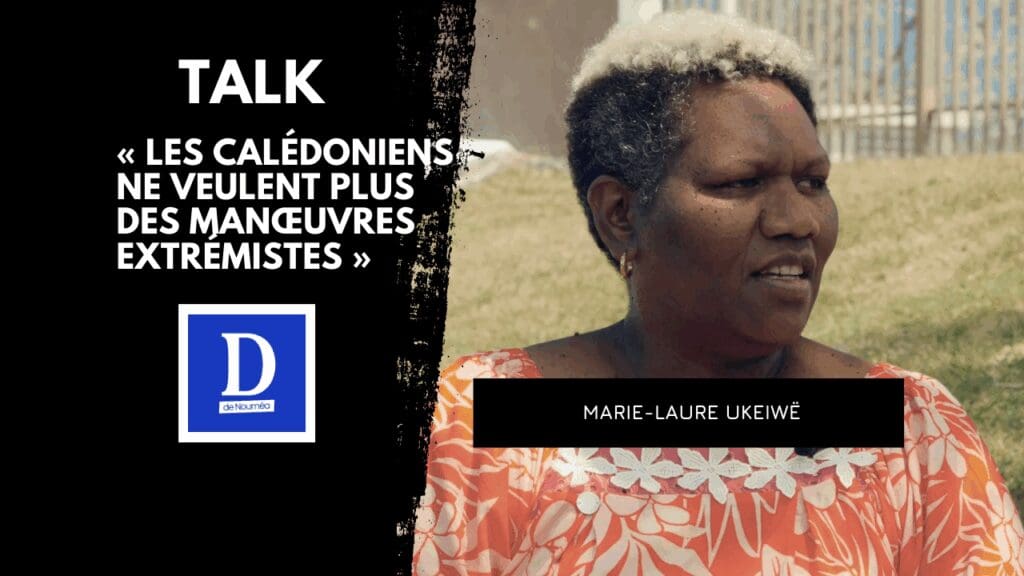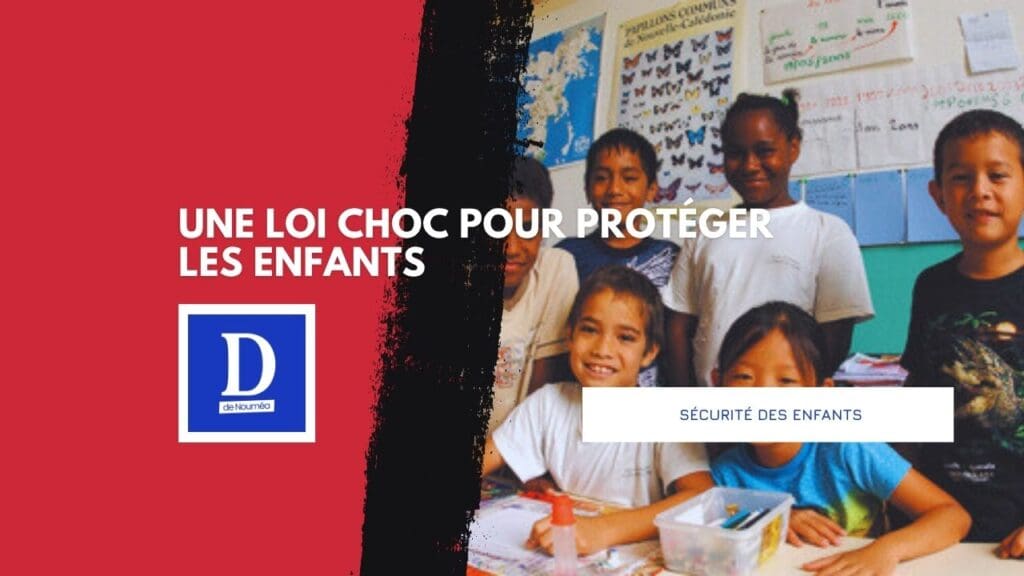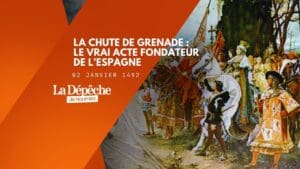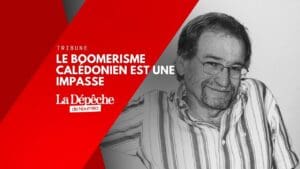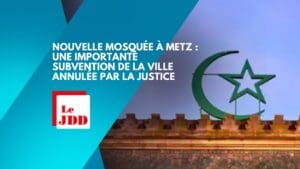La scène est posée : du 28 septembre au 1ᵉʳ octobre, une délégation académique australienne s’invite à Nouméa. Derrière les échanges courtois, une bataille feutrée : qui fixe l’agenda, capte les talents et oriente la recherche ? À l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), on parle « coopération » ; à Canberra, on pense « intérêts stratégiques » ; à Paris, on organise « complémentarités ». La question est simple : qui tient le volant de la connaissance dans le Pacifique, « ici et maintenant » ?
Le pouvoir d’influence entre à l’amphi : science, bourses, réseaux
Derrière les sourires, il y a une méthode. Le Secrétariat permanent pour le Pacifique (PSKP côté français) s’inscrit « dans une feuille de route bilatérale » avec l’Australie, dont l’objectif affiché est « tisser des liens institutionnels solides ». En clair : définir les sujets, les équipes et les flux, « sans perdre de temps ». L’« expérience » polynésienne de février a montré la voie : le politique cadre, « la science exécute », « le territoire s’aligne ». À Nouméa, l’UNC a accueilli le 29 septembre une séquence dédiée pour « développer davantage les collaborations » : beau symbole, « enjeu concret ».
L’arsenal australien : académies, ministères, universités, relais
Côté australien, la puissance est organisée. Les académies nationales couvrent « sciences, humanités, santé, technologies » avec des priorités assumées : « intelligence artificielle, robotique, sciences quantiques, climat, biodiversité ». Traduction locale : des techno-sciences qui pèsent sur l’économie et la sécurité, « sans états d’âme ». La santé sert aussi de levier, « au service des communautés locales », avec un triptyque « science, équité, diplomatie ». Le ministère des Affaires étrangères australien porte un mélange de politiques publiques : programmes de recherche pacifique, bourses régionales, normes techniques, « résilience et gouvernance » – la boîte à outils de la puissance, « claire et efficace ». Les universités complètent l’ensemble, « profondes et connectées ». La French-Australian Association for Research (AFRAN) agit en pont avec des amorçages financiers (« petites sommes, grands effets »), communautés thématiques et « premiers projets concrets ».
Le camp calédonien : des bases solides, des enjeux immenses
En face, la CRESICA rappelle sa mission : « coordonner la science, renforcer l’innovation » autour de trois axes : capital naturel, santé & société, évolutions institutionnelles – avec climat et insularité en transversal, « où tout se joue ». L’UNC revendique « 50+ formations », « ≈300 publications par an », un ancrage PIURN et « 40+ accords internationaux » – capacité d’absorber des partenariats, « à condition d’en fixer le cap ». Le socle scientifique local est robuste : IRD (océan, climat, biodiversité, sociétés), CNRS (génie écologique, chimie verte, ressources), Ifremer (aquaculture, microalgues, récifs), IPNC (arboviroses, antibiorésistance, surveillance). « Des laboratoires au contact du réel », indispensables. Chez Ifremer, des projets relient économie et écologie : aquaculture durable, microalgues, pressions récif-lagon – « notre capital marin : atout et vulnérabilité ».
Diplomatie du savoir : qui cadre les priorités, tient le volant ?
Tout tient dans une formule : « tisser des liens institutionnels ». Celui qui tisse, choisit : quoi, avec qui, pour quel usage, « et pour quel territoire ». Définir les priorités, c’est allouer les cerveaux, les thèses et les budgets, « sans détour ». La séquence UNC vise à « développer encore les collaborations ». Très bien. « Mais dans quel ordre d’intérêts » : territorial d’abord, national ensuite, régional enfin ? La question n’est pas polémique, « elle est stratégique ». En face, l’appareil australien met en avant des « défis communs ». C’est vrai… et politique : la science oriente l’agriculture, l’énergie, la santé, « donc la souveraineté ». Les bourses, programmes et normes affichent « renforcer résilience et capacités » : langage du partenariat, « architecture d’influence réelle ».
Le terrain décisif : talents, données, copublications
La puissance se mesure en flux : étudiants, jeunes chercheurs, données (observations, biobanques), copublications. « Qui capte, cadre ». UNC-CRESICA doit tenir la plume : de PIURN aux UMR locales, « écrire depuis Nouméa ». « Soutenir des politiques publiques fondées sur la preuve » exige une preuve locale, « pas importée ». Santé et mer sont des tests de souveraineté : à l’IPNC, « surveillance et suivi des vecteurs » créent des réflexes collectifs ; chez Ifremer, « intensification écologique et développement économique » lient pêche, aquaculture, industrie. « Le pays se joue là », sans ambiguïté.
Lignes rouges et opportunités : coopérer sans dépendre
Oui à la coopération, non à la dépendance. La Calédonie a de quoi imposer ses clés d’entrée, « sans fracas, mais avec clarté » :
– Programmer localement les appels à projets autour des trois axes CRESICA, « sans dispersion ».
– Conditionner les partenariats : hébergement local des données, co-responsable scientifique calédonien, modules certifiants à l’UNC, co-propriété des résultats – « on ne brade pas les cerveaux ».
– Capitaliser sur les forces : UMR IRD-UNC, IPNC, Ifremer, CNRS – « des piliers, pas des vitrines ».
Le temps long : de la thèse à l’industrie
La chaîne de valeur doit aller du doctorat au marché. Les académies australiennes promeuvent des parcours scientifiques connectant industrie et décideurs, « méthode éprouvée ». À l’UNC, PUNC, 300 publications/an et diplômes doivent irriguer Station N, French Tech NC et les clusters mer, agro-alimentaire, éco-construction. « Le savoir qui ne se transforme pas » reste un luxe coûteux, « que nous n’avons plus ». Former, retenir, rapatrier : les bourses régionales sont utiles si elles s’inscrivent dans un contrat territorial : « retour de compétences », parcours UNC-PIURN, ancrage dans les filières.
Gouvernance : qui décide, où, et selon quelles clauses ?
Trois niveaux doivent être hiérarchisés :
- Intérêt territorial : « besoins de santé publique, littoral, énergie ».
- Cadre national : « complémentarités scientifiques, sécurité, normes ».
- Régional : « coopération et interopérabilité ».
Mécaniquement, imposer des clauses-cadres : « priorités publiées », comités éthiques locaux, réversibilité des données, évaluation annuelle des impacts. Sans cela, « les flux décident à notre place ».
Budget, calendrier, répartition : la discipline avant la dépense
Pas de saupoudrage : « financer ce qui sert le pays ». Un calendrier clair : 12 mois pour programmer, 24 mois pour publier, 36 mois pour transférer – avec indicateurs : thèses soutenues, jeunes chercheurs recrutés, brevets/logiciels déposés, données ouvertes. « La rigueur budgétaire » protège la souveraineté, « pas l’inverse ».
Et maintenant ?
La fenêtre d’opportunité est rare : l’Australie avance, la France structure, la Calédonie choisit. L’invitation de l’UNC « développer davantage les collaborations » doit se lire : développer notre capacité à décider. Coopérer, oui ; s’effacer, non. « À une condition » : écrire les règles ici, pour que chaque bourse, chaque projet, chaque donnée renforce le pays. C’est maintenant, « pas demain ».