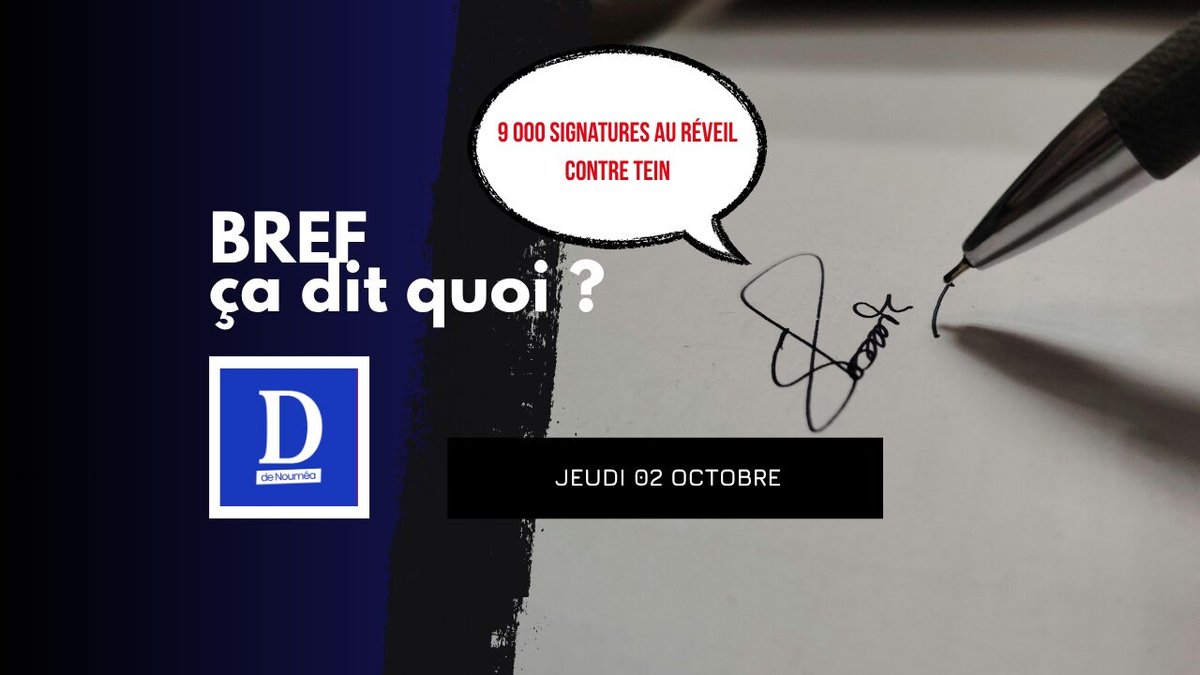1942 : quand Washington a envisagé la Nouvelle-Calédonie !
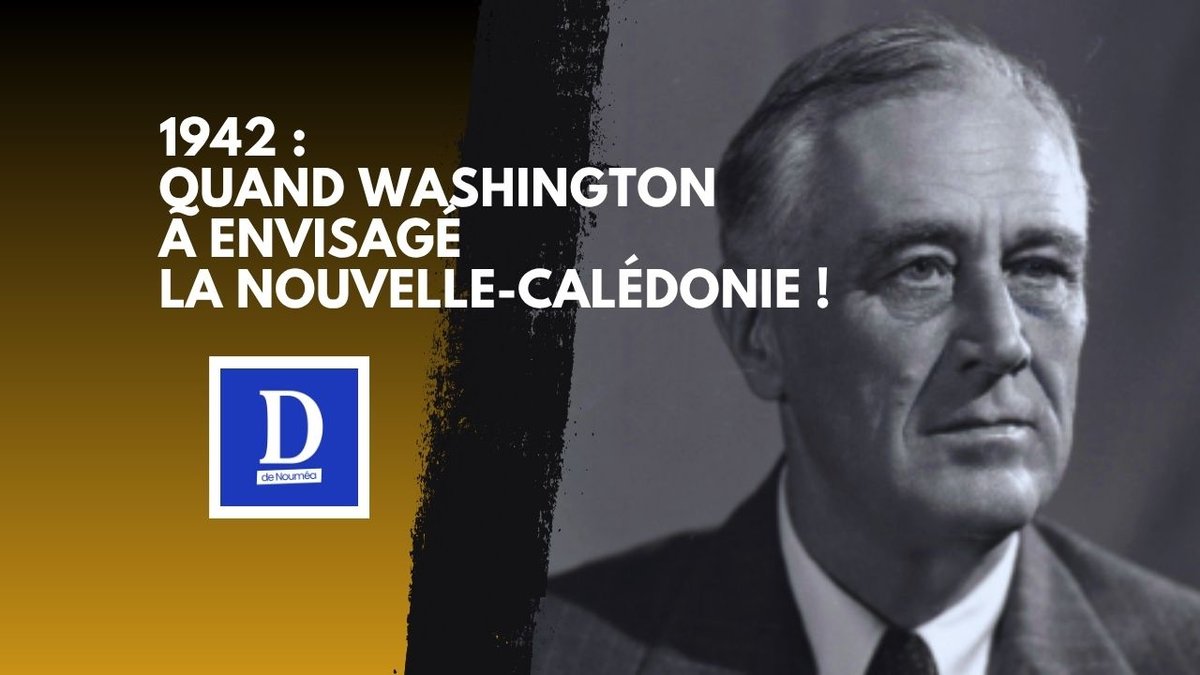
Un précédent historique qui résonne aujourd’hui, alors que le Pacifique redevient un champ de confrontation stratégique.
Roosevelt et l’ombre de l’annexion
Mars 1942. À Nouméa, des divisions américaines débarquent pour défendre l’archipel face à l’Empire du Japon. Très vite, la base logistique explose : aérodromes, chantiers navals, hôpitaux, dépôts. Les chiffres donnent le vertige :
- Au total, plus de 1,2 million de soldats américains ont transité par la Nouvelle-Calédonie pendant la guerre.
- Jusqu’à 200 000 militaires stationnés (pour 50 000 habitants)
- Cela représente un soldat américain sur 12 de toute la Seconde Guerre mondiale.
- Et, si l’on regarde uniquement le théâtre du Pacifique, près d’un soldat sur cinq y est passé.
Dans ce contexte, le président Franklin Roosevelt alla plus loin qu’on ne l’imagine : il envisagea de transformer la Nouvelle-Calédonie en emprise directe américaine, une forme d’annexion. L’idée s’inscrivait dans la logique des prêts-bails, ces aides colossales fournies par Washington aux alliés — que Roosevelt voyait comme un « crédit à rembourser ». Pour lui, la Calédonie pouvait constituer une monnaie d’échange : un point d’appui stratégique payé en nature par une France Libre jugée arrogante et incapable de défendre la zone.
Le Non du Général
Mais ce projet se heurta à deux obstacles :
- La crainte d’aliéner de Gaulle et d’ouvrir une crise diplomatique majeure avec une France qui restait un allié symbolique incontournable.
- La recomposition mondiale de l’après-guerre : face à l’URSS, Roosevelt savait qu’il lui fallait maintenir l’équilibre occidental.
Le projet d’annexion fut donc abandonné, mais il révèle à quel point la Nouvelle-Calédonie fut perçue comme un atout de premier plan dans la stratégie américaine.
Un verrou stratégique hier comme aujourd’hui
Cette histoire oubliée dit une chose simple : la Nouvelle-Calédonie n’a jamais été périphérique. Sa position au cœur du Pacifique sud, ses ressources minières, sa proximité avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande en font un verrou stratégique. Hier, il s’agissait de couper la route aux forces de l’Axe. Aujourd’hui, c’est la rivalité sino-américaine autour de Taïwan qui redonne à l’archipel une place clé.
Le dilemme français
La France reste officiellement la puissance souveraine. Elle siège au Conseil de sécurité, affiche sa stratégie indo-pacifique et ses valeurs. Mais la réalité opérationnelle est moins flatteuse : effectifs réduits, matériels vieillissants, moyens navals et aériens sous-dimensionnés. Autrement dit, en cas de crise majeure, Paris pourrait difficilement tenir seul le rôle de garant régional.
Si Taïwan s’embrase…
Que se passerait-il si la Chine tentait d’annexer Taïwan ? La réponse américaine serait immédiate : sécuriser les routes maritimes, protéger les alliés, tenir les points d’appui. Dans ce scénario, la Nouvelle-Calédonie redeviendrait un maillon vital. Les acteurs locaux, coutumiers comme élus, verraient leur marge de manœuvre réduite à néant. La protection viendrait de ceux qui peuvent réellement la fournir.
La leçon de 1942
Le précédent Roosevelt rappelle une vérité simple : quand un intérêt vital est en jeu, les grandes puissances agissent. La question n’est donc pas de savoir si la Nouvelle-Calédonie est stratégique. Elle l’est déjà.
La question est : qui la sécurisera, et selon quelles conditions ?
Sources et références
- Antoine-Louis de Prémonville, La Nouvelle-Calédonie, un atout stratégique méconnu dans le Pacifique, revue Conflits, 13 décembre 2021.
- Jean-Marc Regnault & Ismet Kurtovitch, Les ralliements du Pacifique en 1940, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°49-4, 2002.
- Kim Munholland, Rock of Contention: Free French and Americans at War in New Caledonia, 1940–1945, Berghahn Books, 2007.
- Robert Aldrich, France and the South Pacific since 1940, Macmillan, 1993.
- Données historiques US Army & Navy sur les effectifs dans le Pacifique (archives militaires, synthèses Conflits 2021).