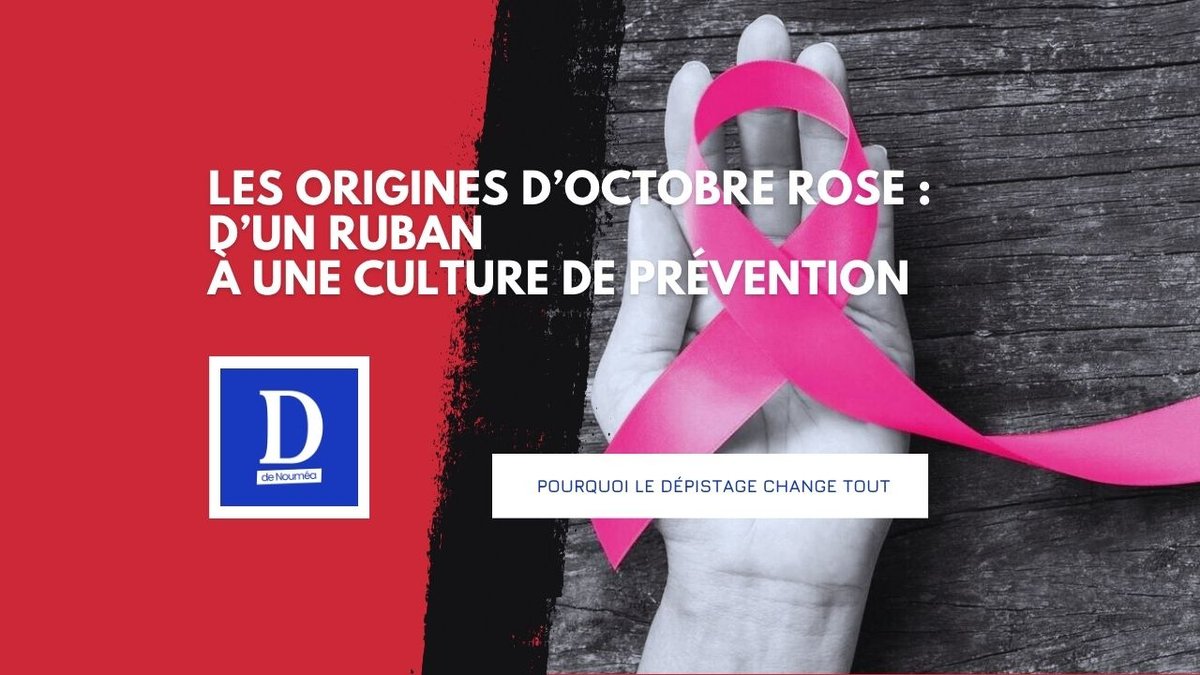Banques du Pacifique : la fin du racket bancaire ?

Le portefeuille des Calédoniens sous pression, mais la maîtrise reste au rendez-vous. Malgré la hausse générale des prix, les banques locales tiennent leurs engagements et préservent un équilibre rare dans un contexte mondial de flambée financière.
Des hausses contenues, des engagements respectés
Entre avril 2024 et avril 2025, les banques du Pacifique ont relevé dix-sept tarifs, dont dix à la hausse.
Mais, contrairement à la métropole, ces augmentations demeurent modérées et encadrées par les accords locaux signés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les cartes à débit immédiat et à autorisation systématique sont les plus touchées : +3,39 % et +3,86 %, soit +171 F CFP et +143 F CFP.
Pourtant, les hausses métropolitaines, elles, dépassent souvent les 200 F CFP. Ce différentiel illustre une réalité simple : le système bancaire local agit avec mesure, loin des pratiques inflationnistes continentales.
En Nouvelle-Calédonie, la tenue de compte augmente de 7,83 %, mais reste inférieure de près de 19 % à celle de la métropole. En Polynésie française, elle baisse légèrement (-0,51 %). Quant à Wallis-et-Futuna, la stabilité domine.
Cette modération n’est pas un hasard : elle résulte d’une concertation organisée sous l’égide du Haut-Commissariat et de l’IEOM, qui fixent chaque année les plafonds de tarifs.
Une régulation « à la calédonienne » : responsable, concertée et sans dogmatisme.
La gratuité comme arme de compétitivité
Alors que les banques métropolitaines font payer chaque clic, les établissements calédoniens jouent la carte de la proximité : virements internet, paiements par prélèvement et certains retraits sont entièrement gratuits.
Le tarif d’abonnement aux services en ligne a chuté de 40,85 % en un an, pour s’établir à 42 F CFP en moyenne. En Nouvelle-Calédonie, quatre banques sur cinq sont déjà passées à la gratuité totale — une première en Outre-mer. Le nouvel accord signé fin 2024 prévoit la disparition complète de ces frais d’ici fin 2025.
Depuis 2014, le tarif moyen pour gérer ses comptes en ligne a été divisé par quinze : un chiffre spectaculaire dans un monde où tout devient payant.
C’est une victoire concrète pour le consommateur, obtenue sans subvention publique ni contrainte législative — la preuve qu’une économie de marché encadrée peut aussi produire du pouvoir d’achat.
Vers une convergence réussie avec la métropole
L’objectif fixé par le rapport Constans en 2014 — rapprocher les tarifs des Outre-mer de ceux de la métropole — est désormais presque atteint.
En 2025, cinq tarifs sur quatorze sont inférieurs à la moyenne métropolitaine : un record.
Les écarts se resserrent : les frais de tenue de compte, longtemps symbole du fossé avec Paris, ne dépassent plus 543 F CFP, contre 2 957 F CFP dix ans plus tôt.
La carte à débit différé, jadis plus chère, est désormais meilleur marché qu’en métropole.
Même constat face aux DCOM de la zone euro : huit tarifs sur dix-sept sont désormais inférieurs, notamment celui de la carte à autorisation systématique, 466 F CFP moins chère qu’en Guadeloupe ou à La Réunion.
Cette convergence n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une discipline économique assumée, portée par les banques locales et l’État, sans laxisme ni sur-régulation.
Les hausses ciblées permettent aux établissements de maintenir leur rentabilité, indispensable à l’investissement local et à l’emploi bancaire. En retour, la transparence tarifaire et les accords triennaux garantissent au public une visibilité rare sur l’évolution des prix.
L’IEOM et le Haut-Commissariat jouent ici un rôle d’équilibre : pas d’ingérence, mais une vigilance pragmatique, fondée sur la donnée et la concertation.
À l’heure où la métropole multiplie taxes et réglementations, la Nouvelle-Calédonie prouve qu’un modèle libéral, mais régulé, peut servir l’intérêt général.
Moins d’idéologie, plus d’efficacité : voilà la leçon économique du Pacifique français.