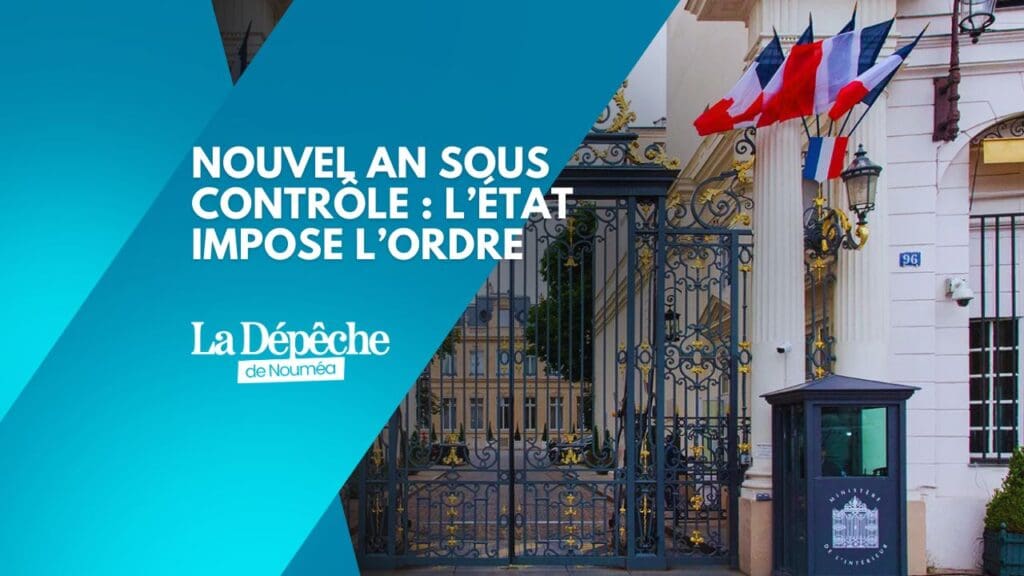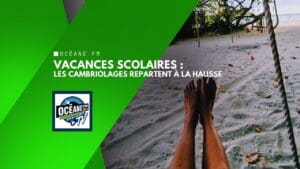La France parle encore plus de soixante-dix langues, mais leur voix s’étouffe dans l’indifférence bureaucratique. L’État promet la protection, mais tarde à donner les moyens de la transmission.
Une ambition nationale, un terrain miné
Un rapport sénatorial en date du 5 octobre dernier dresse un bilan contrasté des dispositions de la loi Molac sur l’enseignement des langues régionales de l’Hexagone et avance des pistes de progrès. En 2021, la loi Molac voulait enfin sortir les langues régionales de la marginalité institutionnelle. Pour la première fois, l’État se reconnaissait comme acteur de leur enseignement, de leur diffusion et de leur protection patrimoniale. Une avancée attendue, tant la transmission familiale a disparu presque partout.
Mais cette dynamique s’est heurtée au Conseil constitutionnel, qui a censuré les articles les plus structurants, notamment l’immersion. Dans les territoires, la décision est vécue comme une sanction infligée à des réseaux qui forment pourtant des élèves parfaitement à l’aise en français. La circulaire de 2021 a tenté d’apaiser la crise en assouplissant l’enseignement bilingue, en élargissant la liste des langues et en missionnant le CNED. Une correction, pas une relance.
En filigrane se dessine une tension bien française : proclamer la protection d’un patrimoine tout en hésitant à assumer son enseignement intensif. L’État reconnaît, mais n’assume pas toujours ; les collectivités veulent, mais manquent de leviers.
Un bilan 2025 qui montre l’effort, mais aussi le décrochage
Le rapport sénatorial d’octobre 2025 constate quelques progrès, mais déplore une dynamique insuffisante.
Les chiffres témoignent d’un sursaut réel :
• 107 000 élèves en primaire apprennent une langue régionale (+47 % en deux ans).
• 168 000 élèves du primaire au lycée suivent ces enseignements.
Cette hausse survient dans un contexte de baisse démographique générale des effectifs scolaires, ce qui souligne l’intérêt croissant des familles. Mais elle ne rattrape pas la chute du nombre de locuteurs. En Bretagne, 60 % des brittophones ont plus de 60 ans : l’érosion est structurelle.
Le secondaire constitue la rupture majeure : l’entrée en collège puis au lycée entraîne un abandon massif. Les réformes du baccalauréat ont affaibli la place des options, rendant les parcours bilingues moins attractifs. Résultat : peu d’élèves maintiennent une langue régionale jusqu’à la terminale.
S’ajoutent des blocages persistants :
• ouverture de filières au rythme du « parcours du combattant »,
• tensions financières autour du forfait scolaire pour les établissements immersifs privés,
• conventions État-collectivités inégales, parfois inappliquées,
• pénurie criante d’enseignants, frein n°1 à tout développement.
L’ensemble forme un paysage paradoxal : une demande sociale forte, une volonté institutionnelle affichée, et une machine administrative trop lente pour enrayer l’effondrement.
Cinq leviers pour éviter l’extinction annoncée
Face aux constats, le Sénat formule cinq priorités claires. Elles décrivent moins un idéal qu’un plan d’urgence.
1. Une véritable politique nationale.
Aujourd’hui, tout repose sur des rapports de force locaux. Le Sénat réclame enfin une ligne directrice claire, stable et assumée. Une politique linguistique n’est pas un luxe culturel : c’est un choix stratégique de Nation.
2. Une offre scolaire publique solide.
L’enseignement bilingue ne doit plus être confié uniquement aux réseaux associatifs. L’école publique doit porter cette mission, avec de vraies filières immersives et une continuité de la maternelle au lycée.
3. La sécurisation financière des réseaux immersifs.
Depuis trente ans, ils compensent les manques de l’État. Sans financement stable, ils ne survivront pas.
4. Un plan massif pour les enseignants.
Sans professeurs, aucune langue ne renaîtra. Le Sénat propose d’activer les ressources internes, de renforcer la formation initiale et d’outiller les enseignants sur le long terme.
5. Une valorisation scolaire réelle.
Épreuves en langue régionale aux examens, certifications officielles, reconnaissance dans le parcours : la visibilité institutionnelle doit remplacer la marginalité actuelle.
Le message est clair : à ce rythme, plusieurs langues pourraient s’éteindre dans un délai très court. Préserver ce patrimoine n’est pas un geste folklorique, mais une affirmation de souveraineté culturelle. Une France qui abandonne ses langues régionales laisse disparaître un pan entier de son histoire.