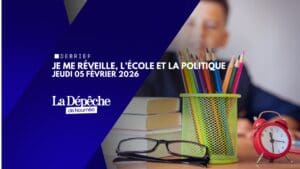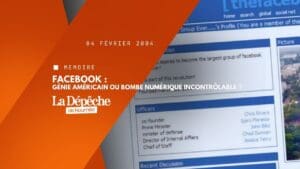Les frais de justice explosent, et les plans d’économies adoptés depuis 2022 n’ont pas tenu leurs promesses.
Un rapport conjoint de l’IGF, de l’IGA et de l’IGJ, mis en ligne le 28 octobre 2025, secoue le ministère de la Justice et renvoie chacun à ses responsabilités.
Un État qui dépense toujours plus malgré le recul de l’activité pénale
Le rapport, publié le 28 octobre 2025, dresse un constat sans détour : les frais de justice, ces dépenses que l’État prend à sa charge dans les procédures pénales, civiles et commerciales, ont explosé pour atteindre 716 millions d’euros (85,9 milliards de francs CFP) en 2024. C’est déjà 11 % du budget du ministère de la Justice, un niveau inédit, mais surtout une progression de 44 % depuis 2017. Et malgré les plans d’action annuels adoptés depuis 2022, rien n’y fait.
Pire encore : entre 2020 et 2021, la hausse a bondi de 13 %. Or, dans le même temps, l’activité pénale recule. Moins d’affaires, mais plus de dépenses. Le paradoxe n’est qu’apparent : la machine judiciaire s’est alourdie, les actes se multiplient, les prestations se renchérissent, et l’État continue de payer, souvent sans contrôle, parfois sans discernement.
Trois postes portent cette flambée : les expertises médicales, les mesures judiciaires et l’interprétariat-traduction, tous devenus des gouffres financiers. Entre les obligations légales nouvelles, les technologies plus coûteuses et les tarifs des prestataires privés en hausse continue, la facture s’emballe.
Le rapport pointe une vérité que certains responsables redoutaient de voir écrite noir sur blanc : plus la justice est sollicitée dans le cadre de politiques pénales automatiques, plus les coûts explosent. Et l’État avance les yeux fermés.
Une dérive structurelle : actes obligatoires, commandes publiques absentes, privatisation des missions
L’un des constats les plus sévères concerne le fonctionnement même de la chaîne pénale : la multiplication des actes par affaire. Les magistrats prescrivent davantage d’expertises, de mesures d’investigation, de traductions. Non par excès de zèle, mais parce que le droit les y oblige : expertises psychiatriques imposées, enquêtes techniques systématiques, procédures renforcées.
Résultat : un coût moyen par affaire qui s’envole.
À cela s’ajoute une réalité moins connue : l’État externalise des missions qu’il pourrait assurer lui-même. Interceptions téléphoniques confiées au privé, interprétariat sous-traité, enquêtes sociales rapides orientées vers des sociétés prestataires. La commande publique, pourtant présentée comme outil de rationalisation, est quasiment absente dans ce secteur.
Le plus inquiétant : chaque année, les dépenses dépassent les crédits prévus. Entre 2019 et 2024, l’écart moyen dépasse 5,4 %. Les réévaluations en cours d’exercice ne suffisent pas. Les factures s’accumulent. Le report de charges devient la norme. La dette finale atteint 318,4 millions d’euros (38,2 milliards de francs CFP) fin 2024. Autrement dit : l’État gère les frais de justice à crédit.
Ici, la ligne éditoriale du rapport rejoint l’évidence que beaucoup de responsables politiques n’osent pas assumer publiquement : la justice française souffre moins d’un manque de moyens que d’un manque de pilotage. La dépense est subie, rarement maîtrisée, souvent déresponsabilisée.
Des solutions fermes : désautomatiser, recouvrer, internaliser, responsabiliser
Face au dérapage, les inspections réunies formulent des recommandations sans ambiguïté. Leur fil directeur : reconquérir la maîtrise publique, sortir de la fuite en avant, et introduire de la performance là où règne l’habitude.
Première piste : revoir le cadre juridique. Certains actes obligatoires ne sont plus pertinents. Le rapport suggère de désautomatiser des prestations systématiques, comme certaines expertises psychiatriques. De réduire les tarifs, notamment dans les segments devenus incontrôlables. Et surtout, d’internaliser ce qui peut l’être : interceptions téléphoniques, interprétariat, enquêtes sociales rapides. Une manière de remettre l’État au centre du dispositif.
Deuxième orientation : élargir le recouvrement des frais de justice auprès des personnes condamnées. Aujourd’hui, trop peu paient réellement ce qu’ils doivent. Le rapport en appelle à un recouvrement plus large, plus ferme et surtout effectif. Une position de responsabilité individuelle, en rupture avec la culture de déresponsabilisation financière.
Troisième recommandation : professionnaliser la gestion des frais de justice. Fixer des objectifs chiffrés aux juridictions, développer des tableaux de bord, suivre les dépenses en temps réel, instaurer une logique de performance. Une démarche qui tranche avec le fonctionnement actuel, parfois laissé en roue libre.
Enfin, les inspections estiment que les économies générées pourraient permettre d’apurer la dette, à condition d’être accompagnées de recettes nouvelles. En clair : l’État peut reprendre la main, mais seulement s’il assume des choix forts, loin des discours complaisants.
Depuis 2022, chaque plan d’action annonçait des économies futures. Le rapport de 2025 montre une réalité plus rude : les frais de justice continuent de grimper, les crédits ne suffisent plus, la dette enfle, et l’État n’a pas corrigé les dérives structurelles.
Avec ce document, les inspections appellent à une rupture nette : moins d’automatismes, plus de contrôle, plus de responsabilité, plus d’internalisation. Une ligne claire, qui rejoint une réalité que beaucoup, à droite comme dans le champ régalien, défendent depuis longtemps : un État fort commence par un État qui maîtrise ce qu’il dépense.