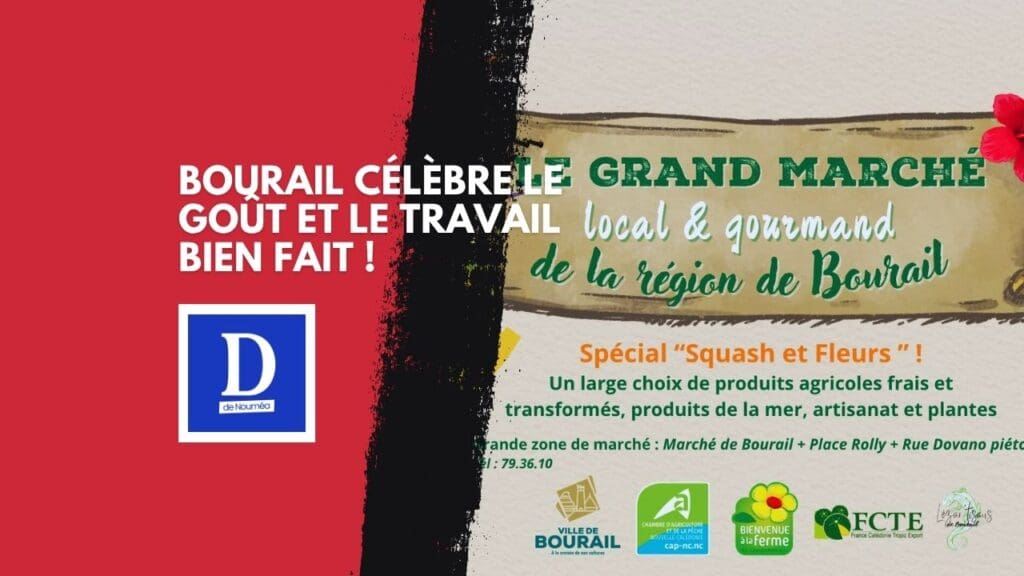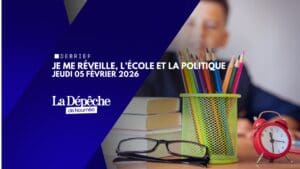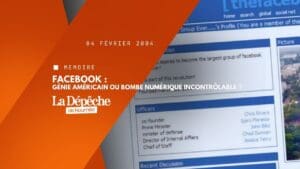Le 6 novembre, la planète observe la Journée internationale pour prévenir l’exploitation de l’environnement en temps de guerre et de conflit armé. Trop souvent oubliée, la nature figure pourtant parmi les premières victimes des conflits humains : forêts brûlées, nappes polluées, faune décimée. À l’heure où la guerre redevient une réalité sur plusieurs continents, cette journée prend un relief particulier. Elle nous rappelle une vérité simple : il n’y a pas de paix durable sans environnement préservé.
Les guerres écologiques : quand le sol devient champ de ruines
Derrière les chiffres de pertes humaines, se cache un autre désastre, silencieux mais durable : celui de l’environnement. Les Nations unies estiment que plus de 40 % des conflits internes des 60 dernières années sont liés à l’exploitation des ressources naturelles, qu’il s’agisse de pétrole, de bois ou de minerais. Les bombardements détruisent les sols, les usines de traitement laissent échapper des substances toxiques, et les rivières deviennent des décharges à ciel ouvert.
Des Balkans à l’Irak, du Congo à l’Ukraine, les exemples s’accumulent. Les mines antipersonnel continuent de polluer les terres longtemps après les combats, tandis que les incendies de puits de pétrole ont transformé des zones entières en paysages lunaires. La guerre moderne n’épargne rien : ni les arbres, ni les mers, ni même le climat.
La mobilisation internationale : du droit de la guerre au droit de la nature
Depuis 2001, cette journée mondiale, créée par l’ONU, vise à inscrire la protection de l’environnement dans le droit humanitaire international. L’objectif : faire reconnaître la destruction écologique comme un crime de guerre.
Si le principe existe déjà à travers la Convention de Genève et le Statut de Rome, il reste rarement appliqué. En 2025, des juristes militent pour que l’écocide soit intégré au corpus des crimes internationaux les plus graves, au même titre que les crimes contre l’humanité.
La guerre en Ukraine a notamment relancé le débat : destruction d’infrastructures pétrochimiques, pollution du Dnipro, contamination radioactive à Zaporijjia. Les experts de l’ONU alertent :
Chaque missile lancé sur une centrale ou un barrage est une bombe à retardement écologique
Nouvelle-Calédonie : une île en paix, mais vigilante
Loin des fronts armés, la Nouvelle-Calédonie connaît d’autres formes de fragilité environnementale, liées aux tensions économiques et minières. Ici, la guerre n’est pas militaire, mais elle oppose parfois développement industriel et préservation des écosystèmes.
L’exploitation du nickel, essentielle à l’économie locale, provoque érosion des sols, pollution des lagons et destruction de mangroves, menaçant directement un patrimoine inscrit à l’UNESCO. Dans les vallées du Sud comme sur la côte Est, les habitants observent avec inquiétude la lente dégradation des paysages.
Les autorités locales tentent de concilier croissance et durabilité : plan « Nickel responsable », études d’impact renforcées, et projets de réhabilitation écologique des sites miniers. Une bataille pacifique, mais stratégique : celle d’un territoire qui veut prouver qu’on peut produire sans détruire.
Car sur le Caillou, comme ailleurs, la nature est un capital de souveraineté : protéger l’environnement, c’est protéger la paix sociale et l’avenir.
Vers un nouvel équilibre planétaire
Cette journée du 6 novembre ne se limite pas à la dénonciation ; elle invite à repenser nos priorités. Les Nations unies appellent à inclure la dimension environnementale dans toutes les opérations de reconstruction et de maintien de la paix.
La nature ne connaît ni frontières ni drapeaux. Lorsqu’elle s’effondre, c’est toute l’humanité qui recule.