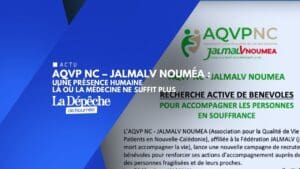Un week-end qui aurait pu virer au pire pour le pilote de parapente au sommet du Mont Dzumac à Dumbéa. Samedi 8 novembre vers 13 h 13, l’alerte est donnée : un parapentiste s’est écrasé dans une zone difficile d’accès. La localisation exacte pose un défi aux secours.
Un premier contact visuel a été établi vers 18 h 25
Finalement, après avoir passé la nuit sur place, il était « suffisamment équipé pour dormir en extérieur », l’hélitreuillage s’est effectué dimanche matin vers le Médipôle de Koutio pour un bilan médical.
Cet événement met en lumière une pratique qui séduit par son appel du large et du vertige mais qui, sans rigueur et vigilance, peut coûter très cher.
L’intervention au Mont Dzumac : déroulé et enjeux
La principale difficulté de l’opération a concerné la localisation précise de la victime, indispensable pour permettre l’acheminement des secours par voie aérienne.
Ce cas typique illustre :
- la difficulté d’accès aux zones accidentogènes en relief calédonien,
- l’importance de l’équipement individuel (le pilote avait du matériel pour survivre dehors),
- la mobilisation logistique importante de la Sécurité civile et de la gendarmerie.
Cela soulève un point clé : pratiquer le parapente ici ne relève pas du simple loisir, mais d’une activité à dimension « montagne tropicale » qui impose un niveau de préparation élevé.
Le parapente en Nouvelle-Calédonie : un terrain d’aventure exigeant
En Nouvelle-Calédonie, le parapente offre des panoramas spectaculaires, reliefs volcaniques, forêts denses, côtes abruptes. Le Mont Dzumac fait partie de ces sites prisés. Mais la géographie, les micro-climats, l’éloignement des secours et les contraintes d’équipement font de la pratique un défi.
Les données locales sont toutefois maigres. Un document indique sur le site de l’aviation civile :
3 accidents mortels en Nouvelle-Calédonie au cours des 5 dernières années
Ce chiffre regroupe probablement plusieurs types d’ULM ou vol libre, mais il donne un ordre de grandeur.
Il est donc indispensable que chaque pilote intègre les spécificités calédoniennes : vent thermique, zones non-accessibles, réseau parfois défaillant. L’accident de Dumbéa rappelle qu’un vol isolé peut déboucher sur une opération de secours lourde.
Risques et statistiques mondiales : comment se situe le Calédonien ?
À l’échelle internationale, la littérature établit des taux d’accident pour le parapente ainsi :
une étude de 2021 estime 1,4 morts pour 100 000 vols et environ 20 blessures graves pour 100 000 vols. Une autre source évoque une mortalité de 7 pour 100 000 sauts/vols. En France, on parle de 9 à 11 décès par an pour le parapente. Pour donner un ordre, cela équivaut à une très faible fréquence mais un risque bien réel.
En Nouvelle-Calédonie, l’absence de données précises sur le nombre de vols rend la comparaison délicate. Toutefois, si l’on retient les « 3 accidents mortels en 5 ans » pour tout vol libre/ULM, et que l’on suppose un nombre global de vols beaucoup plus élevé, on peut estimer que le taux est globalement comparable ou peut-être légèrement supérieur compte tenu des conditions terrain.
Ce qu’il faut retenir : la pratique du parapente reste modérément dangereuse selon les statistiques, mais l’environnement calédonien exige une vigilance renforcée.
Vers une pratique plus sûre : recommandations pour le terrain calédonien
L’accident de Dumbéa rappelle que même un bon équipement ne suffit pas sans anticiper toutes les variables : météo, itinéraire de sortie, secours. Parmi les recommandations :
- Avant tout vol, consulter la météo locale (thermique, vent, zones orographiques).
- Préparer un itinéraire de retour ou un plan d’atterrissage d’urgence.
- Être équipé d’un système de localisation (GPS/phone), d’un matériel de survie de base si zone isolée.
- Avoir une assurance et se voguer former régulièrement.
- Voler avec un pilote expérimenté ou en tandem si nouveau.
Le lien entre expérience, équipement et accident est bien documenté : les études montrent que l’erreur de pilotage, conditions adverses, fermeture de voile constituent les principales causes.
À titre d’objectif : viser à ce que chaque vol soit abordé comme un vol en zone « aventure » et non comme simple loisir.
Le sauvetage du parapentiste au Mont Dzumac est un avertissement pour tous : le ciel calédonien est beau, mais exigeant. Si les statistiques mondiales indiquent que le parapente demeure une activité à risque faible mais réel, dans les conditions particulières de la Nouvelle-Calédonie la marge d’erreur est réduite. À vous, pilotes ou futurs pratiquants : ne laissez rien au hasard. Assurez-vous, équipez-vous, anticipez. Et surtout… respectez le terrain.
Agissez maintenant : vérifiez votre matériel, formez-vous, partagez vos plans de vol. Une minute d’imprudence peut tout changer.