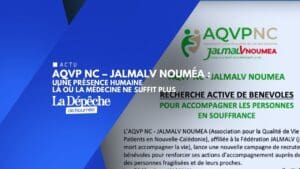À peine deux semaines après le sommet Xi–Trump en Corée du Sud, Pékin adresse un nouveau signal d’apaisement.
Et derrière ce geste, un message limpide : la Chine veut reprendre la main dans une bataille stratégique où les États-Unis refusent désormais de se laisser dicter les règles.
Pékin suspend une arme économique clé
Dimanche 9 novembre, Pékin a annoncé la suspension de l’interdiction d’exporter vers les États-Unis trois métaux stratégiques : le gallium, le germanium et l’antimoine.
Une volte-face spectaculaire, alors que cette mesure, présentée en décembre 2024, avait été assumée comme un instrument de pression dans la rivalité technologique sino-américaine.
Initialement, l’interdiction devait viser tous les produits à double usage des matériaux exploitables aussi bien dans l’électronique civile que dans des équipements militaires avancés.
Le message était clair : sans l’aval de Pékin, Washington perdait l’accès à trois composants essentiels pour ses circuits intégrés, capteurs infrarouges, LED, fibres optiques et panneaux photovoltaïques.
Mais le ministère chinois du Commerce a officialisé dimanche une suspension totale de ces restrictions jusqu’au 27 novembre 2026.
Un geste présenté comme « technique », mais qui intervient à un moment hautement politique.
Dix jours plus tôt, la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud avait permis de désamorcer plusieurs mois de tensions ayant crispé l’économie mondiale.
Le climat avait alors radicalement changé : Washington parlait d’« avancées concrètes », tandis que Pékin promettait une « stabilisation constructive ».
Derrière cette annonce, une évidence : la Chine ne veut pas apparaître comme l’acteur qui freine la reprise économique mondiale.
Et encore moins comme celui qui pousserait les États-Unis à accélérer leur réindustrialisation stratégique.
Métaux critiques : au cœur de la rivalité technologique mondiale
Le dossier des métaux critiques est devenu l’un des principaux points de friction entre Pékin et Washington.
Le gallium et le germanium figurent parmi les métaux les plus stratégiques du XXIᵉ siècle : sans eux, aucune industrie moderne ne tient debout fibres optiques, satellites, vision nocturne, semi-conducteurs avancés… Et la Chine reste, de très loin, le premier producteur mondial.
Pour Washington, réduire cette dépendance est une question de souveraineté.
Pour Pékin, la maintenir constitue un levier géopolitique majeur.
C’est ce qui rend la suspension annoncée dimanche si significative.
L’Union européenne, elle-même, classe le gallium parmi les matières premières critiques. Quant au germanium, il est indispensable à la filière des télécommunications et aux technologies infrarouges.
L’antimoine, moins connu du grand public, reste crucial pour la fabrication de certains matériaux superdurs et composants militaires.
La Chine le sait. Les États-Unis le savent. Et c’est ce qui donne à ce dossier une portée qui dépasse largement la simple logique commerciale.
En réalité, chaque décision chinoise sur ces métaux agit comme un baromètre de la guerre technologique opposant les deux premières puissances mondiales.
Cette suspension, même temporaire, montre que Pékin cherche à gagner du temps, à apaiser les marchés, mais aussi à envoyer un signal politique sans renoncer à son avantage structurel.
Un geste d’apaisement, pas un renoncement
Le même jour, Pékin a également annoncé un assouplissement des contrôles sur les exportations de graphite, un autre matériau stratégique.
Là encore, la suspension court jusqu’au 27 novembre 2026.
Les contrôles stricts imposés en 2024, notamment sur les usages finaux des produits exportés, sont donc temporairement mis entre parenthèses.
Washington n’a pas tardé à réagir. Après la rencontre Xi–Trump, la Maison-Blanche avait déjà indiqué que Pékin s’était engagé à accélérer la délivrance de licences d’exportation pour ces métaux critiques.
De son côté, la Chine avait donné un premier signal d’ouverture en maintenant à 10 % les droits de douane sur plusieurs produits américains, malgré les tensions persistantes de la guerre commerciale.
Mais Pékin est allé plus loin : la Chine a renoncé à imposer des droits de douane supplémentaires sur certains produits agricoles américains, notamment le soja un geste ciblé, destiné à toucher les milieux traditionnellement favorables à Donald Trump.
En clair, Pékin ne cède pas : Pékin calcule.
La Chine n’abandonne pas ses leviers, mais choisit de les manier avec plus de souplesse pour reprendre la main dans la relation stratégique.
Pour les États-Unis, cette suspension représente un répit, non une victoire.
Pour la Chine, c’est un outil diplomatique, pas un cadeau.
Et pour le reste du monde notamment l’Europe, cette décision rappelle une vérité simple :
quand Pékin touche aux métaux critiques, l’économie mondiale retient son souffle.