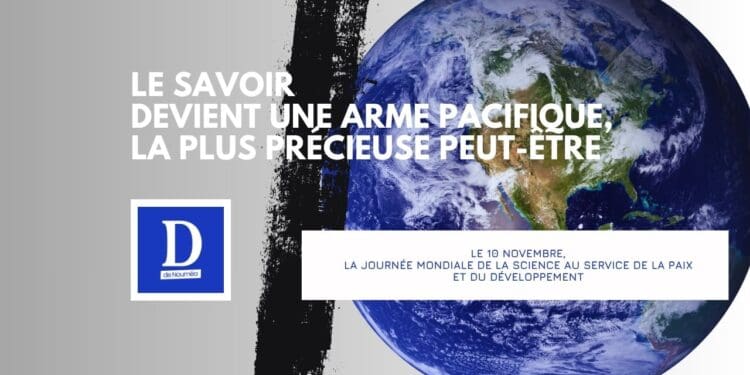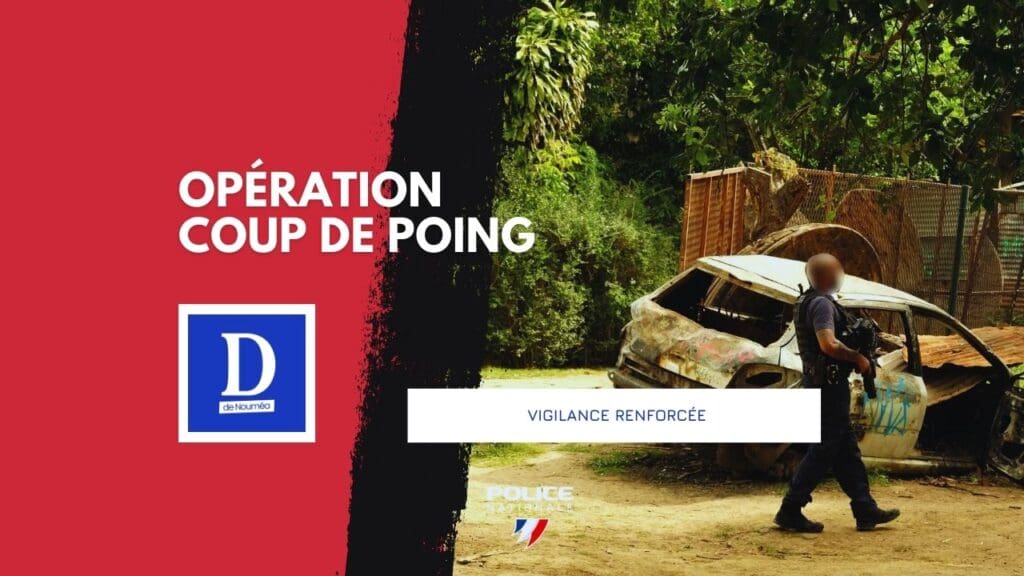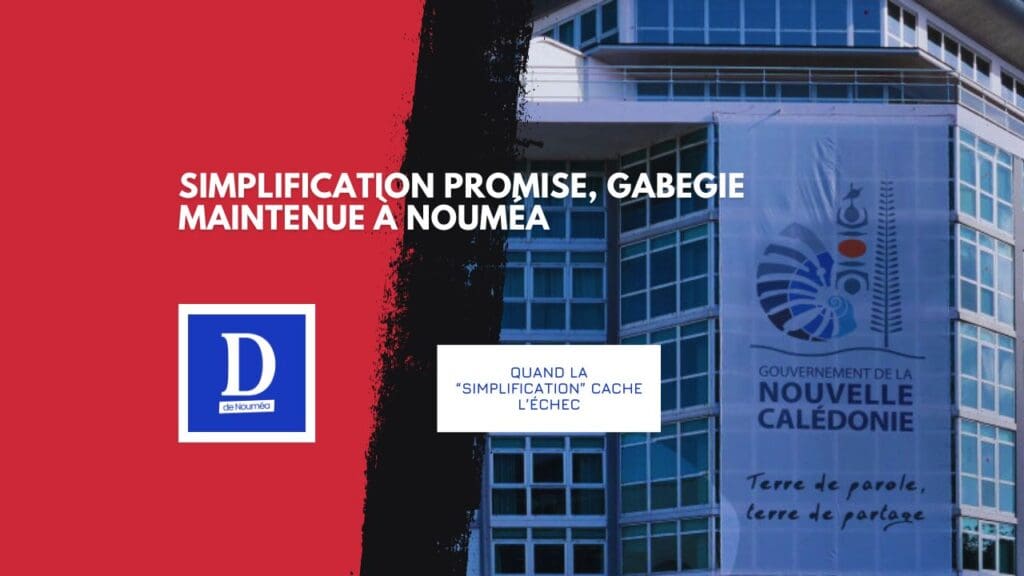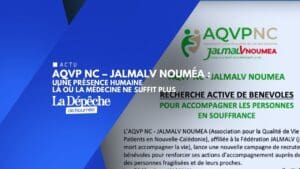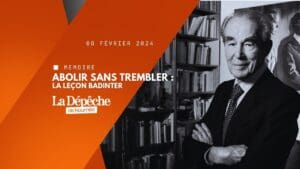Le 10 novembre, la planète célèbre la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Une date symbolique, instaurée par l’UNESCO, pour rappeler que la science n’est pas un luxe académique, mais un pilier de la stabilité mondiale. Dans un monde où la désinformation, les crises climatiques et les tensions géopolitiques menacent l’équilibre collectif, le savoir devient une arme pacifique, la plus précieuse peut-être.
La science, rempart contre le chaos
L’UNESCO le martèle depuis sa création : la science est un bien public mondial. Elle permet non seulement de comprendre notre environnement, mais aussi de désamorcer les conflits liés à la méfiance et à l’ignorance. La pandémie de COVID-19, les catastrophes climatiques et les crises énergétiques ont rappelé à quel point l’absence de connaissance peut coûter des vies.
En 2025, la thématique choisie par l’UNESCO « Science pour la résilience et la confiance » tombe à point nommé. Les États sont invités à renforcer les politiques de recherche ouverte, à soutenir les jeunes chercheurs, et à promouvoir la coopération internationale dans des domaines aussi stratégiques que la santé, l’eau, l’alimentation ou les énergies propres.
Car sans science, la paix reste un vœu pieux : la méfiance, les inégalités et les fausses croyances deviennent les nouveaux terrains de guerre.
Un monde fracturé, une science à recoudre
Les guerres, les crises économiques et les replis identitaires ont fragmenté la planète en bulles de savoirs inégales. Dans de nombreux pays, les chercheurs travaillent sans moyens, les données ne circulent plus, et la science devient un enjeu de puissance.
Face à cette dérive, les Nations unies encouragent une vision plus éthique et inclusive : partager la connaissance pour apaiser les tensions. Des programmes tels que le Science Diplomacy Initiative ou le South-South Cooperation Network permettent à des chercheurs d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique latine de travailler ensemble, au-delà des rivalités géopolitiques.
Ce modèle coopératif incarne un changement profond : la science n’est plus l’apanage des grandes puissances, mais un outil d’équité et de développement humain.
Nouvelle-Calédonie : un laboratoire du Pacifique
En Nouvelle-Calédonie, cette journée prend un sens particulier. Le territoire, petit par la taille mais riche par sa biodiversité et ses compétences, se positionne comme un véritable laboratoire de la science appliquée à la paix sociale et au développement durable.
L’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) multiplie les programmes de recherche sur le changement climatique, la biodiversité marine et la résilience insulaire. Des doctorants étudient l’adaptation des mangroves au réchauffement, les ressources halieutiques, ou encore les usages durables du nickel.
Ces travaux ne sont pas abstraits : ils nourrissent directement les politiques publiques locales, les formations professionnelles et les coopérations régionales avec Fidji, le Vanuatu ou la Polynésie française.
Autour du lagon calédonien, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’écrit ainsi une science de proximité : préserver pour transmettre, comprendre pour unir. Dans un territoire encore marqué par les fractures sociales et les tensions institutionnelles, la recherche devient un outil de dialogue, de stabilité et d’avenir partagé.
Science, vérité et avenir commun
La Journée mondiale de la science n’est pas qu’un rituel de calendrier. Elle nous rappelle qu’une société sans savoir est une société vulnérable.
Investir dans la science, c’est refuser l’obscurantisme et affirmer que la vérité n’est pas relative : elle se prouve, se partage et se discute.
En 2025 comme demain, c’est peut-être cela, la véritable diplomatie de la paix.