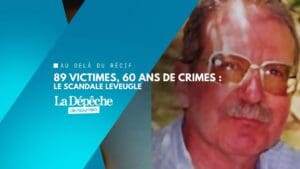Chaque 12 novembre, le monde se mobilise pour la Journée mondiale de la pneumonie, une initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF visant à attirer l’attention sur une réalité méconnue : la pneumonie tue plus d’enfants que toute autre maladie infectieuse.
Malgré les progrès de la vaccination et des traitements antibiotiques, cette infection pulmonaire continue de faire plus de 700 000 morts par an chez les enfants de moins de cinq ans, dont la plupart auraient pu être sauvés par un simple accès aux soins de base.
Une tragédie silencieuse, qui révèle autant les failles des systèmes de santé que les inégalités mondiales.
Une urgence sanitaire sous-estimée
La pneumonie, souvent confondue avec une « simple grippe », est une infection aiguë des poumons causée par des bactéries, des virus ou des champignons.
Elle se propage rapidement dans les zones où l’air est pollué, la vaccination incomplète et les soins limités.
L’OMS estime qu’un enfant meurt de la pneumonie toutes les 45 secondes, principalement en Afrique et en Asie du Sud.
Les causes sont multiples : malnutrition, manque d’accès à l’eau potable, absence de soins préventifs et retard dans la consultation médicale.
Cette année, la campagne mondiale s’articule autour du thème : « Protéger chaque respiration ».
Elle invite les États à investir dans la vaccination contre le pneumocoque, à renforcer la lutte contre la pollution de l’air et à améliorer la détection précoce.
Car la pneumonie, contrairement à d’autres maladies infectieuses, se soigne efficacement si elle est prise à temps ; ce qui manque, ce n’est pas la solution médicale, mais l’équité d’accès aux soins.
La lutte mondiale pour une respiration équitable
Les ONG et les institutions internationales appellent à replacer la pneumonie au cœur des priorités de santé publique.
Selon Save the Children, si les investissements mondiaux dans la prévention étaient doublés, près de 3 millions de vies d’enfants pourraient être sauvées d’ici 2030.
La lutte contre la pneumonie dépasse d’ailleurs la seule question médicale : elle implique l’éducation des parents, la formation des personnels de santé et la réduction de la pollution domestique, notamment dans les pays où les familles cuisinent encore au feu de bois.
Dans les pays développés, la vigilance reste de mise : vieillissement de la population, résistances aux antibiotiques et recrudescence des virus respiratoires créent de nouveaux risques.
La pneumonie n’est pas une maladie du passé ; c’est un thermomètre social et écologique : elle frappe là où la pauvreté et la pollution respirent ensemble.
Nouvelle-Calédonie : un enjeu de santé publique et de prévention
En Nouvelle-Calédonie, la pneumonie demeure une cause fréquente d’hospitalisation, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées.
Les services de pédiatrie et de pneumologie du CHN de Nouméa rappellent régulièrement l’importance de la vaccination contre le pneumocoque, la grippe et la coqueluche, encore trop peu pratiquée chez les publics vulnérables.
Les épisodes de pollution atmosphérique liés aux feux de brousse ou aux poussières minières aggravent le risque de complications respiratoires, notamment dans les communes de l’intérieur.
Les autorités sanitaires locales, via la DASS-NC, multiplient les campagnes de prévention : dépistages, rappels de vaccination, actions dans les écoles et les centres de soins.
La Nouvelle-Calédonie, territoire insulaire mais exposé, illustre bien le paradoxe de cette maladie : une infection facile à traiter, mais toujours dangereuse si elle est négligée.
La Journée mondiale de la pneumonie y prend un sens particulier : protéger chaque souffle, c’est aussi préserver un capital collectif, la santé publique.
La Journée mondiale de la pneumonie n’a rien d’anecdotique : elle rappelle que des vies se jouent chaque jour sur un simple souffle.
Dans un monde encore inégal face à la santé, elle appelle à un engagement politique et citoyen : investir dans la prévention, c’est investir dans la vie.
Parce qu’un enfant qui respire, c’est une société qui respire mieux.