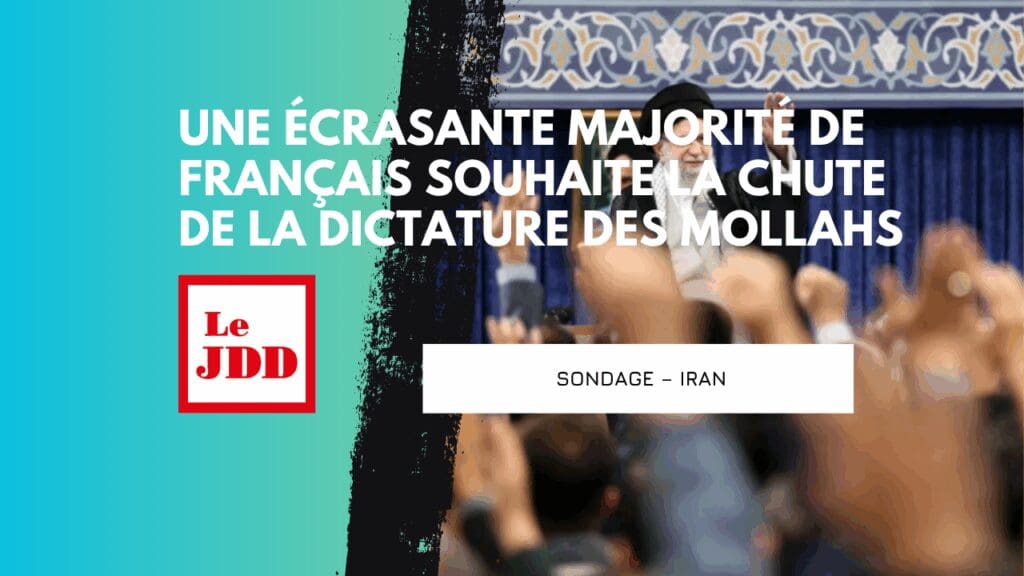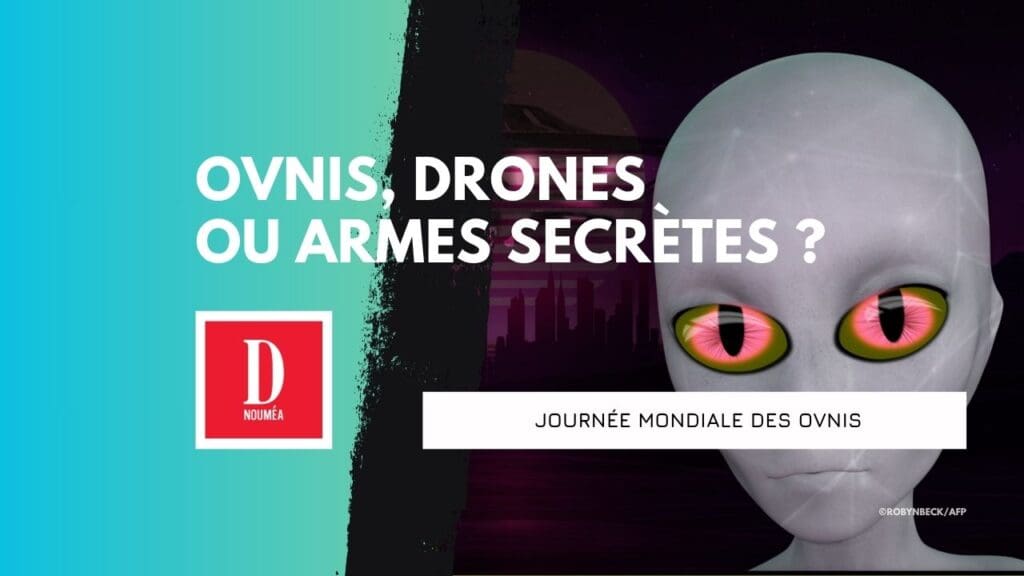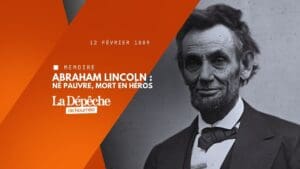Les enseignants crient à la surcharge, mais les chiffres contredisent souvent le discours.
Et cette fois, c’est le ministère lui-même qui met les pendules à l’heure.
Le mythe des “grandes vacances” écorné par les chiffres du ministère
Finie la légende urbaine des profs éternellement en vacances. Selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), les enseignants à temps plein travaillent en moyenne 41 heures et 24 minutes par semaine, soit plus que les 35 heures légales.
Et ce, hors vacances scolaires une réalité souvent occultée dans les débats publics, où les enseignants sont tour à tour accusés d’oisiveté ou d’épuisement.
Dans le détail, 53 % de ce temps est consacré à l’enseignement devant les élèves, 33 % à la préparation et à la correction des copies, et le reste à des réunions ou suivis pédagogiques.
Autrement dit, un enseignant sur deux passe la moitié de sa semaine à préparer et évaluer, sans compter les formations, les conseils de classe ou les rencontres avec les parents.
Mais le chiffre qui surprend le plus : pendant les vacances, les professeurs travaillent en moyenne 33 jours, soit près d’un mois entier dédié à la préparation de la rentrée, aux corrections et aux ajustements de cours.
Les professeurs des écoles et du secondaire dans le même bateau
La DEPP note que les durées de travail hebdomadaire varient peu selon le niveau d’enseignement : 41,8 heures dans le primaire, 41,1 dans le secondaire.
Seule différence : les enseignants du primaire passent plus de temps devant leurs élèves, tandis que ceux du secondaire consacrent davantage d’heures à la préparation et à la correction.
Les professeurs d’EPS, souvent caricaturés, affichent le temps de présence le plus bas (37 heures), mais leur discipline requiert moins de corrections écrites et plus de présence physique.
Les agrégés et certifiés, eux, figurent parmi les plus investis : plus de 41 heures hebdomadaires, soit un rythme comparable à celui des cadres supérieurs du privé.
Et contrairement à une idée reçue, le secteur public et le privé sous contrat affichent des volumes horaires quasi identiques.
Cette réalité tord le cou au discours syndical victimaire : les enseignants ne sont pas “pressurés” par le système ; ils travaillent davantage que la moyenne nationale tout en conservant une autonomie rare dans leur organisation.
Des professeurs prêts à travailler plus pour gagner plus
L’étude du ministère révèle aussi une donnée passée inaperçue : près d’un tiers des enseignants du secondaire se disent prêts à travailler davantage en échange d’une meilleure rémunération.
Dans le primaire, ils sont 13 % à le souhaiter. Et sans surprise, les hommes et les parents figurent parmi les plus nombreux à demander une hausse de charge contre un gain de salaire.
Un constat qui va à rebours du discours dominant : les enseignants ne refusent pas l’effort, ils réclament une reconnaissance concrète.
Cette envie de méritocratie salariale, encore timide, montre qu’une partie du corps enseignant souhaite rompre avec le nivellement par le bas imposé depuis des années.
Enfin, la DEPP souligne une différence générationnelle : les plus jeunes enseignants travaillent plus pendant les vacances jusqu’à 38 jours par an, quand leurs aînés, plus expérimentés, stabilisent leur charge autour de 28 à 33 jours.
Une évolution logique, signe que l’investissement initial paie sur le long terme.
Au total, 1 635 heures de travail par an, soit 28 heures de plus que la durée légale.
Des chiffres précis, documentés, qui rappellent que le métier d’enseignant reste exigeant, mais pas martyrisant.
Loin des slogans de victimisation, cette étude redonne une image plus juste du corps professoral : engagé, structuré, mais parfois mal compris.
Si le débat sur les salaires doit continuer, il ne peut ignorer cette évidence : l’école française ne manque pas d’effort ; elle manque de clarté et de reconnaissance.
Et c’est bien le rôle du ministère que de remettre un peu d’ordre dans une institution souvent minée par l’idéologie.