Tolérance : la valeur oubliée qui fonde la paix durable
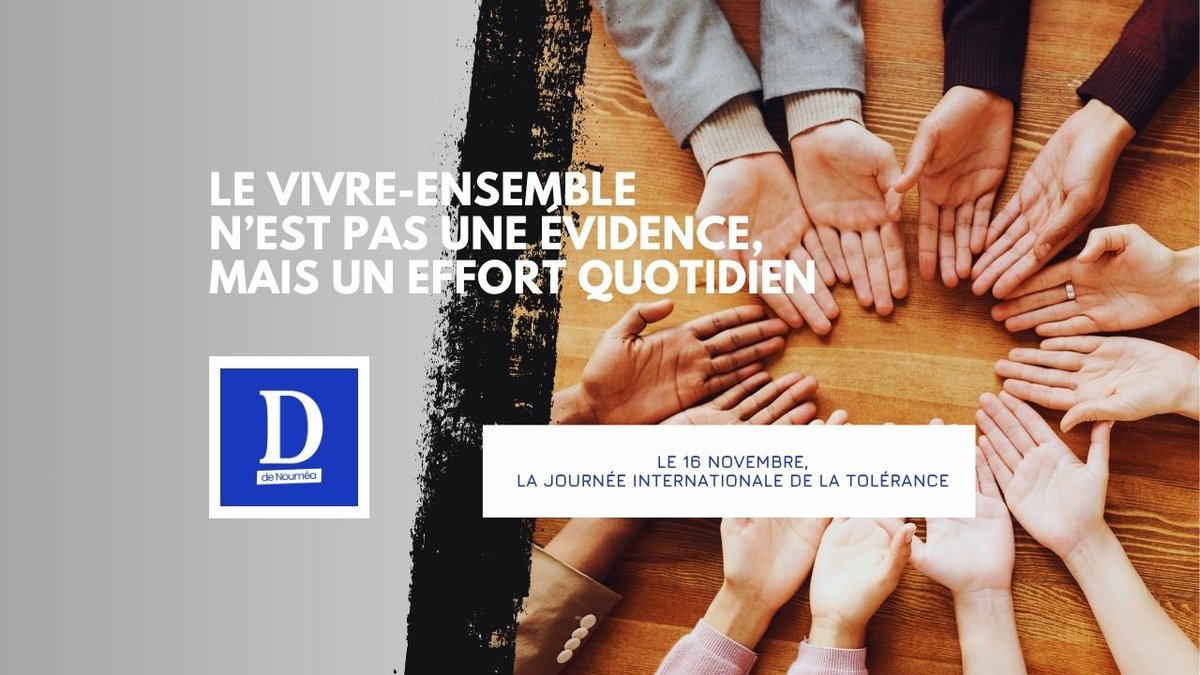
Dans un monde saturé de polémiques et de fractures identitaires, la Journée internationale de la tolérance, célébrée chaque 16 novembre, sonne comme un appel à la raison. Proclamée par l’UNESCO en 1995, elle vise à rappeler que le vivre-ensemble n’est pas une évidence, mais un effort quotidien. À l’heure où la planète est traversée par des guerres, des discours de haine et des replis communautaires, la tolérance n’est plus un idéal abstrait : c’est une condition de survie politique et sociale.
La tolérance, pilier menacé des sociétés libres
L’UNESCO définit la tolérance comme « le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse de la diversité de nos cultures ». Mais cette définition, aujourd’hui, semble mise à l’épreuve partout. De la montée des extrémismes en Europe à la polarisation numérique sur les réseaux sociaux, la tolérance recule à mesure que la peur avance. Le numérique, censé rapprocher les peuples, a souvent renforcé les bulles d’opinion, enfermant chacun dans ses certitudes. Les États démocratiques se heurtent ainsi à un paradoxe : comment garantir la liberté d’expression tout en empêchant la haine de se propager ?
La Journée du 16 novembre rappelle que la tolérance n’est pas la complaisance, mais la capacité à débattre sans détruire. C’est accepter la contradiction, sans renoncer à la vérité. C’est, pour reprendre les mots d’Amadou-Mahtar M’Bow, ancien directeur de l’UNESCO, « l’art de vivre ensemble dans un monde fait de différences ».
Une urgence mondiale : reconstruire le lien social
Les crises géopolitiques, climatiques ou migratoires exacerbent les tensions entre peuples et communautés. Dans ce contexte, l’éducation à la tolérance devient un enjeu central de sécurité internationale. L’ONU insiste sur le rôle de l’école, de la culture et des médias dans la prévention des discours discriminatoires. Les initiatives de diplomatie culturelle, les échanges universitaires ou les programmes de coopération entre jeunes de différentes régions du monde contribuent à bâtir des ponts au lieu de murs. Face aux violences identitaires, cette journée agit comme une boussole morale : sans respect de la différence, aucune paix durable n’est possible.
Nouvelle-Calédonie : la tolérance comme ciment d’un avenir commun
En Nouvelle-Calédonie, la Journée internationale de la tolérance résonne avec une intensité particulière. Territoire multiculturel, traversé par une histoire complexe faite de colonisation, de revendications identitaires et d’accords politiques successifs, le pays vit une cohabitation fragile mais précieuse entre communautés kanak, océaniennes, européennes et asiatiques. Ici, la tolérance n’est pas un mot d’ordre : c’est une condition de paix civile. Les écoles, les associations et les institutions locales multiplient les initiatives pour cultiver la compréhension mutuelle : projets interculturels, commémorations partagées, ateliers linguistiques et actions de médiation dans les quartiers sensibles.
Mais les tensions persistent, notamment sur les questions institutionnelles et foncières. Dans ce contexte, la tolérance devient plus qu’une vertu morale : un outil politique de stabilité. Chaque geste de dialogue entre coutume et République, chaque pont entre la brousse et Nouméa, entre jeunes et anciens, prolonge l’esprit de cette journée mondiale. Car sur le Caillou, l’unité ne se décrète pas : elle se construit, pas à pas, dans la reconnaissance réciproque.
Tolérer, c’est résister à la peur
La Journée internationale de la tolérance n’est ni une fête ni une utopie. C’est une alerte douce mais ferme, qui rappelle que la paix n’est jamais acquise. Être tolérant, ce n’est pas renoncer à ses convictions, mais accepter que l’autre existe autrement. Et dans un monde où les divisions prospèrent plus vite que la raison, cette simple posture devient un acte de courage.

