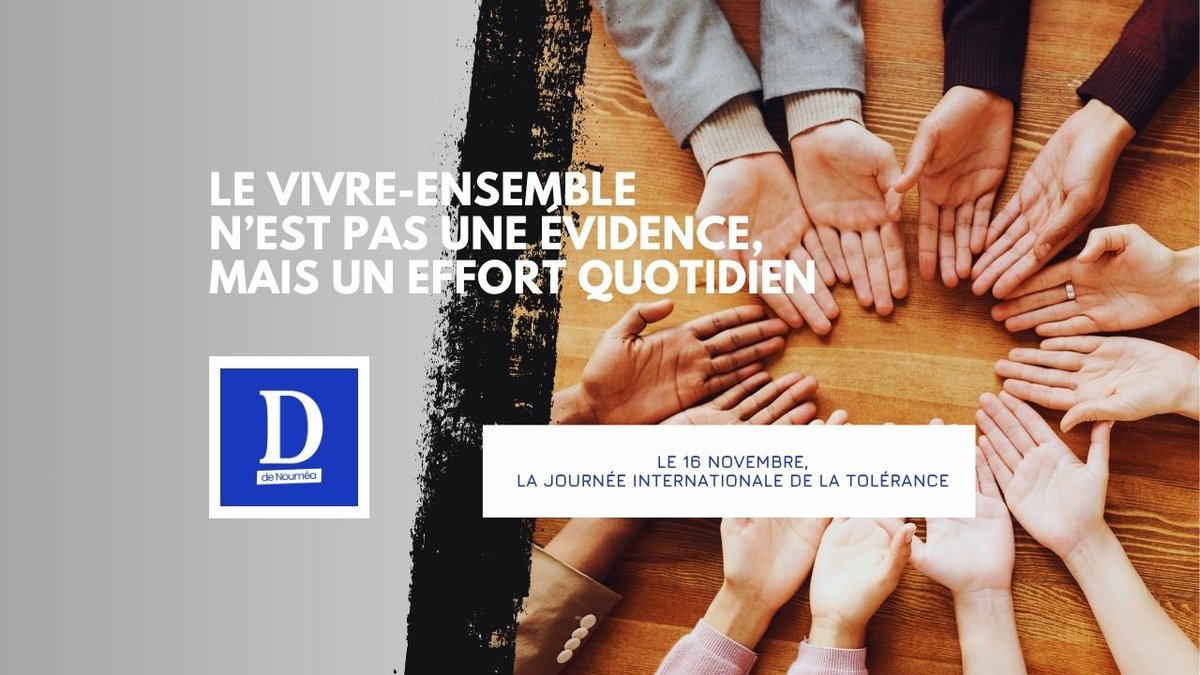Trois Calédoniennes qui ridiculisent les clichés sur le Pacifique

Les succès calédoniens ne tombent jamais du ciel : ils sont le fruit d’un travail acharné et d’une exigence assumée.
Et cette fois, ce sont trois jeunes femmes qui rappellent au monde que la Nouvelle-Calédonie sait produire de l’excellence.
La fierté d’un territoire qui croit encore au mérite et à l’effort
Elles s’appellent Léa Douchet, Noreen Wejeme et Naïna Mouras. Trois doctorantes, trois parcours d’exigence, trois preuves flamboyantes que le travail, la discipline et la passion mènent plus loin que n’importe quel discours victimaire. Leur distinction par le Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO 2025 Pour les Femmes et la Science n’est pas un hasard : c’est la récompense d’années d’engagement dans la recherche scientifique.
Ce prix, soutenu par l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’UNESCO, consacre chaque année des chercheuses qui font avancer les connaissances, loin du bruit mais proches de l’essentiel : comprendre, protéger, innover.
Parmi près de 700 candidates, seules 34 lauréates ont été retenues. Et parmi elles, trois jeunes femmes venues d’un territoire trop souvent caricaturé mais qui, une fois encore, démontre sa capacité à faire émerger des talents solides.
La présidente de l’assemblée de la province Sud, Sonia Backès, les a accueillies avec une fierté non dissimulée, saluant
l’excellence et l’audace d’une jeunesse calédonienne qui prouve que la recherche locale peut rayonner au plus haut niveau.
Une déclaration qui tranche avec la complaisance ambiante envers la médiocrité : ici, on célèbre le mérite, pas les excuses.
Le parcours de ces trois doctorantes donne un visage concret à une vérité simple : la Nouvelle-Calédonie possède un vivier de compétences scientifiques capable de rivaliser avec les grandes institutions métropolitaines. Preuve qu’un territoire qui croit encore à la transmission, à la rigueur et à l’éducation peut produire des trajectoires exemplaires.
Ces réussites ne relèvent ni de la chance ni d’un traitement préférentiel. Elles sont le résultat d’une ambition assumée, d’un encadrement universitaire solide notamment via l’École doctorale du Pacifique de l’UNC et d’un environnement scientifique qui, malgré les difficultés, continue de pousser ses jeunes vers le haut.
Cette distinction nationale rappelle une évidence : le Pacifique n’est pas condamné à n’être qu’un spectateur du progrès mondial. Il peut en être un acteur.
Trois parcours d’excellence qui renforcent le rayonnement du Pacifique
Léa Douchet incarne la nouvelle génération des chercheuses capables de faire dialoguer santé et environnement. Grâce à l’intelligence artificielle, elle modélise les dynamiques épidémiologiques afin de mieux anticiper les risques sanitaires dans le Pacifique, un sujet crucial à l’heure où les crises sanitaires mondiales ont révélé l’importance de la recherche prédictive.
Son travail démontre comment la recherche calédonienne peut contribuer directement à la protection des populations, bien au-delà du territoire.
Naïna Mouras, elle, s’est engagée sur le front de la résilience environnementale. Son étude des mangroves, écosystèmes essentiels mais fragiles, apporte des solutions concrètes à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les effets du changement climatique.
Son approche met en lumière une réalité trop souvent ignorée : la science de terrain, méthodique et exigeante, est indispensable pour bâtir des politiques publiques efficaces.
Enfin, Noreen Wejeme étudie la consommation durable des poissons coralliens du Pacifique, un enjeu scientifique et stratégique pour la région. Entre sécurité alimentaire, souveraineté et préservation des ressources, son travail s’inscrit au cœur des priorités du territoire.
Dans une époque où certains prônent la décroissance et la culpabilisation permanente, son approche concilie responsabilité écologique et réalités économiques, rappelant que le développement durable n’a jamais été synonyme d’abandon.
Ces trois trajectoires illustrent parfaitement ce que la jeunesse calédonienne peut produire lorsque l’on valorise l’effort, la constance et l’ambition. Elles confirment que la recherche scientifique menée en Nouvelle-Calédonie n’est pas un simple exercice académique, mais un véritable outil de transformation durable pour le Pacifique.
Une jeunesse qui choisit l’avenir plutôt que l’excuse
Recevoir un prix L’Oréal-UNESCO, c’est entrer dans un cercle où seules les chercheuses les plus prometteuses sont reconnues. Mais c’est aussi un symbole : celui d’une jeunesse qui refuse la résignation, qui préfère bâtir plutôt que réclamer, et qui entend prouver que la réussite n’est pas une question d’origine mais d’engagement.
Lors de leur rencontre avec Sonia Backès, les trois doctorantes ont pu évoquer leurs travaux, les soutiens institutionnels dont elles bénéficient et leurs projets pour les années à venir.
Loin des discours victimaires qui traversent parfois le débat public, leur parcours rappelle qu’il existe une voie plus exigeante, mais infiniment plus noble : celle de la responsabilité personnelle.
Leur succès renforce l’image d’une Nouvelle-Calédonie dynamique, ambitieuse et tournée vers le monde. Un territoire où les jeunes lorsqu’on leur donne les outils adéquats et qu’ils se les approprient avec sérieux peuvent atteindre l’excellence nationale et internationale.
Ces parcours contribuent à une fierté légitime : celle d’un peuple capable de produire des chercheuses reconnues au niveau mondial.
Une fierté d’autant plus forte qu’elle naît non pas de revendications, mais de résultats.
(Crédit photo : province Sud)