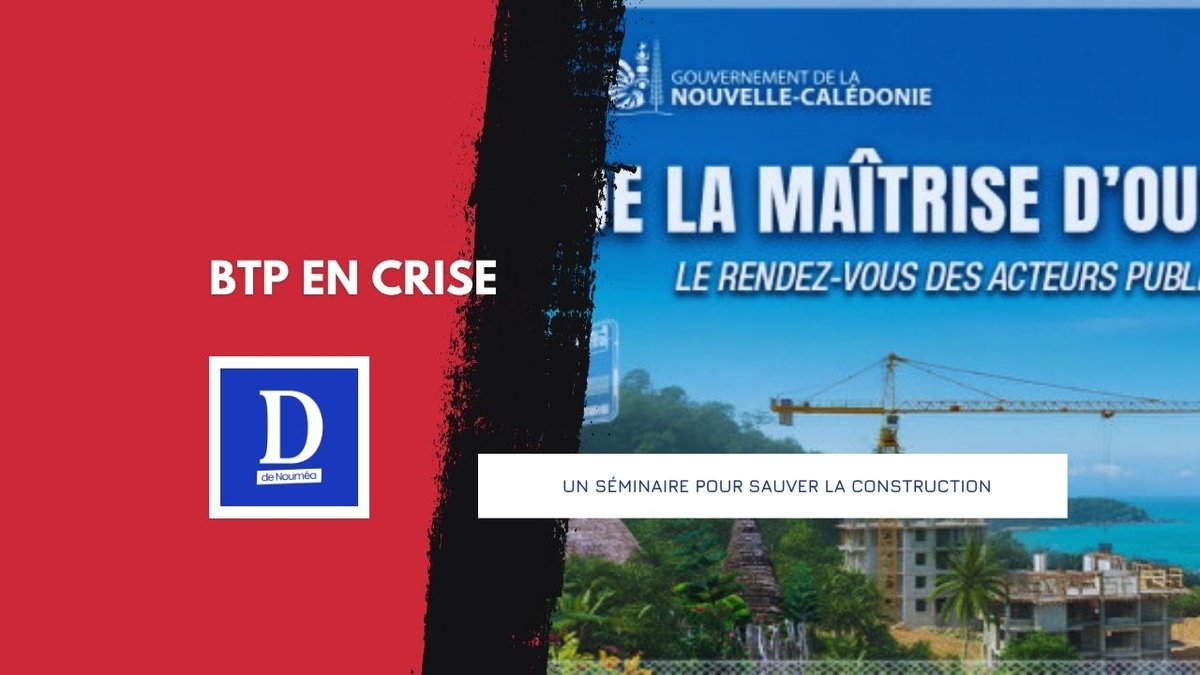UNESCO : l’empire culturel né pour sauver l’Occident
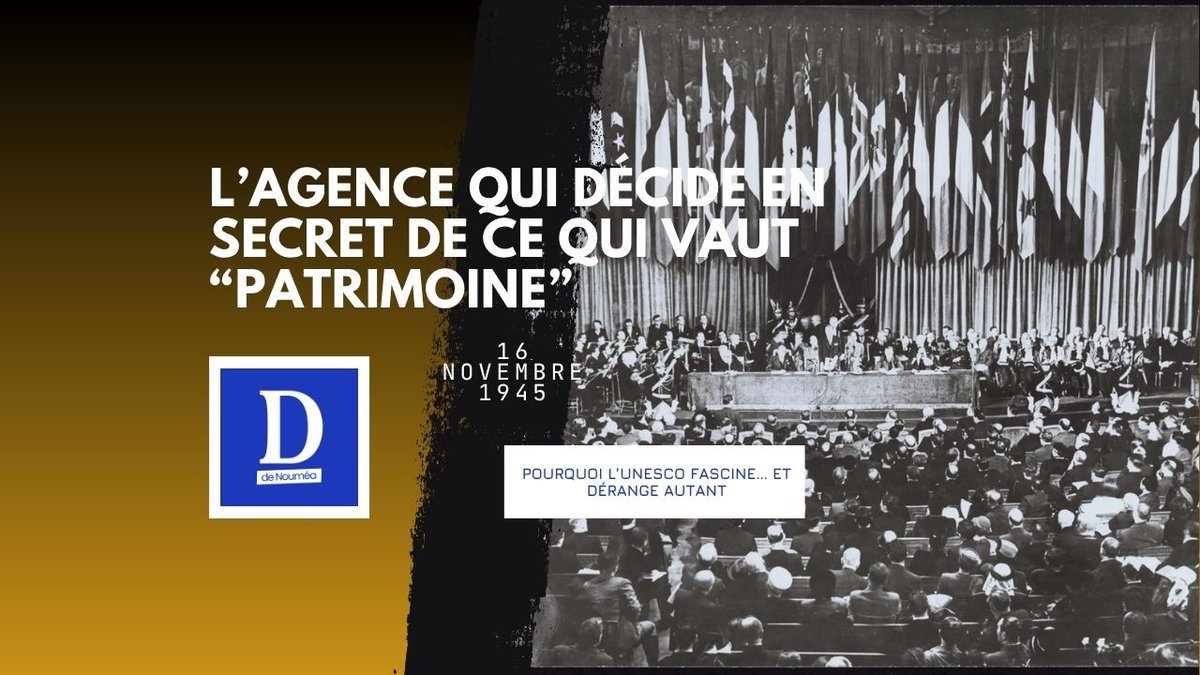
Les institutions internationales aiment parler de paix, mais rares sont celles qui l’ont réellement façonnée.
Et parmi ces géants souvent critiqués, une organisation a longtemps porté l’ambition culturelle et scientifique de l’Occident : l’UNESCO.
Une institution née pour réarmer les esprits après le chaos
À l’heure où l’Europe pansait encore les plaies de deux guerres mondiales, une certitude s’imposait : la paix durable ne pouvait dépendre uniquement de traités diplomatiques. Il fallait restaurer ce qui avait été brisé bien avant les frontières : l’esprit des hommes. C’est dans ce contexte que voit le jour, en novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, appelée UNESCO.
Son Acte constitutif énonce une mission limpide : puisque les conflits émergent d’abord dans les consciences, c’est là qu’il faut bâtir les défenses les plus solides. En clair, rétablir la connaissance, la culture et l’universalité des valeurs humaines comme socles de coexistence. Une vision typiquement occidentale, héritée des Lumières, qui inscrit l’organisation dans un héritage intellectuel exigeant et résolument humaniste.
Installée à Paris dès 1958, l’agence choisit pour siège un édifice spectaculaire conçu par Zehrfuss, Breuer et Nervi, symbole d’un temps où la capitale française incarnait, sans contestation, le cœur de la culture mondiale. Ce choix, architectural autant que géographique, dit beaucoup : la France, déjà pilier de l’ONU, s’impose alors comme la maison naturelle de ceux qui veulent penser la paix autrement que par des lignes de front.
Sauver les trésors de l’humanité : la grande œuvre de l’UNESCO
Si une période a véritablement forgé la légende de l’institution, c’est bien celle où Christiane Desroches-Noblecourt lança, dans les années 1960, la grande opération de sauvetage des temples de Nubie, menacés par la montée des eaux du barrage d’Assouan. L’image d’Abou Simbel transporté bloc par bloc fait encore aujourd’hui figure d’exploit mondial, incarnation d’une coopération internationale que même les rivalités de la Guerre froide n’ont pu briser.
De cette épopée naît en 1972 la Convention du patrimoine mondial, aujourd’hui forte de plus d’un millier de biens inscrits. Puis, en 2003, l’UNESCO élargit son champ en reconnaissant ce qui ne se voit pas mais se transmet : le patrimoine culturel immatériel. Dans ce domaine, la France joue un rôle majeur, qu’il s’agisse des paysages viticoles, du repas gastronomique ou de savoir-faire ancestraux.
L’agence ne se limite pas à la culture. Elle contribue à la création d’infrastructures scientifiques majeures comme le CERN à Genève pilier européen de la recherche fondamentale puis SESAME en Jordanie, laboratoire régional destiné à faire coopérer des pays souvent opposés. Là encore, l’idée est simple : la science comme pont, non comme frontière.
Cette dynamique ambitieuse fait de l’UNESCO un acteur respecté, parfois contesté, mais rarement ignoré.
Crises, fractures politiques et nouveaux défis : l’UNESCO face au monde du XXIᵉ siècle
Comme toutes les institutions onusiennes, l’UNESCO n’a pas échappé aux secousses géopolitiques. En 2017, l’administration Trump annonce le retrait des États-Unis, principal contributeur financier de l’agence, après l’adoption d’un texte qualifiant Hébron de ville de « culture islamique ». Une rupture brutale qui affaiblit l’organisation et révèle ses fragilités : résolutions politisées, tensions Est-Ouest, affrontements idéologiques permanents.
Le retour américain sous Joe Biden en 2023 marque un regain d’équilibre et montre combien l’Europe et les États-Unis restent les piliers naturels de l’architecture culturelle mondiale. Sans eux, l’institution vacille ; avec eux, elle avance.
Surtout, l’UNESCO assume désormais une autre mission : penser l’avenir. Après la pandémie, elle s’est saisie du débat sur les futurs de l’éducation, dans un monde bouleversé par le numérique et les inégalités scolaires. Elle a également élaboré un cadre normatif inédit pour encadrer l’intelligence artificielle, sujet où la France joue un rôle moteur.
L’organisation s’engage aussi contre les nouvelles formes de racisme et les discours de haine. Là encore, sa ligne se veut universaliste : parfois critiquée par ceux qui y voient une tentation moralisatrice, parfois défendue par ceux qui y lisent une extension logique de la mission initiale protéger ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité.
Enfin, l’UNESCO rappelle que la défense du patrimoine mondial ne doit pas se limiter aux vieilles pierres. Elle promeut une relation plus durable entre l’homme et son environnement, dans un monde où les sites naturels sont souvent les premiers menacés.
En définitive, l’UNESCO demeure l’une des dernières institutions internationales à croire encore dans la puissance des idées, de la culture et de la transmission. Une vision profondément européenne profondément française même qui résiste tant bien que mal aux turbulences du monde contemporain. Et si beaucoup aiment critiquer les organisations onusiennes, rares sont celles dont l’héritage est aussi concret : des temples sauvés, des libertés protégées, des connaissances partagées.
Dans un XXIᵉ siècle fragmenté, ce legs n’a jamais été aussi précieux.