Louvre : les rois ont construit, la République a récolté
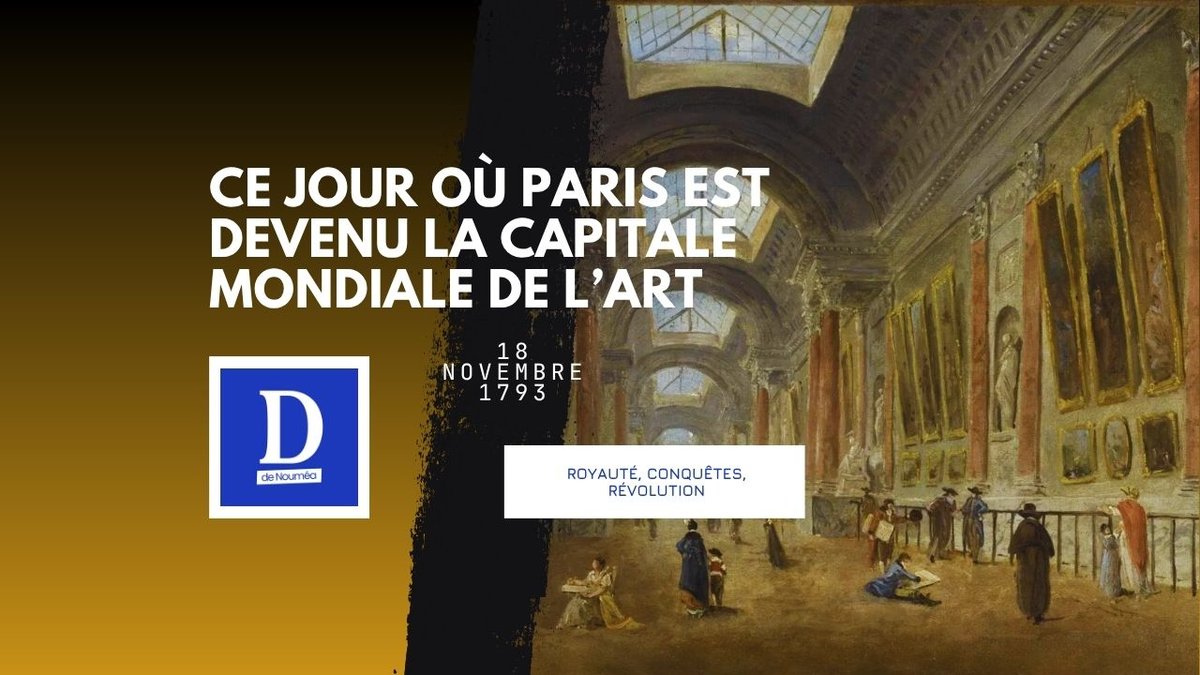
Le Louvre n’est pas seulement un musée : c’est un rappel cinglant que la France se construit par la volonté, la puissance et la transmission.
Le 18 novembre 1793, l’ancien palais monarchique s’ouvre au peuple et entre dans l’Histoire par la grande porte.
La révolution d’un palais : quand la France décide de protéger son génie
La transformation du Louvre n’est pas née d’un élan naïf mais d’une décision politique forte : mettre le patrimoine de la Nation à la disposition du peuple, sans jamais renier l’héritage monarchique qui l’a façonné. Le 10 août 1793, la Convention décide la création du « Museum de la République ». Le symbole est immense : un an après la chute de la royauté, les trésors de la monarchie ne sont pas détruits mais réorientés. C’est un choix civilisationnel, celui de la continuité plutôt que de la table rase.
À l’origine, l’édifice n’était qu’une forteresse commandée par Philippe Auguste au XIIe siècle. Au fil des siècles, rois et architectes le transforment : Charles V en fait un lieu de pouvoir, François Ier y appose l’empreinte de la Renaissance et Louis XIV y installe les premières grandes collections royales. Cette longue chaîne de souverains rappelle une vérité oubliée : la France ne s’est jamais construite dans la rupture permanente, mais dans une succession d’ambitions assumées.
La Révolution, loin d’effacer ce passé, le reprend en main. L’ouverture du musée, finalement effective le 18 novembre 1793, concrétise un projet mûri depuis Louis XVI. Ce jour-là, le palais cesse d’être un lieu réservé aux élites pour devenir un espace national. Un geste audacieux, presque déroutant, dans une période où tant d’autres symboles royaux étaient abattus. Ici, la République choisit de conserver, d’ordonner, de transmettre. Un choix profondément français.
Des souverains visionnaires aux conquêtes républicaines : la fabrique d’un trésor national
Si le Louvre est devenu le plus grand musée du monde, c’est parce qu’il est le fruit d’une ambition continue, monarchique puis républicaine. Charles V inaugure la dynamique au XIVe siècle en réunissant de précieux objets au donjon de Vincennes. François Ier amplifie cette impulsion avec une passion presque incendiaire pour les maîtres italiens et son amitié avec Léonard de Vinci. Louis XIV, avec l’aide de Colbert, systématise l’entreprise : 1500 tableaux de maîtres sont déjà recensés à la fin de son règne.
Au XVIIIe siècle, Diderot rêve d’ouvrir ces collections au public. Sous Louis XVI, via le comte d’Angivillier, le projet d’un musée moderne prend forme. La Révolution le réalisera, mais l’idée, elle, est profondément monarchique. C’est encore un rappel que la France n’avance jamais par désir de rupture mais par désir de grandeur.
Viennent ensuite les acquisitions révolutionnaires, parfois rigoureuses sur le papier, mais souvent illégales sur le terrain. Les armées de la République, puis celles du Premier Empire, rapportent au Louvre des œuvres majeures : la logique est simple, brutale, assumée. Une Nation forte prend, conserve et expose ce qui illustre la civilisation. Les campagnes du général Bonaparte enrichissent considérablement les galeries, au point que Vivant Denon, nommé en 1803, peut rêver de faire du Louvre « le plus beau musée de l’univers ». Ambition folle ? Peut-être. Ambition française ? Sans aucun doute.
Les revers viendront avec la chute de Napoléon : près de 5 000 œuvres sont restituées. Mais le Louvre conserve tout de même 75 pièces majeures, symboles d’une époque où la France projetait sa puissance et son rayonnement sans complexe. Malgré les pertes, la dynamique est lancée : le Louvre est devenu une institution-monde.
Du XIXe siècle à nos jours : renaissance permanente d’un géant culturel
Avec l’entrée de la Vénus de Milo en 1821 et l’incroyable travail de Champollion, qui inaugure en 1827 le musée égyptien, le Louvre s’ouvre à l’archéologie savante. Charles X donne une impulsion nouvelle à cet élan. Puis, au fil du XIXe siècle, acquisitions, donations et dations enrichissent régulièrement les collections, malgré les crises et les manques de moyens.
La France continue d’avancer : sous la Restauration, le Radeau de la Méduse, œuvre contemporaine, est acquis malgré le scandale qu’il suscita. L'État assume de nouveau sa mission culturelle. Et après la Grande Guerre, même ralentie, la politique d’enrichissement se poursuit.
Il faudra attendre la Ve République pour assister à la métamorphose moderne du musée. Giscard d’Estaing crée le musée d’Orsay, libérant le Louvre des collections postérieures à 1848. Mitterrand lance le chantier monumental de la pyramide et la restructuration des espaces intérieurs. La France réaffirme alors son génie architectural, sa capacité à moderniser sans renier l’ancien.
Aujourd’hui encore, le Louvre demeure le legs indiscutable de mille ans de volonté française, alliance unique entre monarchie, République, conquêtes, création et transmission. Ses salles racontent autant l’histoire de l’art que celle d’un pays qui refuse l’effacement et revendique sa place au premier rang.

