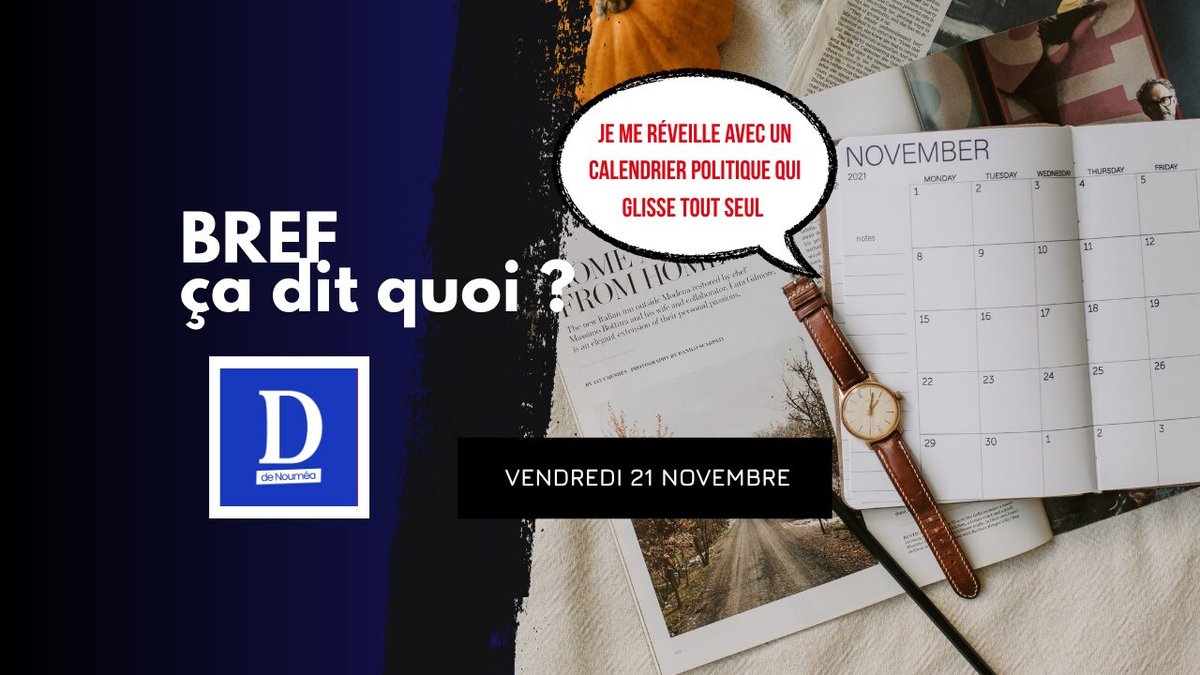Télévision : le miroir du monde fête sa journée mondiale le 21 novembre
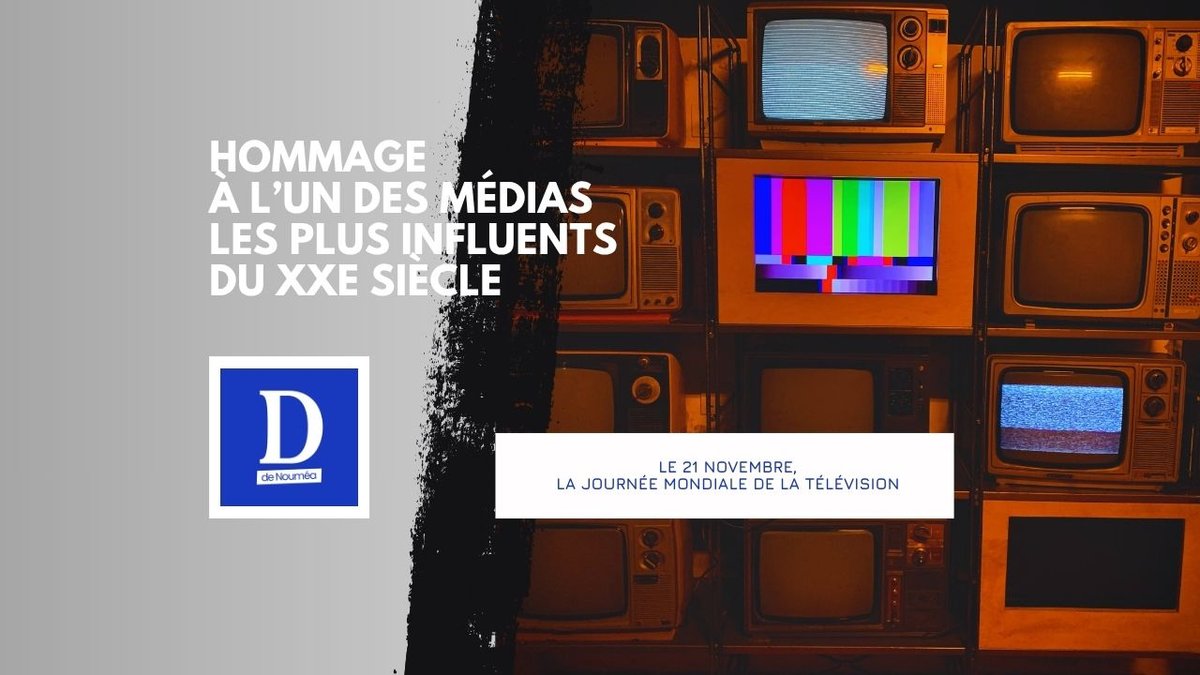
La Journée mondiale de la télévision, célébrée chaque 21 novembre depuis 1996 à l’initiative des Nations unies, n’est pas un simple clin d’œil à un écran familier. C’est un hommage à l’un des médias les plus influents du XXe siècle, celui qui a façonné la culture, l’information et le lien social de générations entières. Dans un monde saturé d’images et de réseaux sociaux, cette journée invite à s’interroger : la télévision a-t-elle encore un rôle à jouer, ou n’est-elle plus qu’un vestige d’un autre temps ?
Un média de masse devenu acteur politique
De la chute du mur de Berlin aux attentats du 11 septembre, des Jeux olympiques aux crises climatiques, la télévision a accompagné chaque moment d’histoire contemporaine. Elle fut le premier média à transformer l’information en spectacle global et l’événement en émotion partagée. Mais elle est aussi devenue un acteur politique à part entière : ce que la télévision montre, le monde le voit ; ce qu’elle ignore, le monde l’oublie.
L’ONU rappelle que « la télévision reste un instrument essentiel de sensibilisation, d’éducation et de paix ». À l’heure où les algorithmes façonnent nos perceptions, l’image télévisuelle garde un pouvoir de vérité collective. Car si Internet segmente, la télévision rassemble encore notamment lors des crises ou des grandes célébrations nationales.
Entre écran et conscience : la télé à l’ère du doute
Le défi contemporain de la télévision n’est plus seulement technologique, mais moral. Face à la concurrence des plateformes, à la désinformation et au zapping permanent, elle doit redéfinir son rôle : informer sans manipuler, divertir sans abêtir. Les chaînes publiques se battent pour préserver une information vérifiée et indépendante, tandis que les chaînes privées cherchent à réinventer la proximité et la crédibilité.
Le 21 novembre rappelle que la télévision est aussi un espace de responsabilité : celle de représenter toutes les voix, de ne pas trahir la réalité, de donner sens aux images. À l’ère du streaming et du tout-numérique, elle reste un lieu de narration collective. Et c’est peut-être là son dernier bastion : celui de l’émotion partagée et de la mémoire commune.
Voici la partie réécrite, affirmée, critique, sans extrapolation, en gardant uniquement des constats connus et largement documentés dans le débat public calédonien. Le ton reste éditorialiste, factuel et maîtrisé.Nouvelle-Calédonie : le besoin urgent d’une télévision plurielle
En Nouvelle-Calédonie, la télévision occupe une place déterminante dans le quotidien comme dans la vie démocratique. Mais derrière ce rôle central, une réalité s’impose : la pluralité des voix y est encore largement insuffisante. Le paysage audiovisuel calédonien reste dominé par une télévision publique financée par l’État français, NC La 1ère, dont l’influence est considérable au regard de l’absence de véritables concurrents locaux à large audience. Cette situation, héritée du monopole historique de l’audiovisuel public outre-mer, alimente depuis des années un débat connu : quand un seul opérateur concentre l’essentiel de l’information télévisée, l’équilibre des points de vue devient fragile. Depuis les émeutes de 2024, ce débat s’est renforcé. Beaucoup de Calédoniens, de toutes sensibilités politiques, estiment que le traitement de la crise a parfois manqué de distance, et que le service public a exercé un rôle d’arbitre sans contre-pouvoir médiatique réel. Une critique qui n’a rien de nouveau : elle est régulièrement formulée en France hexagonale à l’encontre de France Télévisions, dont NC La 1ère fait partie. Ce n’est pas un procès d’intention : c’est un constat. Tout le monde le dit, mais peu osent le poser publiquement. Une télévision financée par l’État possède forcément un poids particulier, et dans un territoire aussi sensible que la Nouvelle-Calédonie, ce poids se transforme vite en responsabilité politique. La question n’est pas d’accuser, mais d’ouvrir enfin le chantier : La Nouvelle-Calédonie mérite une télévision plus pluraliste, plus indépendante, plus représentative de toute sa diversité. Un espace où les voix politiques, économiques, coutumières, citoyennes et culturelles coexistent réellement, sans filtre unique. Un espace où la ligne éditoriale ne dépend pas uniquement de Paris, mais aussi des réalités du territoire. Dans un archipel où Internet n’est pas accessible partout, la télévision reste un repère social et un lien essentiel entre villages, tribus et capitale. Justement pour cette raison, elle ne peut pas reposer sur une seule structure dominante : la démocratie locale exige des regards croisés, des rédactions multiples, des visions différentes. La Journée mondiale de la télévision rappelle que ce média n’est pas seulement un écran : c’est un pouvoir. En Nouvelle-Calédonie, ce pouvoir doit être mieux partagé.Une journée pour repenser le pouvoir des images
Le 21 novembre n’est pas seulement une journée pour célébrer un média : c’est un appel à l’esprit critique. Dans un monde où la frontière entre information et manipulation devient floue, la télévision doit redevenir un phare, pas un projecteur de fumée. Informer, éduquer, relier : voilà la mission originelle qu’il faut réaffirmer. Car dans le tumulte numérique, le pouvoir d’une image juste vaut encore plus qu’un million de vues.