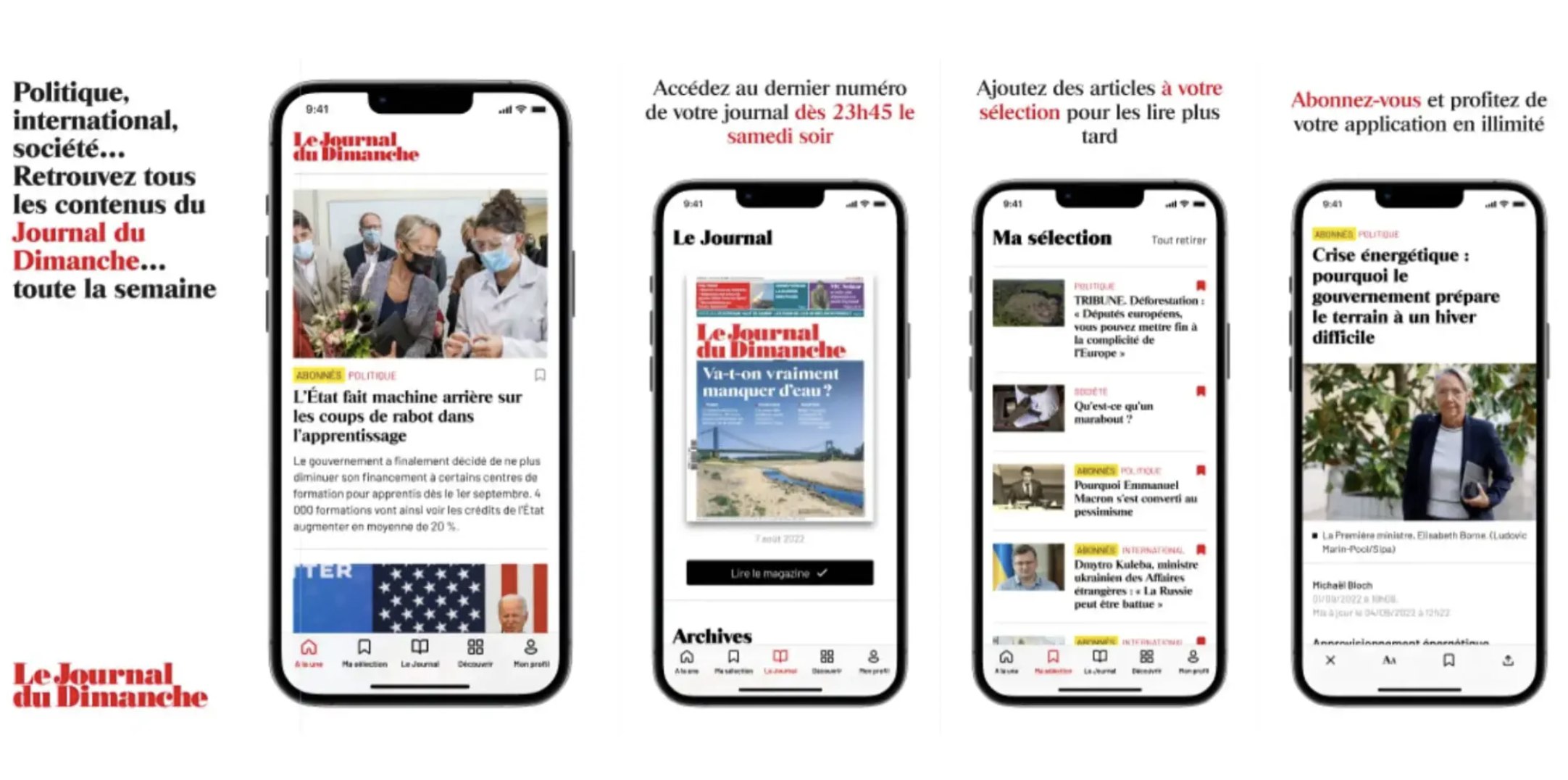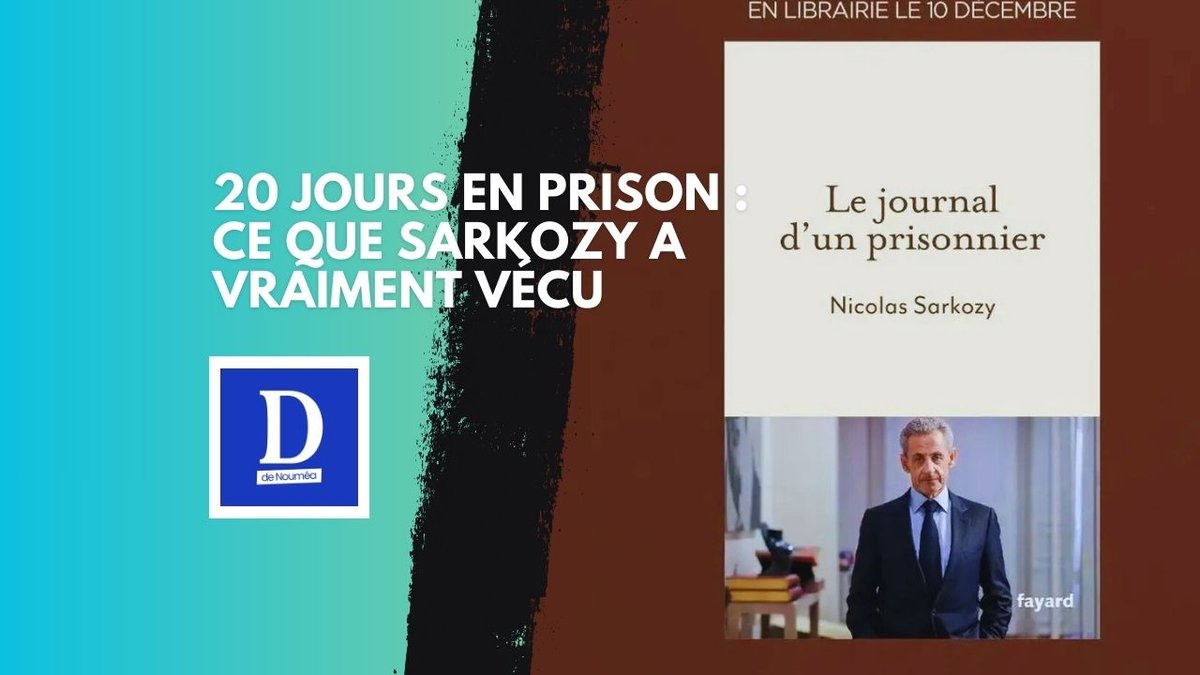Budget 2026 : l’État-providence ou le communisme mental français


Depuis plus d’un mois, une fois refermé le psychodrame de la nomination-démission puis « re-nomination » de Sébastien Lecornu, les négociations budgétaires s’enlisent à l’Assemblée nationale. Un jour, le volet des recettes est rejeté ; le lendemain, ce sont les dépenses. Une seule chose est claire : ce budget, construit à coups d’amendements contradictoires et de postures politiques, est devenu illisible. Il sera inévitablement retouché, voire repris par ordonnances.
On pourrait incriminer les députés, qui s’éparpillent en propositions plus dépensières les unes que les autres, aggravant la dette publique par réflexe démagogique. Mais la véritable responsabilité se situe ailleurs. En 2012, François Hollande désignait un adversaire sans visage, sans nom, sans parti : la finance. Treize ans plus tard, il faut dénoncer l’unique responsable de la gabegie actuelle : un État-providence devenu hors de contrôle, intouchable, hypertrophié, incapable de se reformer, détruisant toute tentative de redressement budgétaire.
Plutôt que d’exiger davantage de dépenses publiques, nous devrions d’abord reconnaître l’ampleur des protections déjà offertes
L’État-providence, dans sa forme actuelle en France et en Europe, est le produit de l’après-Seconde Guerre mondiale. Il a accompagné la reconstruction, soutenu la croissance, réduit les inégalités et consolidé les classes moyennes. Sanctuarisé, pour ne pas dire « déifié », au fil des décennies, il ne s’adapte plus aux réalités économiques, au vieillissement démographique de la population, au ralentissement de la productivité, à la transition écologique coûteuse et à une concurrence mondiale féroce.
Plutôt que d’exiger mécaniquement davantage de dépenses publiques, nous devrions d’abord reconnaître l’ampleur des protections déjà offertes et constater que ce modèle, en l’état, ne répond plus aux défis contemporains.
Fonction publique et sécurité sociale, deux talons d’Achille français
Schématiquement, l’État-providence prélève impôts et cotisations sur ceux qui travaillent pour redistribuer aux plus fragiles ou à ceux qui ne peuvent plus travailler. Le système, généreux, garantit aujourd’hui une solidarité étendue, au point d’inclure des citoyens peu enclins à participer au marché du travail. Cette redistribution repose sur deux piliers majeurs : le statut de la fonction publique et la sécurité sociale.
Le statut de la fonction publique a donné naissance à un corps de fonctionnaires dense et stable, qui revendique régulièrement plus de moyens et exerce une influence notable sur la sphère politique et sociale. Pour donner un ordre de grandeur, la France comptait 1,5 million de fonctionnaires en 1945 pour 40 millions d’habitants, soit un fonctionnaire pour 27 habitants. En 2024, ce ratio est passé à environ un fonctionnaire pour 11 habitants, avec près de 6 millions d’agents.
La sécurité sociale, quant à elle, s’est progressivement éloignée de ses principes assurantiels initiaux. La collecte via l’Urssaf a dépassé 600 milliards d’euros en 2024, une somme considérable qui illustre l’ampleur de la dépense publique.
La France s’endette depuis près d’un demi-siècle pour financer le train de vie des Français
Ces deux piliers représentent aujourd’hui une charge financière bien trop importante pour l’État. Les élus politiques, plus guidés par la recherche de popularité et de résultats électoraux à court terme, ont privilégié la dette comme solution, plutôt qu’une révision structurelle des dépenses publiques. Ils coulent le navire France et tous les passagers à bord.
Affronter la réalité en face
À l’instar d’un ménage vivant au-dessus de ses moyens, la France s’endette depuis près d’un demi-siècle pour financer le train de vie des Français. Le Covid n’a été qu’un épisode ponctuel dans une trajectoire linéaire et structurelle.
Mais qui a réellement profité de cette dette ? Bien sûr, des handicapés, des personnes âgées, des malades. Mais aussi, et c’est là le paradoxe, l’écrasante majorité de la population, y compris ces épargnants vertueux que l’on prétend « spoliés » car ces mêmes épargnants ont largement bénéficié de prestations gratuites ou subventionnées : santé, école, transports, activités sportives, assistance sociale… Si le vrai prix de ces services avait été payé individuellement, leurs économies seraient tombées en fumée.
En réalité, leurs économies sont en grande partie la contrepartie de prestations qu’ils ont reçues et dont le coût, depuis des décennies, a été financé par la dette. Alors, pour freiner cette folie, il ne suffit pas de critiquer les gouvernants. Il faut déconstruire l’État-providence, supprimer le statut de la fonction publique et soumettre les salariés de l’État au Code du travail. Il faut ensuite remplacer la sécurité sociale par des assurances concurrentes. Et surtout, mettre fin à l’absurde système de retraites par répartition pour passer à la capitalisation.
Seules de telles mesures radicales permettraient de réduire la dette et de protéger, enfin, les épargnants. Il faut en finir avec ce mythe national de l’État qui veille sur tout et tout le monde. Mais les Français sont-ils prêts à entendre cette inéluctable vérité ?
Télécharger l'application Le Journal du Dimanche pour iPhone, iPad ou Android