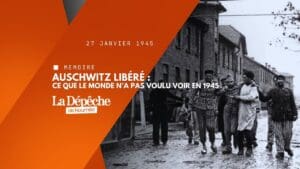Un simple emballage peut cacher bien des vérités. À Nouméa, une consommatrice a levé le voile sur un écart d’étiquetage troublant.
Cette affaire rappelle qu’en Nouvelle-Calédonie, la loi ne tolère aucune imprécision.
Une alerte citoyenne qui fait trembler les rayons
Tout est parti d’un constat anodin dans un hypermarché de Sainte-Marie. Une adhérente de l’association UFC-Que Choisir NC a relevé une différence flagrante entre l’étiquetage en anglais et en français d’un produit en rayon. Dans la version originale figurait l’additif E435, tandis qu’il disparaissait mystérieusement dans la traduction française. Un détail, pourrait-on croire. Mais ce détail touche au cœur même de la confiance des consommateurs.
En Nouvelle-Calédonie, la Direction des Affaires économiques (DAE) veille à ce que les règles d’étiquetage soient respectées. La législation est stricte : toute denrée alimentaire mise en vente doit comporter des informations exactes, transparentes et rédigées en français. L’objectif est clair : éviter toute tromperie et garantir au client une information loyale.
Cette vigilance n’est pas une option : elle constitue un garde-fou face à certaines pratiques commerciales, souvent importées, qui sacrifient la protection du consommateur au profit immédiat. Et dans un territoire insulaire où l’importation domine, ces contrôles sont vitaux pour préserver la santé et le pouvoir d’achat des Calédoniens.
Des règles précises pour protéger les consommateurs
La DAE rappelle que deux principes fondamentaux régissent l’étiquetage : la clarté et la sincérité. Les informations doivent renseigner objectivement le consommateur : composition, origine, poids net, conditions de conservation, date limite de consommation. Autrement dit, l’emballage doit être un outil d’information, et non un piège marketing.
Ces mentions sont obligatoires sur les produits préemballés, qui représentent l’immense majorité des denrées en libre-service. À défaut, l’emballage devient mensonger. De même, les mentions additionnelles telles que « surgelé » ou « décongelé » doivent être visibles et lisibles.
En revanche, certains produits bénéficient d’exceptions : fruits et légumes frais, confiseries de moins de 100 grammes, fromages fermiers ou boissons alcoolisées comme le vin et la bière. Ces allègements, hérités des usages, ne dispensent cependant pas les distributeurs de leur devoir d’honnêteté.
En cas de manquement, les sanctions peuvent être lourdes : amendes, retraits de produits, voire poursuites judiciaires pour tromperie. L’exemple du E435 en est une alerte significative : le consommateur n’est pas dupe, il observe, compare et dénonce.
Une responsabilité partagée : producteurs, distributeurs et contrôleurs
La rigueur de l’étiquetage n’est pas une contrainte bureaucratique mais une garantie de confiance entre producteurs, distributeurs et clients. Le fabricant doit assumer la responsabilité de son produit, du conditionnement jusqu’à la mise en rayon. Le distributeur, lui, doit vérifier la conformité des marchandises proposées. Quant aux autorités, elles disposent de contrôleurs spécialisés, présents deux fois par semaine en permanence, pour répondre aux interrogations et intervenir en cas de fraude.
Ce maillage est indispensable dans un territoire dépendant de l’importation alimentaire. Sans ce filet, les consommateurs calédoniens seraient livrés aux géants industriels et aux circuits mondialisés, où les erreurs — volontaires ou non — prolifèrent.
L’épisode de Sainte-Marie illustre ainsi une vérité simple : le respect des règles françaises protège le consommateur calédonien. Ceux qui rêvent d’assouplir les contrôles ou de céder aux logiques commerciales des importateurs feraient bien de s’en souvenir.
En matière d’alimentation, la moindre négligence peut se transformer en risque sanitaire. Le droit à une information claire et loyale n’est pas un luxe, mais une exigence républicaine. En Calédonie comme en métropole, c’est la France qui garantit ce socle de protection. Et face aux dérives, la réponse doit rester la même : rigueur et transparence.