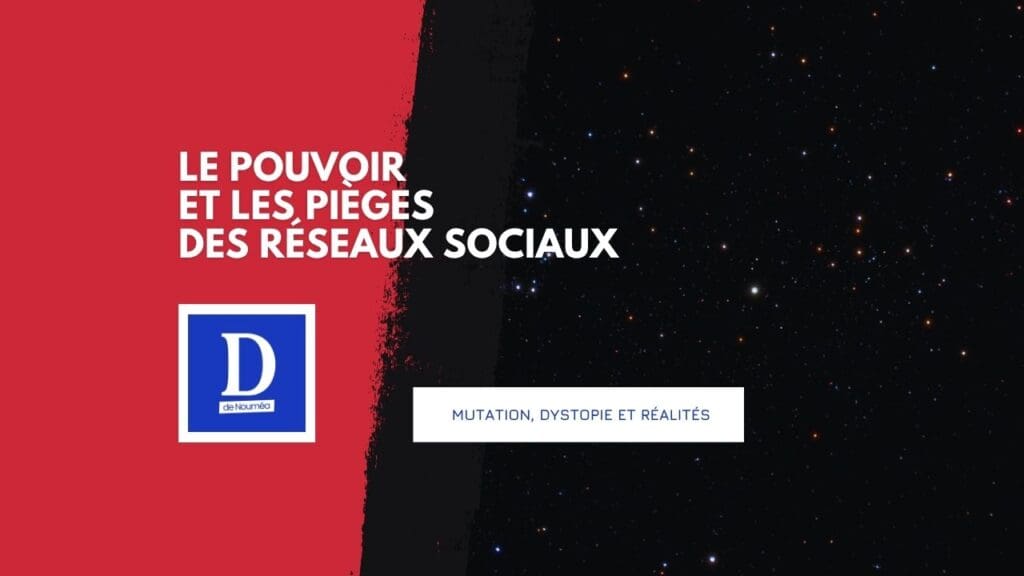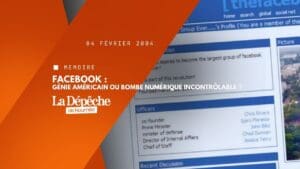Le 20 septembre, la Journée européenne de la prostate, portée par l’Association Européenne d’Urologie, brise le silence sur le cancer de la prostate, premier cancer masculin en France avec 60 000 cas annuels. Derrière ce tabou, des vies sont en jeu : 8 000 décès par an. Cette journée pousse au dépistage précoce et à la reconnaissance des pathologies prostatiques pour sauver des vies.
Un cri d’alarme face à un tueur silencieux
Le cancer de la prostate, est le fléau numéro un chez les hommes. En France, 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, surpassant les cancers du poumon ou colorectal. Pourtant, le sujet reste entouré d’un silence gêné, presque tabou, qui coûte cher : 8 000 décès annuels, soit un tribut humain équivalent à une petite ville. L’Association Européenne d’Urologie organise cet événement pour réveiller les consciences, pousser au dépistage et promouvoir des traitements efficaces.
Trop d’hommes ignorent les signaux ou refusent le dépistage par pudeur. Il faut briser ce mur,
martèle un urologue de renom. Cette initiative, loin des discours lénifiants, vise à imposer une vérité crue : sans action rapide, les chiffres continueront de grimper.
Le cancer de la prostate : un ennemi sournois
Le cancer de la prostate frappe un homme sur sept en Nouvelle-Calédonie et en France, souvent après 50 ans, avec un pic vers 70 ans. Cette glande, essentielle à la reproduction, devient un terrain miné avec l’âge, développant des pathologies comme l’hypertrophie bénigne ou la prostatite, mais surtout ce cancer insidieux. Les symptômes, difficultés urinaires, douleurs pelviennes, sont souvent ignorés. Le dépistage, via un simple dosage du PSA (antigène prostatique spécifique) et un toucher rectal, reste sous-utilisé.
Un test PSA peut tout changer. Un retard, c’est jouer avec sa vie
insiste un médecin généraliste. En 2023, 8 hommes sur 10 étaient diagnostiqués à un stade précoce, avec une survie à 5 ans de 93 %. Mais les 20 % restants paient le prix de l’inaction, avec des traitements lourds et invalidants.
Impacts dévastateurs : un coût humain et économique
Le cancer de la prostate n’est pas qu’une tragédie personnelle ; il pèse lourd sur la société. En Nouvelle-Calédonie, où les infrastructures médicales sont limitées hors Nouméa, l’accès au dépistage et aux soins reste un défi. Les traitements, de la chirurgie à l’hormonothérapie, engendrent des coûts conséquents, sans parler des impacts psychologiques : dysfonction érectile, incontinence, stigmatisation.
Perdre un père ou un grand-père à cause d’un dépistage évité, c’est inacceptable
déplore un responsable de santé publique. La Journée européenne de la prostate insiste sur la prévention : un dépistage annuel dès 50 ans, voire 40 ans pour les profils à risque (antécédents familiaux, origines africaines). L’inaction coûte des vies et des ressources, alors que des solutions existent, comme les biopsies ciblées ou les thérapies innovantes.
Vers une mobilisation générale : dépister pour sauver
La Journée européenne de la prostate n’est pas une simple commémoration ; c’est un appel à l’action. Les autorités sanitaires, appuyées par l’Association Européenne d’Urologie, militent pour des campagnes massives de sensibilisation et des tests accessibles. En Nouvelle-Calédonie, des cliniques mobiles pourraient réduire les disparités territoriales, tandis que des formations pour médecins et infirmiers sont cruciales.
Chaque homme doit connaître son risque. C’est une question de survie
déclare un oncologue. Les avancées technologiques, comme les biomarqueurs ou l’IRM prostatique, offrent un espoir concret, mais leur coût freine l’accès. Cette journée pousse à des réformes : prise en charge des tests, éducation des jeunes générations, et dialogue pour lever les tabous. L’objectif ? Réduire la mortalité de 20 % d’ici 2030.
Le 20 septembre n’est pas un jour comme les autres : la Journée européenne de la prostate sonne l’alarme contre un ennemi silencieux qui tue 8 000 hommes par an en France et des centaines en Nouvelle-Calédonie. Face au cancer de la prostate, l’inaction n’est pas une option. Dépistage, sensibilisation, accès aux soins : il est temps de briser les tabous et de protéger nos pères, nos frères, nos fils. La vie ne peut attendre.