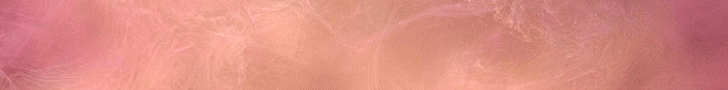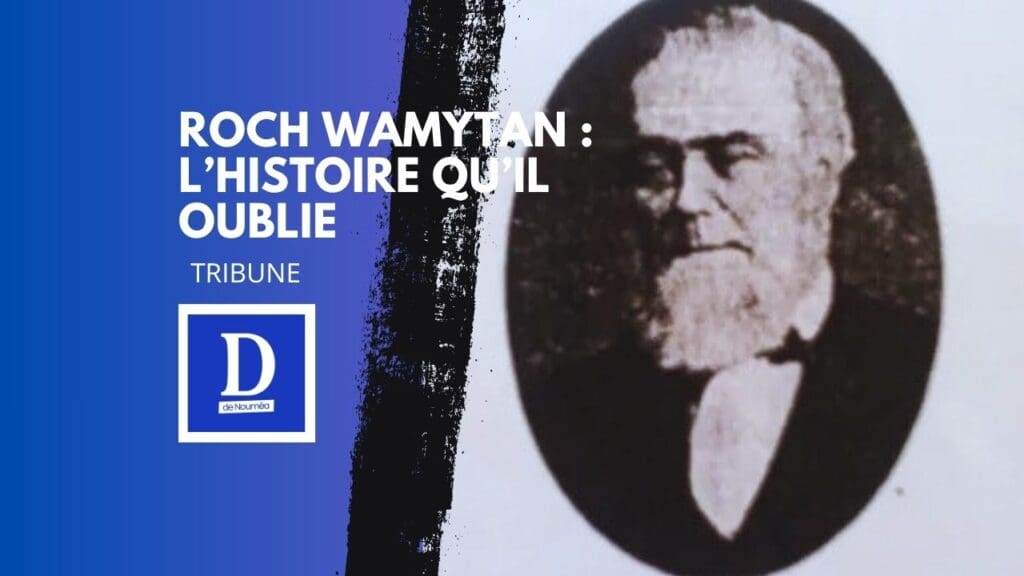l’Europe entre mémoire de 1945 et crainte d’un nouveau conflit
Alors que les dépenses militaires mondiales battent des records, la peur de la guerre ressurgit en France et en Europe, réveillant les fantômes du passé.
Paris, 9 mai 2025
Soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, célébrée chaque 8 mai, un vent de panique souffle à nouveau sur le continent. Selon un récent sondage, 25 % des Français redoutent aujourd’hui un conflit armé, une inquiétude en hausse de 9 points en un an. Une angoisse qui coïncide avec un autre chiffre choc : les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars en 2024, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Une progression historique de 9,4 %, la plus forte depuis la fin de la guerre froide.
Mémoire de 1945, ombres de 2025
Le 8 mai 1945, l’Europe pansait ses plaies après six années d’un conflit dévastateur. Le projet d’une union pacifique, incarné plus tard par l’UE, devait garantir « plus jamais ça ». Pourtant, en 2025, la guerre en Ukraine, les tensions OTAN-Russie et les crises énergétiques ont réveillé une peur que l’on croyait enfouie. « Les jeunes générations, qui n’ont connu que la paix relative en Europe, réalisent que la guerre n’est pas qu’un chapitre de manuel », analyse Marie Dubois, historienne spécialiste des conflits modernes.

Une course aux armements inédite
La réponse des États à ces tensions ? Une militarisation accélérée. En 2024, les budgets défense ont explosé : +13 % aux États-Unis, +18 % en Pologne, +7 % en France. La Russie et la Chine, bien que moins transparentes, suivent la même trajectoire. « Cette hausse reflète une défiance généralisée. Les pays se préparent à un monde où le dialogue diplomatique recule face à la force », décrypte Lukas Berg, analyste au SIPRI.
En Europe, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a servi d’électrochoc. Les livraisons d’armes à Kiev, le réarmement allemand ou le retour de la conscription en Suède illustrent ce virage. « Nous sommes dans une logique de security dilemma : chaque État renforce sa sécurité, ce qui nourrit les craintes des voisins », souligne Clara Renoir, politologue à Sciences Po Paris.
Boucle infernale : l’argent des armes nourrit-il la peur ?
Les citoyens perçoivent-ils ces milliards dépensés comme un gage de sécurité… ou un aveu de danger ? Pour 35 % des Européens interrogés par l’Eurobaromètre en mars 2025, « l’augmentation des budgets militaires est nécessaire ». Mais pour 48 %, elle « aggrave les risques d’escalade ». Un paradoxe qui s’incarne dans les rues de Paris, où des slogans comme « L’OTAN = guerre » côtoient des appels à « protéger nos frontières ».
Jean-Luc, un retraité rencontré place de la République, résume : « Dans les années 80, on avait peur des missiles soviétiques. Aujourd’hui, c’est flou : la menace vient-elle de Poutine, du cyberespace, ou de nous-mêmes ? »

Guerre froide 2.0 ?
Certains observateurs évoquent un « retour à la guerre froide », mais la réalité est plus complexe. Les alliances sont moins claires, les acteurs plus nombreux (Chine, Iran, groupes paramilitaires), et les armes ont changé : drones, IA, désinformation… « La différence avec 1945, c’est que la guerre n’est plus seulement déclarée entre États. Elle est hybride, asymétrique, et se joue aussi dans nos têtes via les réseaux sociaux », insiste Marie Dubois.
Et maintenant ?
Alors que l’Europe commémore les 80 ans de sa libération, la question demeure : cette militarisation accrue est-elle un passage obligé pour éviter la guerre… ou un pas de plus vers elle ? Les dirigeants européens, réunis à Bruxelles la semaine dernière, ont appelé à « un équilibre entre dissuasion et dialogue ». Un discours qui peine à rassurer des populations marquées par l’histoire.
En 1945, le monde avait choisi la reconstruction. En 2025, il semble hésiter entre deux chemins : réinvestir dans la paix… ou se préparer au pire.