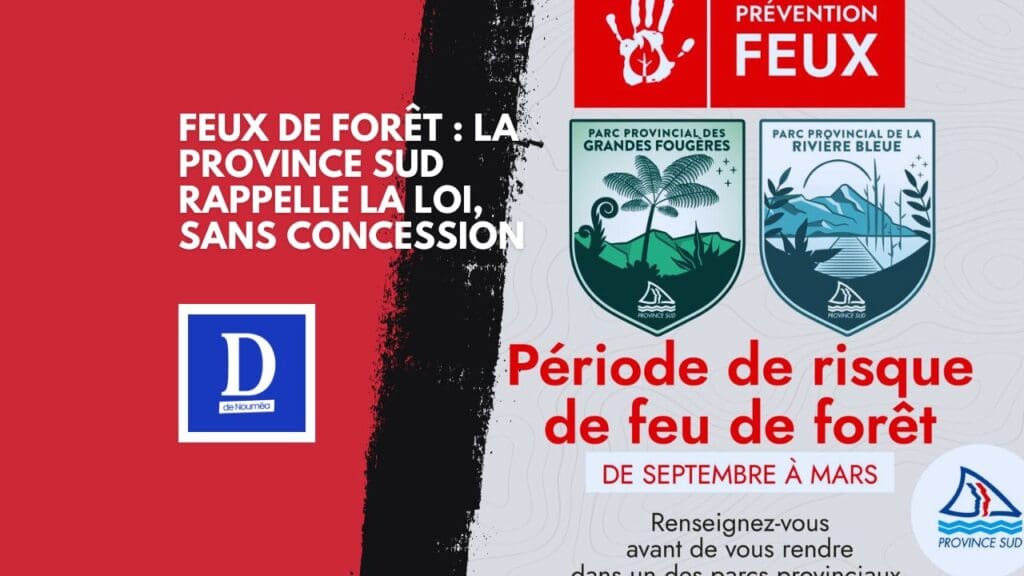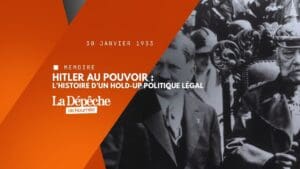Une grève générale calédonienne dans le sillage parisien
Le 18 septembre, l’USTKE mobilisera ses adhérents devant le Haut-commissariat à Nouméa, pour une grève de 24 heures. L’appel est directement calqué sur le communiqué intersyndical signé en métropole par la CFDT, la CGT, FO, CFE-CGC, UNSA, Solidaires et la FSU. Mot d’ordre commun : « Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit ! ».
L’USTKE justifie cette mobilisation en invoquant la baisse du pouvoir d’achat, la précarité et la crise sociale qui touche le pays. Elle appelle à une « solidarité ouvrière sans frontières », reliant explicitement les luttes locales aux mouvements français.
Une contradiction assumée ?
Cette convergence interroge : depuis toujours, l’USTKE présente la France comme un système capitaliste, oppresseur et colonial. Elle dénonce l’État pour avoir appauvri et exploité les travailleurs calédoniens. Pourtant, dans ce cas précis, le syndicat s’aligne sur les organisations hexagonales, qu’il érige en « camarades » de lutte.
La contradiction saute aux yeux : comment dénoncer l’État français comme colonial, tout en reprenant à la virgule près le discours des syndicats français et en s’adossant à leurs mobilisations ?
Entre rhétorique anti-coloniale et pragmatisme syndical
Pour l’USTKE, il s’agit peut-être d’un calcul stratégique : utiliser la caisse de résonance des mobilisations françaises pour renforcer son poids local. Mais ce double discours fragilise sa cohérence : anticolonialiste d’un côté, partenaire revendicatif de l’autre.
Dans un contexte où près de 11 000 travailleurs calédoniens seraient « sur le bord de la route », selon ses propres termes, l’USTKE tente de rallier les foules. Mais cette solidarité sélective révèle surtout un paradoxe : le colonialisme est rejeté quand il s’agit de l’État, mais applaudi quand il s’agit de syndicats français.