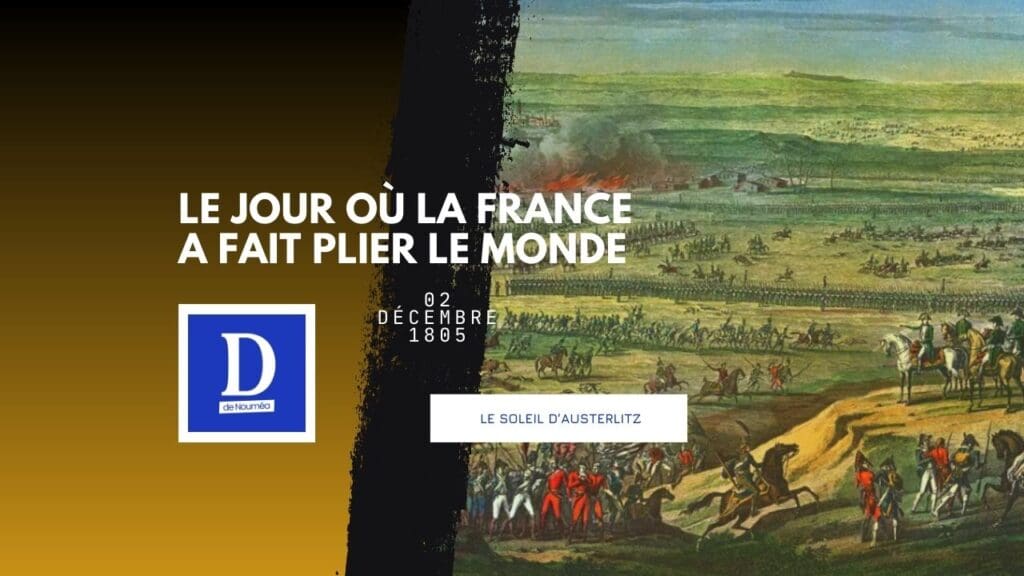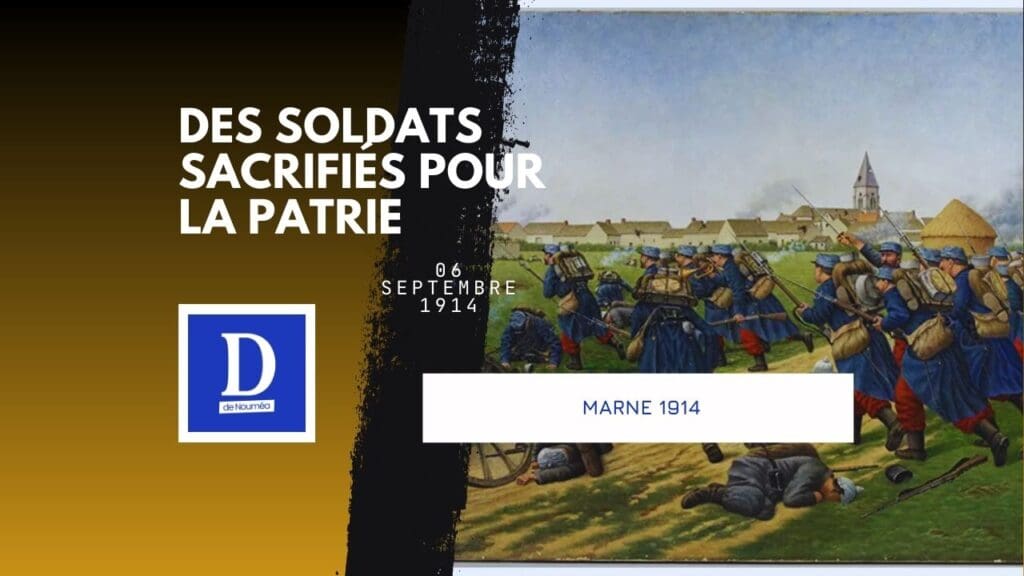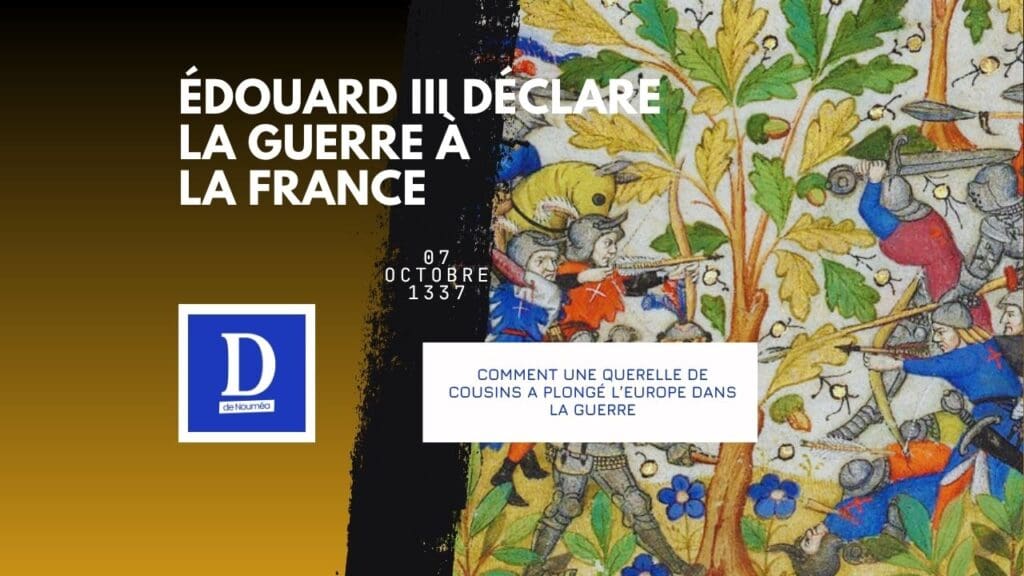Un aristocrate prussien devenu explorateur intrépide. Un savant universel qui a révolutionné la science moderne.
Des débuts timides dans l’ombre de son frère Wilhelm
Né le 14 septembre 1769 à Berlin, Alexander von Humboldt n’était pas destiné à marquer l’histoire. Dans sa jeunesse, il apparaissait effacé face à son frère aîné Wilhelm, brillant linguiste et fondateur de l’Université de Berlin. Élevé dans une famille aristocratique ouverte aux Lumières, le cadet semblait condamné à une carrière administrative sans éclat. Pourtant, une passion latente allait bientôt éclore : la botanique, la chimie et l’appel de l’ailleurs.
La mort de sa mère en 1796 lui donne enfin la liberté et les moyens financiers de suivre ses propres ambitions. Dès lors, Humboldt se lance dans un parcours inédit, multipliant les rencontres avec les savants européens, fréquentant les bibliothèques et perfectionnant ses méthodes scientifiques. Sa curiosité insatiable et sa soif de terrain vont le pousser à franchir les limites du connu.
L’épopée sud-américaine avec Aimé Bonpland
Le grand tournant arrive en 1799, lorsqu’il embarque avec son ami Aimé Bonpland, chirurgien de marine français. Ensemble, ils obtiennent du roi d’Espagne l’autorisation d’explorer ses colonies américaines. Pendant cinq ans, leur périple de 15 000 kilomètres les mène du Venezuela à l’Amazonie, en passant par Cuba, la Colombie et le Mexique.
Ils affrontent les fleuves en pirogue, gravissent les volcans andins et s’aventurent dans les jungles les plus hostiles. L’exploit le plus marquant reste l’ascension du Chimborazo, considéré alors comme le plus haut sommet du monde. Le 23 juin 1802, Humboldt et Bonpland atteignent près de 6 000 mètres d’altitude, une prouesse inédite pour l’époque.
Leur mission n’est pas seulement physique : ils collectent une masse colossale d’échantillons, de relevés et de données, établissent des cartes, décrivent les sociétés locales et relient la nature aux civilisations. C’est pourquoi Humboldt sera surnommé le « second découvreur de l’Amérique ».
Un savant universel au rayonnement mondial
De retour en Europe en 1804, Humboldt devient une figure intellectuelle majeure. Francophile, il s’installe longtemps à Paris, où il côtoie Cuvier, Lamarck et Laplace. Ses publications font de lui l’un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de son temps. Sa vision globalisante – reliant géographie, botanique, géologie et sociétés humaines – inspire directement Charles Darwin lors de son voyage sur le Beagle.
À 60 ans, Humboldt ne s’arrête pas. En 1829, il repart pour la Sibérie et parcourt près de 19 000 kilomètres, découvrant les premiers diamants de l’Oural. Jusqu’à ses 90 ans, il continue à écrire, publier et correspondre avec les élites scientifiques et politiques du monde entier.
Mort en 1859, Humboldt laisse derrière lui une œuvre monumentale : cartes, récits de voyage, observations naturalistes et une pensée scientifique visionnaire. Son nom reste inscrit sur des dizaines de lieux et d’espèces à travers le monde, notamment en Nouvelle-Calédonie avec le mont Humboldt (1 618 m), deuxième point culminant du territoire après le mont Panié. Explorateur, savant, aventurier : Humboldt a donné à la science un souffle universel.