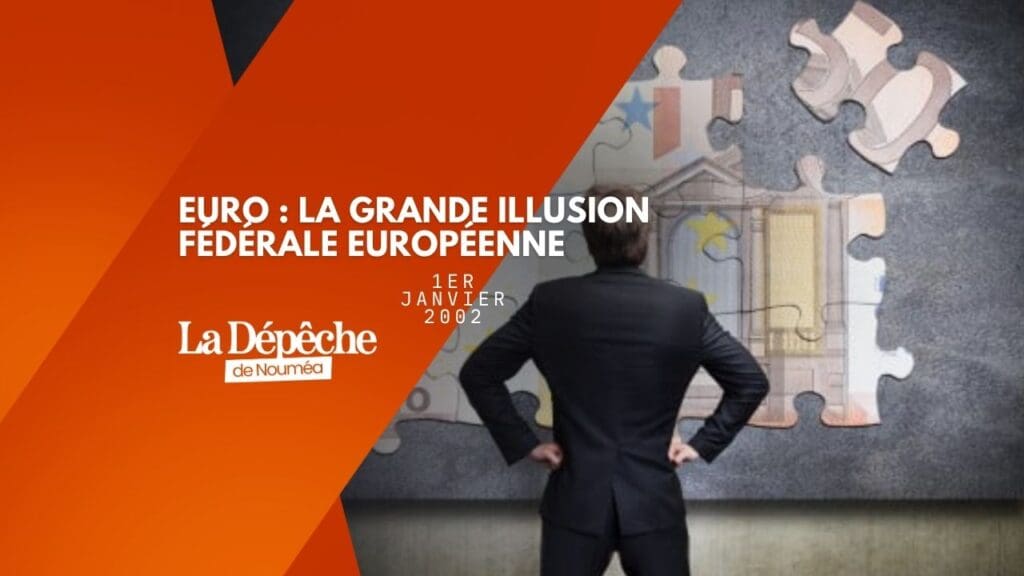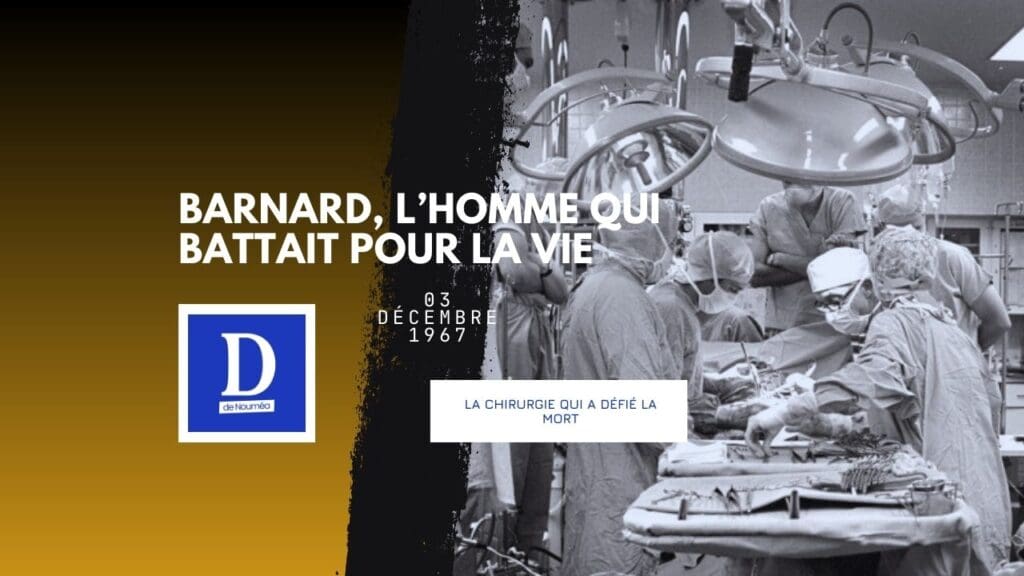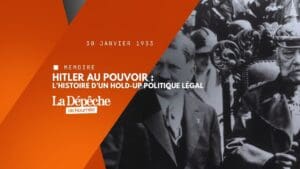Le 14 septembre 1812, Napoléon Ier entre triomphalement dans Moscou. Mais derrière l’apparente victoire se cache l’amorce d’un désastre. Capitale vidée de ses habitants, ville bientôt ravagée par les flammes, armée immobilisée dans l’attente vaine d’une capitulation : Moscou fut moins une conquête qu’un piège.
Une entrée triomphale dans une ville fantôme
À 14 heures, l’Empereur franchit les portes de Moscou, accompagné de sa garde et du 1er corps. Mais la « capitale » n’est plus qu’une coquille vide. Son gouverneur, Fédor Rostoptchine, l’a privée de toute ressource et a poussé l’immense majorité de ses habitants à l’exode. Napoléon s’installe dès le lendemain au Kremlin, convaincu que la prise de la ville forcera Alexandre Ier à négocier. Il attend sur le mont Poklonnaïa une capitulation qui ne viendra jamais.
Dans ce décor figé, le maréchal Mortier est chargé d’empêcher pillages et désordres. Des secours sont même accordés aux blessés russes restés dans les hôpitaux, signe que l’Empereur espère encore transformer sa conquête en symbole de pacification.
Le brasier qui consume Moscou
À peine installée, la Grande Armée voit son « trophée » partir en fumée. Du 14 au 18 septembre, des incendies, déclenchés selon les Français par les Russes eux-mêmes, dévorent la ville en grande partie construite en bois. En une semaine, 7 000 maisons de bois et 4 000 bâtisses de pierre disparaissent. Neuf dixièmes de Moscou s’effondrent dans les flammes.
Le bilan humain est terrible : 20 000 blessés ou malades périssent brûlés, et plus de 12 000 corps sont retrouvés après l’extinction des feux. « J’ai vaincu des armées, mais je n’ai pu vaincre les flammes », confiera Napoléon, impuissant devant un désastre qui prive ses soldats d’abris et de vivres.
Une victoire qui se transforme en piège
Privé de ravitaillement, sans signe de reddition russe, Napoléon s’enlise dans une ville en ruines. Ce n’est que le 18 octobre qu’il ordonne la retraite. Le 23, le Kremlin est abandonné et partiellement détruit. Commence alors l’une des marches les plus terribles de l’histoire militaire : une armée harcelée par les Russes, épuisée par la faim et bientôt écrasée par l’hiver.
L’Empereur reconnaîtra plus tard son erreur : ne pas avoir quitté Moscou plus tôt pour surprendre l’armée de Koutouzov à Tarutino. Le coup manqué scelle le destin de la campagne de Russie.
Le symbole d’une grandeur qui vacille
En chiffres, le désastre est vertigineux : plus des trois quarts des bâtiments détruits, 8 251 commerces et entrepôts rayés de la carte, 122 églises réduites en cendres. L’université d’État, des bibliothèques, des théâtres disparaissent. Moscou, estimée à 270 000 habitants avant l’invasion, chute à 215 000 après la guerre.
Pour les Russes, l’incendie fut un sacrifice patriotique qui sauva l’Empire. Pour Napoléon, ce fut la victoire la plus amère de sa carrière : celle qui ouvrit la voie à la retraite de Russie, prélude à sa chute.