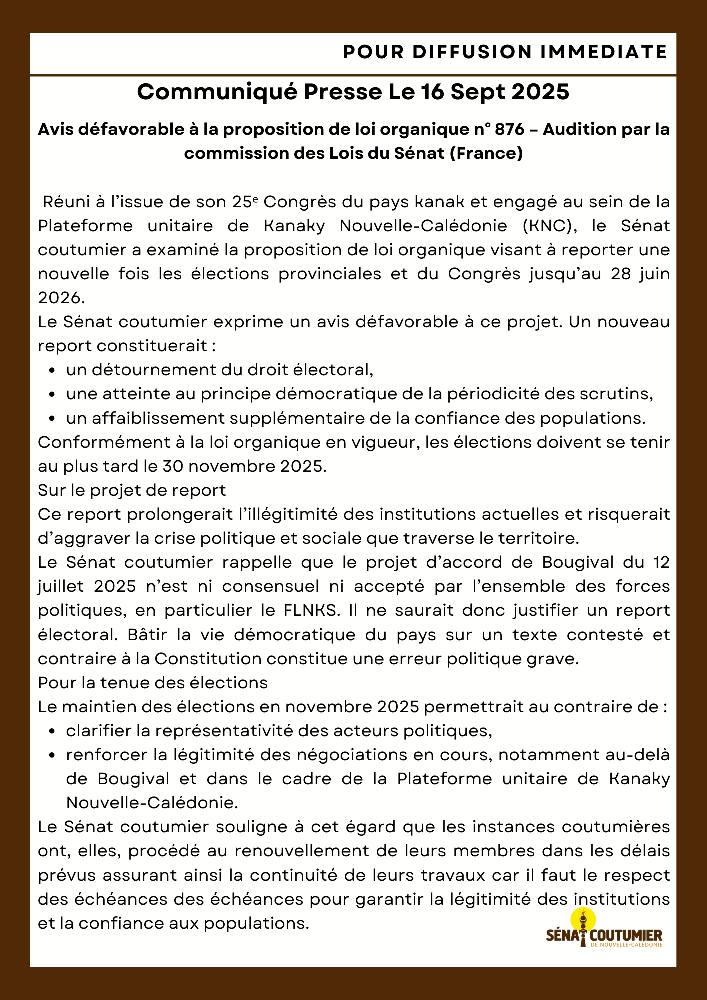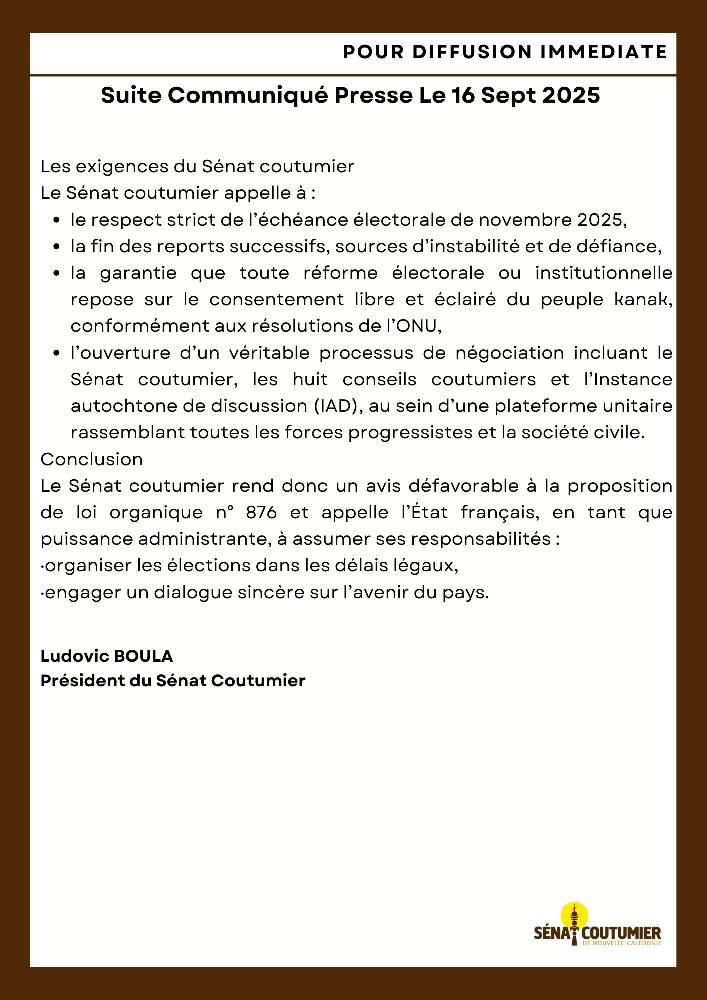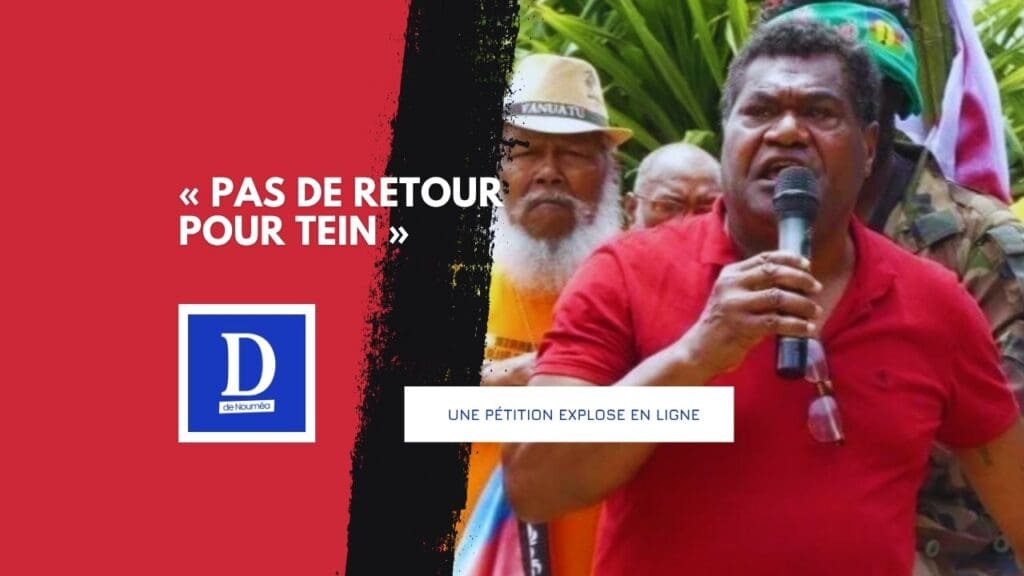La démocratie s’exprime dans les urnes, pas dans les arrière-salles. Le Sénat coutumier veut imposer son calendrier, mais oublie ses propres faiblesses.
Opposition frontale au report des élections
Ce mardi 16 septembre 2025, le Sénat coutumier a rendu public un avis défavorable au report des élections provinciales, après son audition par la commission des lois du Sénat français. L’institution coutumière exige que le scrutin se tienne dès novembre 2025, conformément à la loi organique. Pour ses membres, un nouveau report constituerait un « détournement du droit électoral » et une atteinte au principe démocratique de périodicité des scrutins.
Dans son communiqué, le Sénat coutumier dénonce un projet « contraire à la Constitution », jugé comme dangereux pour la stabilité du pays. Selon lui, les populations risqueraient de perdre toute confiance dans les institutions. Le message est clair : pour les sénateurs coutumiers, l’accord de Bougival ne saurait servir de prétexte à reporter les élections.
Mais derrière ces déclarations solennelles, une question de fond s’impose : de quelle légitimité parle cette institution qui n’est pas elle-même issue du suffrage universel ?
Une légitimité interne fragilisée et contestée
Depuis plusieurs années, le Sénat coutumier traverse une crise de crédibilité. Même au sein du monde coutumier, des voix s’élèvent pour dénoncer son fonctionnement opaque et son absence de transparence. Le cas du grand chef de La Roche, qui a créé Inaat Ne Kanaky en rupture avec l’institution, illustre cette contestation venue de l’intérieur.
Les sénateurs coutumiers ne sont pas élus par les populations mais désignés dans l’entre-soi des conseils coutumiers. Aucune femme n’y siège, et la présidence est simplement tournante entre aires coutumières. Parler de démocratie dans ces conditions relève d’un paradoxe saisissant.
Le Sénat coutumier, dirigé par Ludovic Boula, prétend défendre la légitimité du peuple, mais le peuple kanak n’a pas son mot à dire dans la désignation de ses représentants coutumiers. La critique est donc facile : s’opposer au Congrès élu au suffrage universel, alors que l’on se dispense soi-même de toute élection, fragilise la parole de l’institution.
Le choix des élus : la loi majoritaire contre les atermoiements coutumiers
Face à ce refus coutumier, la réalité politique reste claire. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté à la majorité le report des provinciales à juin 2026. Dans une démocratie, c’est bien la majorité parlementaire qui fait loi. Le Sénat coutumier, qui multiplie les atermoiements depuis son 25ᵉ congrès pays, agit en contre-pouvoir sans disposer de la légitimité électorale.
Les élus calédoniens, ont fait le choix de la stabilité, en s’appuyant sur l’accord de Bougival. Qu’on l’approuve ou non, cette décision résulte d’un vote démocratique. Les institutions de la République fonctionnent sur ce principe intangible : la souveraineté s’exprime par les urnes.
Alors que le Sénat coutumier appelle Paris à organiser les élections dans les délais, il démontre surtout son incapacité à reconnaître la légitimité des élus. Pire encore, en réclamant un calendrier électoral à contre-courant, il contribue à entretenir une instabilité politique qui dessert le pays.
L’avis défavorable du Sénat coutumier au report des élections provinciales n’est pas une surprise. Mais en voulant donner des leçons de démocratie, l’institution coutumière met en lumière ses propres contradictions. Non élue, non paritaire, non transparente, elle revendique une autorité morale qu’elle ne parvient plus à incarner.
La vérité est simple : en démocratie, c’est le peuple qui tranche par le vote, pas une institution coutumière installée hors du suffrage universel. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a choisi le report, et cette décision majoritaire s’impose. La France, garante de l’ordre républicain, doit maintenant veiller à ce que la stabilité l’emporte sur les postures.