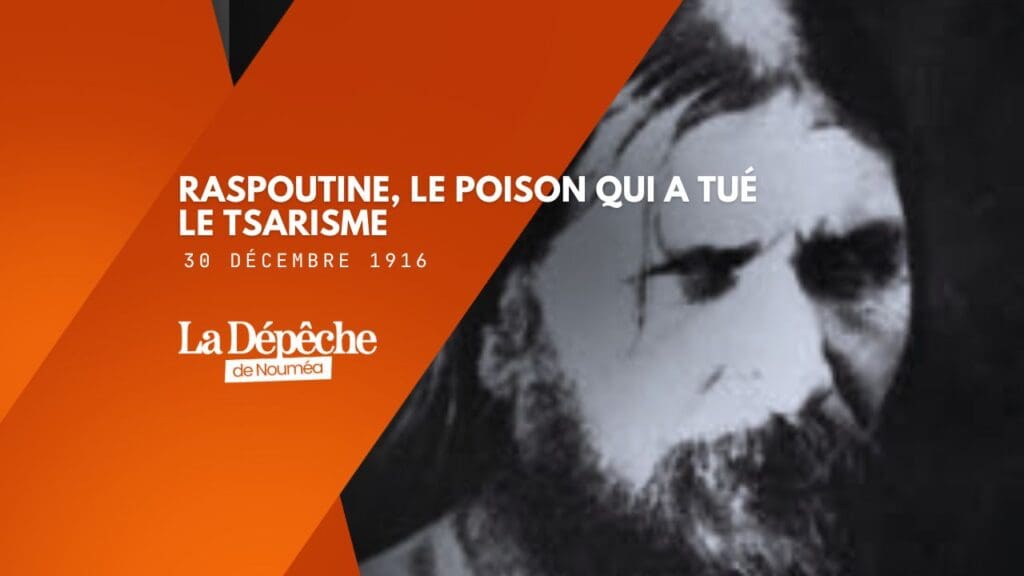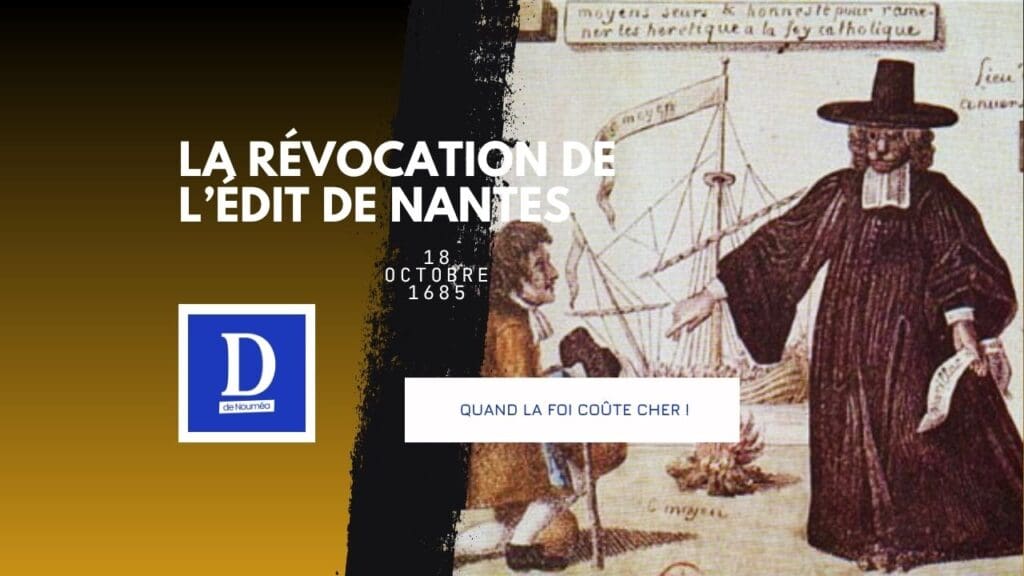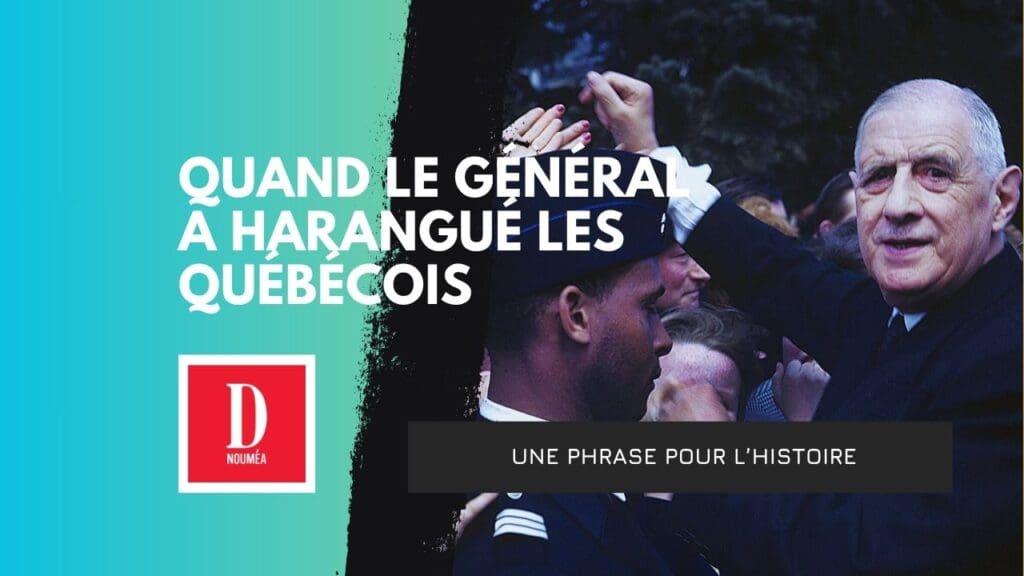Un vote historique, une rupture idéologique. Le 18 septembre 1981, la France bascule, abandonnant la peine capitale malgré une opinion publique encore favorable à son maintien.
Un tournant idéologique voulu par Mitterrand et Badinter
L’abolition de la peine de mort en France, votée le 18 septembre 1981, marque un choix éminemment politique. Portée par le garde des Sceaux Robert Badinter et voulue par le président François Mitterrand, elle consacre la victoire de l’idéologie humaniste sur une opinion encore majoritairement favorable au maintien de la peine capitale (62 % des Français y étaient favorables, selon un sondage).
En deux jours de débats, 369 députés votent pour et 113 contre. Douze jours plus tard, le Sénat confirme. La loi est promulguée dans la foulée, scellant une décision qui allait devenir l’un des symboles du septennat mitterrandien. Mais derrière la victoire morale et politique des abolitionnistes, une question demeure : la France s’est-elle alignée sur l’air du temps européen au mépris d’une opinion publique encore réticente à abandonner un instrument de justice qu’elle jugeait dissuasif ?
Une longue tradition française de résistance à l’abolition
Contrairement à d’autres pays d’Europe, la France avait longtemps résisté aux pressions abolitionnistes. Dès le XIXe siècle, des présidents comme Émile Loubet ou Armand Fallières préféraient user du droit de grâce, mais sans remettre en cause la loi.
La guillotine, symbole glaçant mais efficace, continue de s’imposer au XXe siècle, jusque pendant la guerre d’Algérie où son usage reprend. L’exécution de Buffet et Bontemps en 1972 ou celle de Christian Ranucci en 1976 montrent que la justice française n’avait pas abandonné l’idée que certains crimes, particulièrement odieux, méritaient la peine capitale.
Lorsque Valéry Giscard d’Estaing refuse la grâce de Ranucci, il incarne une ligne plus ferme, répondant à l’exigence d’une opinion publique choquée par des crimes contre des enfants. À l’inverse, Mitterrand fera de l’abolition une promesse électorale et un marqueur idéologique, tournant ainsi la page d’une France attachée à une justice ferme.
Une Europe abolitionniste face à un monde encore attaché à la peine capitale
Si la France de 1981 se met « au diapason » de l’Europe occidentale, il faut rappeler que la peine de mort reste, encore aujourd’hui, appliquée par des pays représentant les deux tiers de la population mondiale : Chine, Inde, États-Unis, Pakistan, Égypte, Nigéria… Autant de nations qui assument de défendre la sécurité publique par l’arme ultime de la justice.
L’abolition française est donc moins une victoire universelle qu’un choix culturel et idéologique : s’aligner sur l’Europe, quitte à tourner le dos à une majorité de citoyens et à une tradition juridique solide. L’émotion suscitée par certains crimes – meurtres d’enfants, assassinats terroristes – continue d’ailleurs d’alimenter en France le débat sur un éventuel rétablissement, malgré l’engagement européen scellé par la ratification du sixième protocole de la Convention européenne des droits de l’homme en 1985.
Le paradoxe demeure : alors que les Français réclament plus de sécurité et plus de fermeté, l’abolition de la peine capitale reste le symbole d’une justice adoucie, parfois perçue comme déconnectée des réalités.