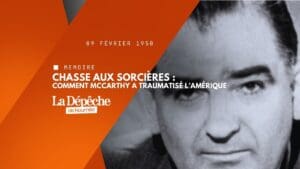Les océans couvrent près de 70% de la planète. Pourtant, jusqu’en 2023, la haute mer échappait à toute régulation internationale. Une faille béante, enfin comblée.
La haute mer, un espace sans maître mais stratégique
La haute mer, c’est 60 % de la surface des océans et près de la moitié du globe. Elle commence là où s’arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE), au-delà des 200 milles nautiques des côtes. Jusqu’à l’adoption de l’accord du 19 juin 2023 par les 193 États membres de l’ONU, ces zones étaient un véritable no man’s land juridique. Aucun État n’y exerçait d’autorité, ce qui ouvrait la voie aux excès : surpêche, pollution, pillage des ressources génétiques marines.
Le 23 septembre 2025, 63 pays avaient ratifié l’accord, marquant une étape décisive vers son entrée en vigueur, prévue le 17 janvier 2026. Pour la première fois, un texte contraignant fixe des règles internationales de protection. L’enjeu est immense : sécuriser des territoires marins vitaux, mais aussi préserver les intérêts des nations capables d’exploiter ces ressources dans un cadre équitable.
Un traité qui impose un cadre mondial
Le texte, négocié pendant près de vingt ans depuis 2004, s’appuie sur l’héritage de la Convention de Montego Bay (Unclos). Son objectif est clair : garantir une gouvernance mondiale des espaces maritimes. Plusieurs priorités sont établies :
-
La protection des écosystèmes marins au-delà des frontières nationales.
-
La lutte contre la pollution plastique et chimique en haute mer.
-
La régulation de la pêche pour éviter l’effondrement des stocks.
-
La prise en compte du réchauffement et de l’acidification des océans.
Le traité vise également à atteindre l’objectif international « 30 pour 30 » : protéger 30 % des océans d’ici 2030. Concrètement, cela passe par la création d’aires marines protégées, véritables sanctuaires où la biodiversité pourra être restaurée.
Mais au-delà de l’écologie, ce texte ouvre aussi la voie à un partage encadré des ressources génétiques marines. Celles-ci, utilisées en pharmacologie ou en biotechnologie, représentent un enjeu économique majeur. Le traité prévoit une redistribution équitable des bénéfices, afin d’éviter que seuls les plus puissants n’en tirent profit.
Un enjeu de souveraineté et de civilisation
Ce traité, présenté par certains comme un progrès écologique, est aussi une victoire politique. Pour la première fois, la communauté internationale reconnaît que la haute mer constitue un patrimoine commun de l’humanité. Autrement dit, aucune nation ne peut s’en arroger la propriété exclusive.
Il s’agit là d’un tournant. Car face aux appétits croissants de puissances comme la Chine, ce cadre légal permet de réaffirmer une certaine vision occidentale de l’ordre mondial : règles, coopération, respect mutuel. La France, puissance maritime de premier plan grâce à ses territoires ultramarins, trouve dans cet accord un outil stratégique pour défendre ses intérêts. La protection des océans n’est pas seulement une affaire de biodiversité, mais de souveraineté et d’influence.
Derrière l’écologie affichée, c’est bien la maîtrise de ressources immenses qui est en jeu. Poissons, ressources minières des fonds marins, innovations issues de la biologie : l’océan est l’avenir de l’économie mondiale. Ne pas le réguler, c’était accepter le chaos. Désormais, un cadre existe, fruit de vingt ans de patience diplomatique.
L’entrée en vigueur, en janvier 2026, ne résoudra pas tout. Mais elle impose enfin une discipline mondiale sur un espace qui, depuis des siècles, échappait à toute loi. Une étape décisive, qui rappelle que la liberté des mers suppose une responsabilité collective.