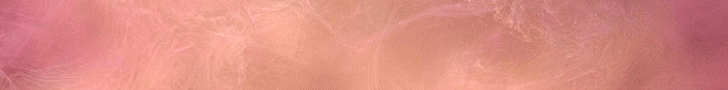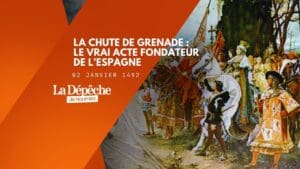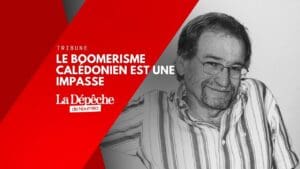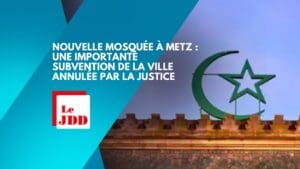Un nouvel appui américain vient soutenir la défense maritime philippine. Mais derrière les annonces, se pose la question de l’autonomie réelle de Manille.
Un financement symbolique plus que stratégique
Les États-Unis ont annoncé 55 millions de dollars d’aide maritime à partager entre plusieurs pays d’Asie et du Pacifique. Pour les Philippines, ce soutien reste modeste comparé aux milliards injectés par la Chine dans la région. Les experts estiment que l’enveloppe ne permettra pas de financer des équipements lourds mais plutôt des moyens de surveillance : radars, drones, ou encore formation des garde-côtes.
Selon Chris Gardiner, spécialiste de la sécurité régionale, ces investissements visent autant la lutte contre les trafics que la protection des voies maritimes et des ressources naturelles. L’objectif américain est clair : intégrer Manille dans un cadre sécuritaire piloté par Washington face à la montée en puissance chinoise.
Un outil utile mais limité
Pour Chester Cabalza, chercheur à Manille, cette aide marque la volonté de Washington de s’appuyer sur des États de taille moyenne pour rééquilibrer la puissance en Asie. Mais les analystes comme Sylwia Monika Gorska rappellent que les sommes allouées resteront insuffisantes pour doter les Philippines d’armes ou de navires majeurs.
À la place, Manille devrait renforcer sa capacité de patrouille et de coordination, domaine où les lacunes sont connues depuis l’incident de Scarborough en 2012. Le revers de la médaille : la dépendance croissante aux systèmes américains, qui réduit la marge d’autonomie stratégique.
Une dépendance accrue vis-à-vis de Washington
L’historique joue en défaveur de Manille : en 2015, l’administration Obama avait déjà accordé 119 millions de dollars, dont 79 millions directement aux Philippines. Cette fois, la somme est bien moindre et doit être partagée entre l’Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique.
Comme le souligne Abdul Rahman Yaacob, chercheur à l’ANU, l’impact sur la modernisation militaire philippine sera minimal. Le pays se retrouve ainsi face à un dilemme : améliorer ses garde-côtes grâce aux financements extérieurs, mais au prix d’une autonomie de décision affaiblie. Une situation bien différente de celle du Vietnam, qui a su bâtir un socle naval autonome tout en acceptant l’aide extérieure sur des segments secondaires.