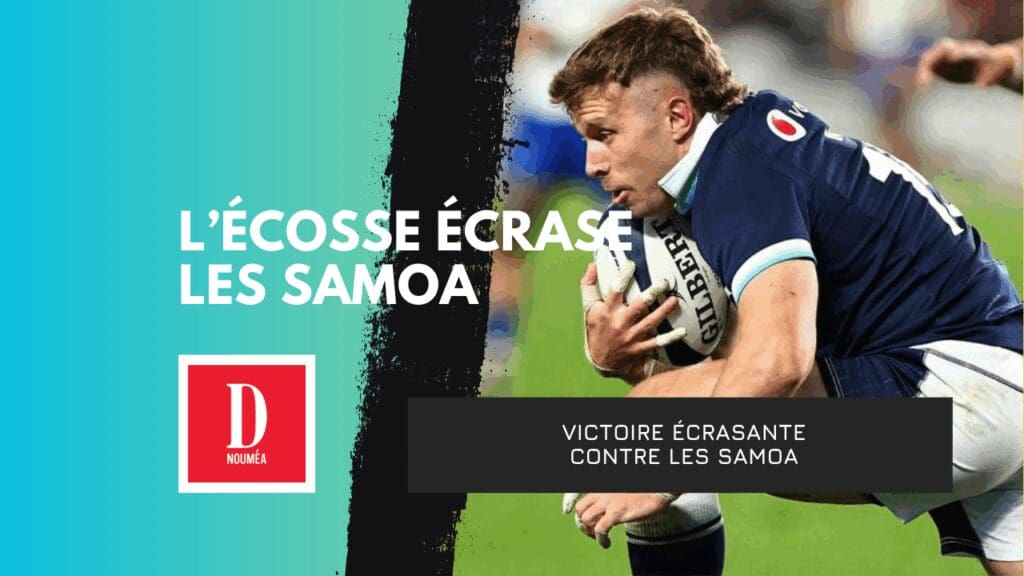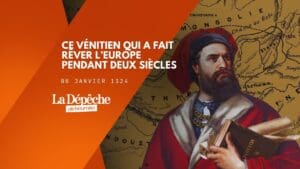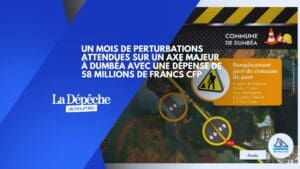Un rapport qui dérange le confort de certaines autorités « indépendantes ». Derrière la mission humaniste du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Cour des comptes révèle des fragilités de gestion et des dérives bureaucratiques bien françaises.
Une autorité née d’une bonne intention… devenue intouchable
Créé en 2007, le CGLPL devait incarner la vigilance de la République face aux abus potentiels dans les prisons, centres de rétention ou unités psychiatriques.
Mais, près de vingt ans plus tard, la machine administrative a pris le pas sur la mission républicaine.
La Cour des comptes, dans son rapport de juillet 2025, le dit sans détour : si la France respecte ses engagements internationaux, le taux d’application réel des recommandations du CGLPL plafonne à 30 %.
Autrement dit, sept recommandations sur dix restent lettre morte. Les ministères, eux, s’enorgueillissent de chiffres bien plus flatteurs — 70 à 80 % de mise en œuvre, selon leurs propres calculs Un écart qui en dit long sur la déconnexion entre le terrain et la technostructure parisienne.
Derrière la façade des droits fondamentaux, le CGLPL se heurte à la lourdeur d’un système administratif incapable de se corriger lui-même : un symbole de ces autorités indépendantes qui, au fil du temps, s’auto-alimentent en contrôlant sans jamais vraiment réformer.
Gestion des deniers publics : rigueur affichée, dérapages persistants
Sur le papier, la Cour reconnaît une gestion budgétaire globalement maîtrisée. Mais, à y regarder de plus près, les chiffres parlent d’eux-mêmes : les frais de déplacement ont bondi de 47 % entre 2017 et 2023, passant de 640 € (76 800 CFP) à 940 € (112 800 CFP) la journée de mission. Une inflation qui fait tache pour un service censé prêcher la sobriété et l’exemplarité.
Et faute d’indicateurs fiables, le CGLPL est incapable d’expliquer l’origine de cette explosion des coûts.
La Cour recommande donc un suivi précis et une limitation des dépenses, en particulier sur les missions à l’étranger et les déplacements multiples pour une même inspection.
Autre sujet sensible : les prestations informatiques. La maintenance du logiciel ACROPOLIS, cœur du système de signalement, est réalisée hors marché depuis huit ans. Autrement dit, sans renégociation ni mise en concurrence. Un contournement du droit de la commande publique que la Cour juge contraire aux principes de transparence.
Preuve que, même au sein d’une institution prônant la légalité, la rigueur administrative reste à géométrie variable.
Ressources humaines : un entre-soi élitaire sous couverture morale
Avec 78 % du budget consacré aux salaires, le CGLPL fonctionne avant tout comme une petite administration d’élite. Le rapport révèle un recours massif à des contractuels et à des intervenants extérieurs, souvent issus des hautes sphères de la fonction publique d’État.
Ces experts sont rémunérés par indemnités forfaitaires fixées… par la contrôleure générale elle-même, alors que le décret de 2008 impose un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du Budget.
Un détail ? Pas vraiment : c’est une entorse claire au principe de séparation des pouvoirs budgétaires.
La Cour réclame donc une remise en ordre : transparence sur les rémunérations, hiérarchisation des recommandations et dialogue concret avec les administrations de terrain. Autant de rappels à l’ordre qui sonnent comme un avertissement : la vertu morale ne dispense pas du contrôle républicain.
Entre idéalisme des droits fondamentaux et réalité budgétaire, le CGLPL cristallise la dérive d’un certain modèle français : multiplier les « autorités indépendantes » sans réel contrôle démocratique.
La Cour des comptes, en remettant les chiffres sur la table, rappelle une évidence : la liberté ne se protège pas dans la paperasse, mais dans l’action efficace et responsable de l’État.